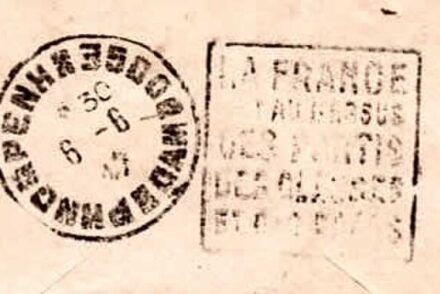Contents
1.3 (Re)traduire les classiques africains
1.5 50 years of Contemporary French Civilization (North Carolina State University)
1.7 ASMCF Annual Conference 2025 (University of Kent)
1.8 Francophone Perspectives on New and Radical Forms of Care
1.8 Alice Diop’s Cinema: (Re)formulating the Real (Duke University)
1.9 Queer Creoles in French and Francophone Contexts (MLA 2026)
1.10 ReFocus: The Films of Nabil Ayouch
1.12 Movement (University of South Carolina)
1.13 Conditions (King’s College London)
1.15 The Hospital in Contemporary French and Francophone Thought, Literature, Film and Visual Art
1.17 Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones (Sousse Tunisie)
1.18 Créations littéraires et lectures (Safi, Maroc)
1.19 Afrotopies. La science-fiction africaine contemporaine
1.21 Littératures : légitimité et (l)égalité
1.22 Boualem Sansal et la littérature mondiale / Boualem Sansal and World Literature
1.23 Et plus ultra… III. L’outre-vie dans les littératures francophones (Lille)
2.26 Migration, Place/making and Belonging (University College Cork)
2.1 The Simon Gaunt Postgraduate Travel Grant 2025
2.2 SFS Visiting International Fellowship scheme
2.3 ASMCF Peter Morris Memorial Postgraduate Travel Prize 2025
2.4 French, Assistant (Tenure-Track) Professor, Bellevue College
2.5 Inst/Ast Prof – Fixed Term, Michigan State University
2.6 Visiting Assistant Professor of French, College of Charleston
2.7 Chair – Department of Modern and Classical Languages, George Mason University
2.8 Stipendiary Lecturership in French, University of Oxford, Christ Church
3.1 Modern French History Seminar at the IHR
3.2 NYC Area French History Group
3.3 Séminaire « Des statues pour mémoire? Colonialisme et espace public »
3.4 Haiti and the World: Global Encounters of the Past, Present, and Future
3.5 La Revue des Colonies : Réseaux diasporiques et combats abolitionnistes
3.7 Conducting Interviews: Oral History
4.1 A Comparative Literary History of Modern Slavery: The Atlantic world and beyond
4.2 The Productivity of Negative Emotions in Postcolonial Literature
4.3 DOSSIER : Des statues pour mémoire ? Colonialisme et espace public en France
4.4 Theories and Methodologies: Mariama Bâ’s Souvenirs of Lagos
4.5 Repeating Revolutions: The French Revolution and the Algerian War
4.6 Le rayonnement des littératures africaines: 30 ans de création et de pensée-Revue Cinétismes
4.7 Indispensables et indésirables : Les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre
1. Calls for Papers/Contributions
1.1 Death and Militancy: Interdisciplinary Perspectives on Death, Dying, and Revolution in the Francophone World, ca. 1960-1980 (Université du Québec à Montréal – Montréal, Québec)
Death and Militancy: Interdisciplinary Perspectives on Death, Dying, and Revolution in the Francophone World, ca. 1960-1980
November 7-8, 2025 (Université du Québec à Montréal – Montréal, Québec)
In late 1963, while waiting for his trial for terrorism, Georges Schoeters wrote a letter from prison in Montréal. One of the founders of the Front de Libération du Québec, Schoeters outlined the stakes of the struggle for Québec’s independence before signing the missive: “L’indépendance ou la mort.”1 Other francophone revolutionaries and militants in these years repeated similar calls to action; the slogans “patrie ou mort” or “la liberte ou la mort” were repeated in pamphlets, letters, and graffiti.
While many activists pledged to die for their cause if needed, all paid tribute to those who had sacrificed their lives on the altar of the revolution. In a declaration from Algiers, Ernesto “Che” Guevara declared that “there are no borders in our struggle to the death.”2 In dying himself in 1967, Guevara became one of many martyrs who made the ultimate sacrifice for the cause. Martyrs of the revolution lived on in the pages of revolutionary publications, in speeches, literature and in art. From France to Québec, from Cuba to Algeria, whether as watchword, symbol, or lament, death both haunted and galvanized revolutionary movements. Militants mobilized the threat, reality, or promise of death to call people to resist and fight.
Today, militants also mobilize the idea or fear of death to call for resistance in the context of diverse crises. In looking back at the way these ideas were used and absorbed by militants in the wake of formal decolonization (1960-1980), this conference aims to give space to a discussion around death and revolutionary militancy and emancipatory movements in the French-speaking world. The interdisciplinary, bilingual (French and English) two-day event will bring together scholars studying the relationship between death and militancy in the francophone world.
Potential themes for presentations include but are not limited to the following thanatological themes:
- ● Death and Marxist thought
- ● Suicide and self-death
- ● Religion, secularism, and martyrdom
- ● Grief, trauma, and emotion
- ● Gender, race, and identity as motivation or response to death
- ● Indigeneity, nationhood, and individual or collective belonging
- ● Terror and state violence
- ● The (il)legality and (il)legibility of death
- ● Representations of death and dying in literature or poetry, films, plays or art
- ● Funerals, Memorialization and Commemoration
We especially welcome contributions that pay attention to the global or transnational dimensions of these questions.
The conference will take place November 7 – 8, 2025 on the campus of the Université du Québec à Montréal. Presenters will be expected to pre-circulate and read one another’s papers. In addition to finding productive space in comparative and interdisciplinary work on death and militancy, this event aims to create a network of scholars in and beyond Canada who can continue to explore these questions together.
Those interested should submit the following information by Tuesday, March 25, 2025: title and abstract (300 words max) of your contribution, a brief CV (2 pages), and a short bibliography/biography of your relevant work (150 words). All participants should have proficiency in French and English.
Thanks to funding from the Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité et Démocratie (CRIDAQ), the organizers will be able to provide travel funds for some participants, with priority going to non-permanent and graduate student presenters. We are in the process of applying for additional funding from the SSHRC which would provide additional travel expenses for other participants. If secured, these funds would also allow us to produce two publications based on material presented at the conference: a special edition of a journal and an edited volume. Contributions will be selected after the conference.
Please send any questions or concerns to Sarah K. Miles (UQAM, CRIDAQ) at
skmiles3@gmail.com. The organizational committee also includes: Doyle Calhoun (University of Cambridge), Roxanne Panchasi (Simon Fraser), Donald M. Reid (University of North Carolina at Chapel Hill), Stéphane Savard (UQAM), and Jean-Philippe Warren (Concordia University).
1 Georges Schoeters, “Lettres de Georges Schoeters,” Parti Pris 1, no. 2 (November 1963), 6.
2 Ernesto Guevara, “At the Afro-Asian Conference in Algeria,” from The Che Reader (Ocean Press, 2005) cited by Marxists.org. https://www.marxists.org/archive/guevara/1965/02/24.htm.
Mort et militantisme: Recherches interdisciplinaires sur les conceptions de la mort, mourir et la révolution dans le monde francophone, 1960 à 1980
November 7-8, 2025 (Université du Québec à Montréal – Montréal, Québec)
Vers la fin de 1963, Georges Schoeters écrivit une lettre de sa cellule en prison à Montréal. Belge, révolutionnaire et l’un des fondateurs du Front de libération du Québec, Schoeters décrivit l’importance de son combat pour l’indépendance du Québec et finit sa lettre : « L’indépendance ou la mort. » 3 Dans les années qui suivirent, des militants et des révolutionnaires francophone répétèrent cet appel à l’action; dans des lettres, slogans et graffitis ils disent la patrie ou la mort ou révolution jusqu’à la mort.
Dans une déclaration à Alger, Ernesto Guevara, dit « le Che », proclama qu’il « n’avait pas de frontières dans notre combat à mort ».4 Ceux qui sont morts pour leur cause vivaient encore dans les journaux révolutionnaires, dans les discours, la littérature et les œuvres d’art, et dans les mémoires de ceux qui les suivirent. De la France au Québec, de Cuba au Vietnam en passant par l’Algérie, comme mot-clé, symbole ou complainte, la mort à la fois hantait et galvanisait les mouvements révolutionnaires. Les militants francophones mobilisaient la menace, la réalité ou la promesse de la mort pour appeler le peuple à résister et à lutter.
Aujourd’hui, les militants mobilisent l’idée ou la peur de la mort pour appeler à la résistance face à diverses crises. En rétrospective, en examinant la manière dont ces idées ont été utilisées et absorbées par les militants dans le sillage de la décolonisation formelle (1960-1980), cette conférence met en lumière une réalité souvent occultée : l’importance de la mort au sein des mouvements émancipateurs dans le monde francophone. « Mort et militantisme » est une conférence interdisciplinaire et bilingue (français et anglais) qui se tiendra les 7 et 8 novembre 2025 sur le campus de l’Université du Québec à Montréal. Les presentateur.e.s devront faire circuler leur texte et lire celui de leurs co-conférencier.e.s. Cet événement donnera l’opportunité à ceux et celles qui étudient la relation entre la mort et le militantisme dans les années soixante et soixante-dix dans le monde francophone de se réunir. Dans nos travaux comparatifs et interdisciplinaires, nous aurons la chance d’approfondir notre compréhension de ce sujet et, nous l’espérons, de créer un réseau de chercheurs qui pourra continuer à traiter de ces thèmes dans les années à venir.
Voici une liste (non exhaustive) de thématiques thanatologiques potentielles :
- ● La mort et le marxisme
- ● Suicide et mort volontaire
- ● Religion, laïcité et martyre
- ● Peine, traumatisme et émotion
- ● Genre, race, et identité comme motivation ou réponse à la mort
- ● L’indigenéité, nation(alism) et appartenance individuelle ou collective
- ● Violence étatique et terreur et terrorisme
- ● L’(il)légalité et l’(in)compréhensibilité de la mort
- ● Représentation de la mort dans la littérature ou la poésie, les films, les pièces de théâtre
ou l’art
- ● Funérailles, enjeux mémoriels et commémoration
Nous invitons particulièrement les travaux qui traitent de la dimension internationale ou globale de ces sujets.
Les intéressés doivent soumettre les informations suivantes avant le mardi 25 mars 2025 : titre et sommaire de la présentation (300 mots maximum), CV abrégé (2 pages), et une brève biographie et bibliographie de vos travaux pertinents (150 mots). Les participants devront être capables de travailler en français et en anglais.
3 Georges Schoeters, “Lettres de Georges Schoeters,” Parti Pris 1, no. 2 (November 1963), 6.4 Ernesto Guevara, “At the Afro-Asian Conference in Algeria,” from The Che Reader (Ocean Press, 2005) cited by Marxists.org. https://www.marxists.org/archive/guevara/1965/02/24.htm.
Le soutien du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité et la Démocratie (CRIDAQ) nous permettra de défrayer les déplacements de certains participants, avec priorité donner aux étudiants de 2e ou 3e cycle et aux chercheurs dans des positions non permanentes. Nous espérons recevoir du financement supplémentaire du CRSH qui nous permettrait d’offrir plus de financement aux participants ainsi que d’organiser la publication de deux travaux collectifs après la conférence (un dossier thématique avec une revue académique et un volume collectif). Les contributions pour ces futures publications seront sélectionnées après la conférence.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire à Sarah K. Miles (UQAM, CRIDAQ):
skmiles3@gmail.com. Le comité scientifique inclus: Doyle Calhoun (University of Cambridge), Roxanne Panchasi (Simon Fraser University), Donald M. Reid (University of North Carolina at Chapel Hill), Stéphane Savard (UQAM), et Jean-Philippe Warren (Université Concordia).
We invite proposals for contributions to an edited volume exploring the interfaces between laughter and medicine. Developing from a British Academy/Wellcome Trust-funded conference held at the University of Birmingham in November 2024, this volume will put the medical humanities in dialogue with healthcare provision and the medical sciences so as to bridge the divides between the clinic, the laboratory, cultural history, literature, and the arts in Western cultures from the classical period to the present day.
The volume aims to present a transdisciplinary account of the cultural, social, diagnostic, therapeutic, and physiological implications of the laughter that characterizes—and is elicited by—real and fictional interactions among physicians, patients and the general public, inside and outside the clinic. Laughter is not always the “best medicine”, nor is laughter linked only to comedy and enjoyment. Without excluding the curative or the comic, this project hopes to uncover the more complex and sometimes darker aspects of the relationship between laughter (both voluntary and involuntary) and medicine that are often obscured by facile idioms and clichés. “Healing laughter” differs markedly in character and effects from pathological laughter; hysterical laughter; forced or bitter laughter; laughter serving to mitigate awkwardness in, or failures of, communication; laughter intended to deceive; or laughter signifying fear, discomfort or aggression. The irony and other double-coded signifiers that abound in comic and parodic representations of medical practitioners and their patients, as well as in medical metaphors and allegories deployed in diverse discursive contexts, often reveal medicine’s paradoxical place in various cultural imaginaries and in individual and collective experience.
Submissions may respond to questions including, but not limited to, the following:
- How and why is laughter represented, elicited, and mobilized in connection with medicine in the temporal and spatial arts (literature, cinema, print and digital media, performing arts, sculpture, etc.) in particular historical and cultural contexts and moments? What ideological, aesthetic, cultural, and other issues are bound up with or thought through the nexus between laughter and medicine?
- What does synchronic and diachronic comparison reveal about the specificity of particular representations of laughter and medicine and about the historical evolution of their cultural construction? How do evolving cultural and artistic representations inform, and how are they informed by, the development of medical science and practice?
- How and why does laughter occur in the context of illness and death, as well as in routine healthcare provision? What is its significance? What functions does it serve?
- What are laughter’s causes and effects from a physiological and psychological standpoint? What does the phenomenon of laughter reveal about the relationships between mind and body and between physical, mental, and emotional health?
- How and with what stakes has the relationship between laughter and medicine been theorized at different moments in intellectual and cultural history? How does the thinking of laughter in medical contexts fit into larger cultural formations and reflect or revise scientific models?
- What are the poetic and ideological effects and stakes of the ludic medicalization, in various discursive contexts, of aspects of life and culture that are not (necessarily or customarily) imagined in medical terms?
- What are the implications of the relationship between laughter and medicine from a philosophical perspective?
- What are the sociological implications of the nexus between laughter and medicine, especially in relation to contexts and patterns of (mis)communication and to the negotiation of social identities linked to profession, class, gender, ethnicity, etc.?
- What roles does laughter play in relation to disability and disability studies?
In order to accommodate the different disciplinary norms corresponding to the diverse fields that will be represented in the volume, we will accept proposals for chapters ranging in length from 3,000 to 10,000 words. Each chapter should make a contribution in its own discipline while making an effort to remain intelligible to an interdisciplinary academic audience.
Chapter proposals should take the form of a 500-word abstract including a title; a brief overview of scholarly or scientific contexts; a concise articulation of the research question and/or aims to be addressed; the tentative theses, conclusions, and/or arguments to be advanced in the chapter; and an estimated word count for the chapter. Authors should also provide an abbreviated CV.
It is hoped that the volume proposal will be submitted in July 2025 to the Proceedings of the British Academy series, which has expressed interest in the project. Contrary to what its name might suggest, this series, currently published through Oxford University Press, produces high-quality, rigorously peer-reviewed themed volumes developing from conference projects that have earned support from very competitive British Academy grants. Following notification of the acceptance of the book proposal, contributors will be asked to submit their completed chapters within six months.
Submissions should be sent to both p.barta@surrey.ac.uk and lucas.wood@ttu.edu
by March 15, 2025.
1.3 (Re)traduire les classiques africains
L’équipe de la revue Itinéraires. LTC a le plaisir de vous faire part de ses deux nouveaux appels à contribution.
(Re)traduire les classiques africains, dossier coordonné par Pierre Leroux, Carole Boidin, Alice Chaudemanche, Stefania Cubeddu-proux, Nathalie Carre
Date limite d’envoi des propositions : 1er mars 2025
Qu’il s’agisse de faire entendre la « Bonne Nouvelle » dans les langues d’Afrique, ou de raconter des « petits contes nègres pour les enfants des Blancs » (Raymond Queneau), la traduction a joué très tôt un rôle essentiel dans la constitution de corpus littéraires en Afrique. Récemment, la création de deux revues spécialisées et la parution, entre autres, d’un ouvrage sur les “translation imperatives” témoignent d’un regain d’intérêt pour cette pratique qui mêle des enjeux linguistiques, esthétiques et politiques. Prenant appui sur cette réflexion, ce dossier se propose d’examiner plus particulièrement le phénomène de la retraduction, compris comme le fait d’offrir une nouvelle traduction d’un ouvrage déjà disponible dans la langue cible. En effet, en inscrivant la pratique de la traduction dans une perspective diachronique, la retraduction permet d’esquisser un nouveau regard sur l’histoire des littératures d’Afrique et des littératures en Afrique. Retraduire une œuvre, c’est confirmer son statut, légitimer sa place dans la langue d’accueil, se donner l’occasion de la réinterroger.
Pour lire le texte complet de l’appel et accéder aux informations pratiques : https://journals.openedition.org/itineraires/15319
Égologie : ce que je veut dire, dossier coordonné par Vianney Dubuc et Nicolas Mazel
Date limite d’envoi des propositions : 15 février 2025
L’objectif de ce numéro de la revue Itinéraires est de prolonger la réflexion du séminaire pluridisciplinaire intitulé « Dire je : du Moyen Âge à nos jours » qui s’est tenu à l’Université Lyon 2 et à l’École Normale Supérieure de Lyon durant l’année 2023-2024. L’expression de la première personne est une question traditionnelle et qui demeure centrale dans de nombreuses études : le pronom je est tout autant court et banal qu’il est un lieu indéfini, fuyant et inépuisable.
Nous souhaitons dans ce dossier mettre en avant les différentes approches possibles de l’expression de la première personne afin de souligner qu’il existe un vaste champ d’étude, qu’on pourrait nommer « égologie », qui transcende les disciplines et les méthodologies pour éclairer ce pronom je.
Dans ce numéro, nous croiserons les perspectives du séminaire de recherche lyonnais avec celles de la revue Itinéraires. Nous proposons d’orienter notre exploration autour de quatre axes principaux qui conservent l’esprit généraliste, transdisciplinaire et transhistorique du projet initial.
Les langues de rédaction acceptées sont le français, l’anglais, l’espagnol et l’italien.
Pour lire le texte complet de l’appel et accéder aux informations pratiques : https://journals.openedition.org/itineraires/15314
English
Egology: what I means
Deadline for sending proposals: February 15, 2025
The aim of this publication of the journal Itinéraires is to extend the reflections of the multidisciplinary seminar entitled ‘‘Dire je: du Moyen-Âge à nos jours’’ (Saying I: from the Middle Ages to the 21st century), which was held in Lyon (Université Lumière Lyon 2 and École Normale Supérieure de Lyon) in 2023-2024. In this publication, we wish to highlight the different possible approaches to the expression of the first person, in order to emphasise that there is a vast field of study, which could be called ‘‘egology’’, transcending disciplines and methodologies in order to shed light on the uses of the pronoun I.
In this publication, we combine the perspectives of the Lyon research seminar with those of the journal Itinéraires. We propose to orientate our exploration around four main axes that retain the generalist, transdisciplinary and transhistorical approach of the initial project.
The editorial languages accepted are French, English, Spanish and Italian.
To read the full text: https://journals.openedition.org/itineraires/15323.
1.4 Colloque international Francophonies, divers(c)ités, polyphonies : comment habiter le monde en plusieurs langues ? (Saint-Louis, Sénégal)
Appel à communication : Colloque international Francophonies, divers(c)ités, polyphonies : comment habiter le monde en plusieurs langues ?
Saint-Louis du Sénégal 20, 21, 22 Mai 2025
Argumentaire
Francisation et dynamique d’un monolinguisme politiquement construit et imposé !
Issu d’un contexte multilingue très dense qu’il a partagé avec le latin et plusieurs langues locales, le français a connu une aventure extraordinaire qui l’a vu devenir une des plus puissantes langues internationales et une des langues les plus parlées dans le monde. Cette ascension fulgurante et ce changement de statut et de dimension extraordinaires relèvent à la fois de dynamiques sociolinguistiques et de construction socio-politique. En effet, face au puissant latin, médium étranger jouissant exclusivement du statut de langue officielle, mais de plus en plus impopulaire et incomprise des masses, François Ier, a décidé d’officialiser le français qui s’était imposé comme la principale langue véhiculaire du royaume à travers les ordonnances de Villers Cotterêts de 1537 et de 1539. Cette décision historique audacieuse marque un tournant décisif dans l’évolution fulgurante de la langue à travers les âges et les lieux. Toutefois, il faut bien noter que, plus qu’une simple progression, le développement du français a plutôt suivi une tendance hégémonique en France et hors de la France. Cette tendance relève en partie du fait que le français, en se substituant au latin, a pris les mêmes fonctionnalités et les bases glottophagiques qui ont fondé ce dernier (langue de symbole de la colonisation de Rome). Ils s’y ajoutent les fortes idéologies socio-politiques qui ont été inculquées à la langue par différents régimes en France et dans les colonies : Langue-Nation, langue symbole du rayonnement de la monarchie, langue de l’élite, langue du colon, langue symbole de l’unité de la monarchie, de l’empire et plus tard de la République…, autant d’idéologies qui lui ont collé l’étiquette d’une langue d’assimilation.
C’est ce rapport qu’au cours de son évolution hégémonique, en France et hors de la France, ce modèle d’imposition du français a participé à écraser des langues et des cultures en imposant un monolinguisme à des contextes pourtant très multilingues (France, Afrique…). Fondé et bâti sur le mythe du « un » et la phobie du « plusieurs », il a favorisé des formes de dichotomisation sociale en promouvant un usage unique, le plus souvent élitiste, en écartant les usages autres. C’est ce qui fait dire justement à Feussi (2020) que le français est une langue historiquement insécurisante. Ces considérations donnent toute sa pertinence ainsi la création de la Francophonie.
Sur les ruines du monolinguisme, la Francophonie pour un nouveau partenariat linguistique, culturel…
Mise en place à la fin de la colonisation en Afrique à travers un processus dont les bases ont été mises en place en 1970 à Niamey avec la création de l’ACCT, la Francophonie, indépendamment de ces bases géopolitiques et économiques, s’est résolument inscrite dans une dynamique de déconstruction et reconstruction : déconstruction les tendances exclusives et élitistes liées à la langue française dans le contexte hexagonal et hors de l’Hexagone, construction d’un nouveau partenariat linguistique entre le français et les autres langues avec lesquelles il est en cohabitation dans différents contextes (africaines, asiatiques et français). Il s’agit, en somme, sur les ruines du monolinguisme artificiel, déformateur, ségrégationniste, idéologiquement imposé, d’offrir la possibilité au français de transiger de manière complémentaire avec d’autres langues et d’autres cultures, de s’enrichir et d’enrichir au “rendez-vous du donner et du recevoir”. Ce nouveau partenariat linguistique permet ainsi, au moyen de la langue commune devenue multicolore, de bâtir des ponts pour une meilleure circularité des connaissances, des espaces d’échanges pour faire transiger les cultures dans leur grande variété et richesse, pour aménager des espaces de dialogues permettre aux peuples de s’enrichir de leurs communes différences.
Tout récemment en 2023, l’inauguration de la cité internationale de la langue française Villers Cotterêts par Emmanuel Macron s’inscrit dans cette même dynamique. Il s’agit d’une part de commémorer cette décision hautement audacieuse de François Ier qui fut un tournant décisif dans l’aventure extraordinaire de la langue française, de faire de ce lieu, le château de Villers Cotterêts, un lieu symbolique de la Francophonie, un creuset de brassage et de dialogue culturel pour plusieurs pays et plusieurs continents autour du socle commun que constitue le français.
Ce nouveau positionnement d’ouverture et d’inclusion offre une floraison de découvertes et de renouvellement et pour l’Afrique, des possibilités infinies de déconstruction et de reconstruction pour un changement de paradigme dans divers champs : littérature, linguistique, culture… Ces dynamiques nous intéresserons particulièrement à l’occasion du colloque de Saint-Louis.
Plurilinguisme/Multiculturalisme, la voie/voix de tous les possibles !
La dynamique intégrale qui se tisse dans et autour du français, langue fédératrice, ouvre-la voie/voix à l’éclosion des langues, des littératures, des cultures dans leur grande richesse, leur diversité et leur singularité. Il s’agit de libérer toutes les énergies dormantes dans une parfaite symbiose pour reprendre Senghor, pour mieux explorer et mettre à profit les potentiels multiples des Francophonies.
Un nouvel élan pour les langues minorisées (les langues africaines, les langues régionales, le français)
Pour les langues africaines longtemps minorées, l’heure est au renforcement et au développement. Partant des multiples travaux de description, de codification, d’outillage et de renforcement terminologique, ces langues sont en phase de devenir de véritables langues de développement capables de servir de véhicule aux politiques publiques. A ce propos, l’émergence et le développement de l’enseignement bi/plurilingue ouvrent des perspectives plus que prometteuses pour de nouveaux statuts : langue enseignée et langue d’enseignement, langue de développement et langue d’employabilité. En France et ailleurs, les langues régionales, longtemps menacées d’extinction, connaissent une relative reconnaissance à travers notamment des actions de promotion, d’enseignements et de diffusion. Par ailleurs, le français également a su s’adapter et se réinventer pour devenir aujourd’hui, grâce à la reconnaissance de tous les usages, une langue plus riche, plus colorée et plus inclusive. La mise en place du Dictionnaire des Francophones de même que le projet de la grande grammaire du français avec Anne Abeillé illustrent bien ces dynamiques inclusives. Ces changements de paradigmes notés pour les langues impactent les littératures africaines.
Brûler la bibliothèque coloniale, réécrire l’histoire de l’Afrique et du monde, relier les îles artificiellement créées par le pont de la langue !
Parmi les pancartes brandies lors des manifestations du Black Lives Matter, on en a vu arborant les trois lettres RMF. C’est en mars 2015 que le mouvement Rhodes must fall (RMF) débute au campus social de l’Université du Cap en Afrique du Sud dans laquelle se trouve une statue à l’effigie de Cecil Rhodes (1853-1902). Les étudiants qui identifient C. Rhodes à une figure archétypale du colonialisme voient dans sa statue une revalorisation du fait colonial dont il faut déboulonner tous les piliers. L’écho de la littérature est sonore, prolongeant les suites d’un procès entrevu depuis la « trahison » de L’Enfant noir. Le héros de La plus secrète mémoire des hommes, Diégane Latyr, clarifie la rancune des écrivains de sa génération : « Nous déplorons que certains d’entre nos anciens aient versé dans les négreries de l’exotisme complaisant » (Sarr, 2021, p. 49) au lieu d’engager l’inévitable débat. Il s’agit plus que jamais de liquider l’affaire coloniale pour faire découvrir l’Afrique et toutes les anciennes colonies dans leurs divers(c)ités ethniques, religieuses, linguistiques. Ainsi, devenus citoyens du monde et parfois s’exprimant loin du continent, de nombreux auteurs africains, cosmopolites et polyglottes, cherchent à représenter l’Afrique au monde et le monde aux Africains. Mais, il s’agira aussi d’interroger le devenir du continent et du monde face à l’urbanité galopante, mais surtout, face à l’avènement de l’intelligence artificielle.
Urbanité, expressions urbaines en francophonie
La ville se pare et se parle à travers de foisonnantes récupérations et réinventions sémantiques. La francophonie s’est toujours nourrie des parlers urbains aussi inattendus que inspirants. Il s’agira d’en interroger les orientations actuelles et les enjeux qu’elles soulèvent en creux dans un processus de mutations très rapides qui mettent en jeu l’altérité, le métissage, l’hybridation, la mobilité, les nouvelles formes de communication, les arts modernes etc.
Intelligence artificielle et analyse littéraire : quel avenir envisager ?
Avec quel moi se fera l’interlocution littéraire quand les algorithmes seront de « l’autre côté » de la page ? La part de l’intelligence artificielle dans l’avenir de la critique littéraire se pèse dès à présent. Ceci tuera-t-il cela ? ou encore quelle sera la part de marché de l’Humain dans divers champs de compétences des sciences humaines et sociales ? Quels sont les opportunités et les dangers liés au développement de l’IA dans nos différentes disciplines : linguistiques, traduction, littérature, critique, enseignement ? Ou encore comment gérer la question de la propriété intellectuelle dans un tel contexte. Plus que jamais, avec l’avènement de l’IA l’idée selon laquelle le monde est un village planétaire est plus qu’une réalité Le colloque de Saint-Louis sera ainsi l’occasion de (re)visiter à travers des approches variées, disciplinaires, pluridisciplinaires et interdisciplinaires ces différentes questions et problématiques qui font sens et signifient particulièrement dans la Francophonie. Ancienne ville coloniale, capitale de l’AOF, ville multiculturelle, multiethnique et multiraciale, ville multilingue où Jean Dard a expérimenté depuis 1817 l’enseignement avec les langues africaines, Saint-Louis reflète bien ces différentes questions qui se cristallisent dans la thématique du colloque : Francophonies, divers(c)ités, polyphonies : comment habiter le monde en plusieurs langues ? Le colloque aura pour objectif d’interroger toutes les attitudes, pratiques et initiatives permettant de promouvoir la diversité dans les diverses cités francophones, d’offrir la possibilité à toutes les voix de la Francophonie et du monde de résonner à travers des voies multiples et complémentaires.
Bibliographie indicative : Beniamino Michel. La francophonie littéraire. Essai pour une théorie. Paris : L’Harmattan, 1999 LAYE, Camara. 2007 (1re éd. 1953). L’Enfant noir, Pocket. 224 p. (ISBN 9782266178945) Daff, Moussa. 2009. « Dialogues des cultures, diversités linguistiques et culturelles et migrations dans un contexte de mondialisation ». Conférence internationale sur le Dialogue des civilisations et la diversité culturelle, OIF et l’ISESCO, Kairouan, Tunisie. Daff, Moussa. 2008, « L’enseignement du français et des langues partenaires en Afrique ». In Jacques Maurais, Pierre Dumont, Jean-Marie Klinkenberg, Bruno Maurer, Patrick Chardenet, L’avenir du français. Editions archives contemporaines et Agence Universitaire de la Francophonie, p105-110. Feussi, Valentin et Lorilleux, Joanna. 2020. (In)sécurité linguistique en francophonies Perspectives in(ter)disciplinaires. Paris : L’Harmattan. Gerald, Antoine et Cerquiglini, Bernard (eds), Histoire de la langue française 1945-2000 Lagab Nacerddine. « La littérature francophone africaine, une littérature mondiale en langue française. Le cas d’Alain Mabanckou ». Synergies Afrique des Grands Lacs, n°10, 2021, pp. 27-52. Lievois Katrien et Verstraete-Hansen. 2022. « La littérature francophone subsaharienne en traduction : propositions pour l’étude de la circulation d’une littérature ‘’semi-centrale’’ ». Meta, Vol. 67, n°2, pp. 297-320. Proust, Marcel. 1954. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard. Riffard, Riffard. 2006. « Francophonie littéraire : quelques réflexions autour des discours critiques ». Lianes, n°2, pp.1-10. Sarr, Mohamed Mbougar. 2021. La plus secrète mémoire des hommes. Paris : Éditions Philippe Rey. Walter, Henriette. 1988. Le français dans tous les sens. Paris : Robert Laffont Paris.
Axes thématiques : À titre indicatif, toutes les contributions en lien avec les axes suivants seront attendues : 1. Langue française et imaginaires des peuples ; 2. Multilinguisme et plurilinguisme ; 3. Hybridité et métissage en langue, en esthétique ; 4. Description et dynamique des langues en francophonie ; 5. Ecritures de/sur l’Afrique, configuration des possibles ; 6. Lectures africaines de la bibliothèque coloniale ; 7. Langue, littérature, marge, inclusion ; 8. Ecriture et création féminine en contextes francophones ; 9. Langue française, écriture et transgression ; 10. Intelligence artificielle et analyse littéraire : la mort du critique ?; 11. Anglicisation et Francophonie ; 12. Français de création et de recherche ; 13. Politique et aménagement linguistique en francophonie (perspectives nouvelles) ; 14. Urbanité : expressions urbaines en francophonie ; 15. Didactique du français en contexte multilingue… ; 16. Norme linguistique, institutions de langue, Francophonies ;
Hommage : A l’occasion de ce colloque, une cérémonie d’hommage sera organisée en l’honneur du Professeur Moussa DAFF dont la contribution intellectuelle et institutionnelle dans le cadre de la Francophonie est inestimable.
Langues du colloque : Français, wolof et pulaar
Propositions de communication Les propositions de communication accompagnées d’une notice bio bibliographique (en français ou en anglais ou encore en arabe) devront comporter des indications sur : – l’auteur (nom et prénom(s), rattachement institutionnel, email) ; – l’axe thématique choisi ; – le titre de l’article ; – un résumé de 200 à 250 mots ; – les mots clés (4 ou 5 mots au maximum).
Elles devront être déposées sur le site du colloque : Francophonies, divers(c)ités, polyphonies : comment habiter le monde en plusieurs langues ? – Sciencesconf.org
Contact : colloquefrancophonie@ugb.edu.sn
Calendrier
Date de lancement de l’appel : 16 décembre 2024 Date limite de soumission des propositions de communications : 28 février 2025 Réponses du comité scientifique : 28 mars 2025 Dates du colloque : 20, 21, 23 mai 2025
Inscription au colloque
Doctorant : 25 000 F CFA
Enseignant-chercheur, chercheur et professionnel : 50 000 FCFA
Organisateur : Département de Français, Université Gaston Berger de Saint-Louis du SÉNÉGAL Avec le partenariat de l’Institut Français à Saint-Louis du Sénégal
Comité scientifique Babou DIENE, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Boubacar CAMARA, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Kalidou SY, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Moussa DAFF, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar SÉNÉGAL Alexandre GEFEN, CNRS Paris France Cécile VAN DEN AVENNE, EHESS-Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris France Ndeye Maty PAYE, Université Banjul de la GAMBIE Banda FALL, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Fidèle DIEDHIOU, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Khadidiatou DIALLO, Université Gaston Berger de Saint-Louis, SENEGAL Birahim DIAKHOUMPA, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Modou NDIAYE, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar SÉNÉGAL Naima MENNOR, Université Hassan II de Casablanca, MAROC Magatte NDIAYE, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Djidiack FAYE, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Mamadou Abdoul DIOP, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Babacar MBAYE, Kent University, USA SENEGAL Fallou NGOM, Boston university, USA SENEGAL Ndiémé SOW, Université Amadou Moctar Mbow, Dakar SENEGAL Aly SAMBOU, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Pierre FRATH, Université de Reims, FRANCE Daouda DIOUF, Université Assane Seck de Ziguinchor SENEGAL Claire RIFFARD, CNRS, France Abou Bakry KEBE, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Abdelmounim El AZOUZI, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, MAROC Ibrahima SARR, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Abdelhak BOUAZZA, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, MAROC
1.5 50 years of Contemporary French Civilization (North Carolina State University)
Conference Call for Papers
50 years of Contemporary French Civilization
Our Plenary Speakers:
Carnegie Mellon University
Columbia University
September 26-27, 2025
North Carolina State University
College of Humanities and Social Sciences
Raleigh, North Carolina
Organizers: Daniel N. Maroun (Illinois) and Denis M. Provencher (NC State)
Since 1975, Contemporary French Civilization (CFC) has published cutting-edge research in the interdisciplinary field of French civilization and cultural studies; the journal has also expanded its scope to Francophone studies over the past decades. In 2022, we launched the companion journal, CFC Intersections related to publishing interdisciplinary scholarship on intersectionality and the broader related notion of intersections in French and Francophone Studies. In 2025, Contemporary French Civilization (CFC) turns 50 and we are pleased to launch a call for papers for the anniversary conference that will assess and position both the field and the journal(s) for the next 50.
As always, we invite conference papers in a variety of intersecting fields that examine contemporary socio-cultural topics in the French-speaking world. We encourage paper and session proposals on French-speaking topics in: anthropology and sociology, communication, cultural and literary studies, decolonial studies, food studies, history, international studies, memory studies, philosophy, psychology, postcolonial studies, religious studies, sports studies, translation studies, women, gender, and sexuality studies, and art, including music, dance, hip hop, film and media studies, and photography.
Possible themes that are of particular interest could include:
- The state of the field of contemporary French and Francophone cultural studies
- Unexplored avenues of research in traditional literary, cinema, or cultural studies
- New areas or avenues of research not commonly explored in Global French and Francophone Studies
- Transdisciplinary French and Francophone Studies
- New methodologies or transdisciplinary methodologies for the discipline or specific areas of interest (literature or visual art, linguistics, history, sociology)
- Interdisciplinary publishing today
- The changing landscape of academia and the place of contemporary French and Francophone cultural studies
- French and Francophone studies and STEM
- French and Francophone studies and the environment, business, healthcare, the climate crisis and migration, social work and social justice, public policy and practice, technology, well-being and belonging
- The work of interdisciplinary French and Francophone cultural studies to enhance and inform the work of other disciplines, to educate administrators, and to attract students. This could include how to help them understand the relevance of our fields in helping us all tackle:
-Real-world concerns and societal challenges of the 21st century
-(Social) Media narratives and storytelling of the 21st century
-(Virtual) (Hyper) realities and perspectives of the 21st century
Paper proposals (250 words maximum, in French or English, along with a brief bio-bibliography) and proposals for complete panels (strongly encouraged) should be sent by email to conference organizers Dr. Denis M. Provencher and Dr. Daniel N. Maroun at ContemporaryFrenchCivilization@gmail.com before April 15, 2025. For complete panels, please submit contact information and bio-bibliography for all participants.
1.6 Beyond the horizon(s): the Coexistence of Tradition(s) and Innovation(s) in French and Italian (IU-Bloomington, virtual and in-person)
CFP (virtual and in-person) Graduate Student Conference, IU-Bloomington
Beyond the horizon(s): the Coexistence of Tradition(s) and Innovation(s) in French and Italian
KEYNOTE SPEAKERS
Dr. Georgia Zellou, Dr. Ioana Vartolomei Pribiag, Dr. Ara Merjian
Le thème de la conférence explore la dynamique entre traditions et innovations. La tradition et l’innovation interagissent entre elles de diverses manières, parfois conflictuelles, incluant une émulation du passé, des contestations ou répudiations vis-à-vis de la tradition, mais également de la nostalgie et de l’hantologie (la présence persistante du passé qui hante le présent). Tandis que les phénomènes culturels se révèlent être un progrès plus complexe que simple, chaque innovation devient éventuellement tradition et suscite une réponse ou une réaction innovante.
Les sujets peuvent être variés, allant de l’exploration d’innovations du passé (au Moyen-Âge, Renaissance, Baroque ou à l’ère moderne) et de leur relation avec la tradition, à l’analyse d’une œuvre ou d’un genre mobilisant une approche théorique traditionnelle ou innovatrice. Nous accueillons des projets interdisciplinaires et interculturels qui concernent le monde artistique et littéraire français et/ou francophone (africaine, caraïbe, canadienne, etc.) Les projets ou présentations peuvent porter sur différentes disciplines comme la critique littéraire, l’histoire, la théorie, la géocritique, l’étude des médias (film, bande-dessinée, jeu vidéo, etc.), l’étude sur les migrations, etc.
La conférence se déroule du vendredi 4 avril au samedi 5 avril 2025. Elle est ouverte à tous les chercheurs (plus avancés, doctorants, étudiants en master, etc.) La présentation de 20mn peut se faire en anglais ou en français. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, (et qui vivent en dehors des Etats-Unis) il y aura la possibilité d’organiser un zoom.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par email (auhalley@iu.edu) Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre abstract ou proposition (300 mots) avant le 25 février 2025.
IMPORTANT DATES
Paper submission deadline 25 FEBRUARY 2025
Notification(s) of Acceptance 1 MARCH 2025
Conference Held 4-5 APRIL 2025
SUBMISSION INSTRUCTIONS
Attach your document as EITHER a PDF or DOCX
In the body of your email, please attach 5 keywords to describe your submission.
Abstracts are to be no more than 300 words (references / figures do not count towards this total).
EMAIL SUBMISSIONS
auhalley@iu.edu (Audrey)
1.7 ASMCF Annual Conference 2025 (University of Kent)
ASMCF Annual Conference 2025
Call for papers
University of Kent
Canterbury Cathedral Lodge, 2-3 September 2025
Nomadismes
*Version en français ci-dessous
The 2025 ASMCF annual conference will seek to explore the concept of Nomadism(e)(s), from a wide a range of critical perspectives. The basic premise is that Nomadisms, in the form of wanderings, migrations, peregrinations, displacements, transgressions, play a key role in shaping our experiences, identities, and cultures.
The theme builds on the transgressive, transcendental, transformative, intersectional dimensions of last year’s conference on transnationality and interrogates displacements (voluntary and involuntary, directed and random, concrete and conceptual, physical and moral, conscious and unconscious, fluid, transgressive and contestatory), as means of understanding modern and contemporary French and Francophone cultures and identities.
This year’s conference, hosted by the University of Kent’s School of Cultures and Languages, will take place in Canterbury Cathedral Lodge, within the grounds of Canterbury Cathedral. Canterbury, as a major ecclesiastical centre, has been for centuries a destination and starting and stopping-off point for pilgrimages, at the intersection of many pilgrims’ trails. That status derives from its location as the nearest British city to France, historically a major stopping-off point en route to and from Rome. Canterbury moreover is at the centre of a region that has been witness to the ongoing refugee crisis at first hand, but its status as place of sanctuary for refugees is not new: a community of Strangers, as Walloons and Huguenots were known, was established in the 16th century, and the cathedral crypt has for many centuries been the gathering place of a French-speaking congregation which still meets weekly.
Suggested topics include, but are not limited to:
Pilgrimages
Peregrinations (real and narrative)
Divagations, Navigations, Vagabondages
Quests, Recherches
Centre and margins/ Centre et marges
Colonial wanderings
Meanderings
Migrations
Postcolonial identities
Fluidity and hybridity
Refugees
SDF
Limbo
(Religious, Political, Ethical) Dissent
Transgression
Nomadisme(s) in literary, visual, plastic and performance arts
Hospitality to strangers/travellers/pilgrims/wanderers
Narrative péripéties and digressions
Journeys/pathways of care
End-of-life journeys/travel
Accessibility/Mobility, Transport
Contagion
Legislative journeys/navigations
Down the (virtual) rabbit hole
Travel narratives
Journeys of discovery
Psychoanalytical journeys
(Psychedelic, pharmacological) Trips
Psychogeography
Flânerie
Dérive(s), Deviations
Tourism
Transnationalisms
Intersectionalities
Shifting identities
Nomadisme et sédentarisme
Les nomadismes selon Foucault, Deleuze, Guattari, Stiegler (et autres)
La condition nomade, Civilisations nomades
We welcome proposals for these and other topics post-1789 (in history, literary, cultural and post-colonial studies, film and media studies, medical humanities and the political and social sciences) relevant to the conference theme. Contributions can be in either French or English. Contributions from postgraduate students are especially welcome, please indicate if you would like to be considered for a bursary.
The Association encourages proposals for complete panels (of 3 or 4 speakers). These should include the names, affiliation and e-mail addresses of all speakers. One individual involved should be clearly designated as the proposer with overall responsibility for the proposed session. As well as a 250-300-word abstract for each speaker, proposals should contain a 300-word outline of the rationale for the proposed panel.
In exceptional circumstances (sustainability issues or visa issues) online presentations may be accepted, please indicate it in your proposal.
Please send proposals for 20-minute papers (250-300 words) to the conference officer Cécile Guigui at nomadismesasmcf@gmail.com by 14 February 2025.
Confirmed Keynote:
Scriptwriter, Fanny Robert
Prof. Steven Wilson (QUB)
We are exploring options for additional sessions and networking opportunities for PGR attendees.
Appel à Communications
Université du Kent, Royaume-Uni
Canterbury Cathedral Lodge, 2-3 Septembre 2025
Nomadismes
Le congrès annuel de l’ASMCF 2025 cherchera à explorer le concept de Nomadisme(s), à partir d’un large éventail de perspectives critiques. Le postulat de base est que les nomadismes, sous la forme d’errances, de migrations, de pérégrinations, de déplacements, de transgressions, jouent un rôle clé dans la formation de nos expériences, de nos identités et de nos cultures.
Le thème s’appuie sur les dimensions transgressive, transcendantale, transformative et intersectionnelle de la conférence de l’année dernière sur la transnationalité et interroge les déplacements (volontaires et involontaires, dirigés et aléatoires, concrets et conceptuels, physiques et moraux, conscients et inconscients, fluides, transgressifs et contestataires), comme moyens d’appréhender les cultures et identités françaises et dans l’espace francophones modernes et contemporaines.
La conférence de cette année, organisée par le département des cultures et des langues de l’université du Kent, se tiendra au Canterbury Cathedral Lodge, dans l’enceinte de la cathédrale de Canterbury. En tant que centre ecclésiastique majeur, Canterbury est depuis des siècles une destination et un point de départ et d’arrêt de pèlerinages, ainsi qu’à l’intersection de nombreux chemins de pèlerinage. Ce statut découle du fait que Canterbury est la ville britannique la plus proche de la France, une étape importante sur la route de Rome. Canterbury se trouve en outre au centre d’une région qui a été le témoin direct de la crise actuelle des réfugiés, mais son statut de lieu de refuge pour les réfugiés n’est pas nouveau : une communauté d’étrangers, comme on appelait les Wallons et les Huguenots, s’est établie au XVIe siècle, et la crypte de la cathédrale est depuis de nombreux siècles le lieu de rassemblement d’une congrégation francophone qui se réunit encore chaque semaine.
Les sujets suggérés comprennent, mais ne sont pas limités à :
Pèlerinages
Pérégrinations (réelles et narratives)
Divagations, Navigations, Vagabondage
Vagabondages coloniaux
Quêtes, Recherches
Centre et marges
Errance
Migrations
Identités postcoloniales
Fluidité et hybridité
Réfugiés
SDF
État Flou
Dissidence (religieuse, politique, éthique)
Transgression
Nomadisme(s) dans les arts littéraires, visuels, plastiques et de la scène
Hospitalité envers les étrangers/les voyageurs/les pèlerins/les errants
Péripéties et digressions narratives
Voyages/parcours de soins
Voyages de fin de vie
Accessibilité/mobilité, Transport
Contagion
Voyages législatifs/navigations
« Tomber dans un terrier virtuel »
Récits de voyage
Voyages de découverte
Voyages psychanalytiques
« Trip » (psychédéliques, pharmacologiques)
Psychogéographie
Flânerie
Dérive(s), Déviations
Tourisme
Transnationalismes
Intersectionnalité
Identités mouvantes
Nomadisme et sédentarisme
Vagabondages
Les nomadismes selon Foucault, Deleuze, Guattari, Stiegler (et autres)
La condition nomade, Civilisations nomades
Nous accueillons les propositions sur ces sujets et d’autres thématiques postérieures à 1789 (en histoire, études littéraires, culturelles et post-coloniales, études cinématographiques et médiatiques, humanités médicales, et sciences politiques et sociales) en lien avec le thème de la conférence. Les contributions peuvent être en français ou en anglais. Les propositions des doctorants sont particulièrement bienvenues. Veuillez indiquer si vous souhaitez être considéré(e) pour une bourse.
L’Association encourage les propositions de panels complets (de 3 ou 4 intervenants). Celles-ci doivent inclure les noms, affiliations et adresses e-mail de tous les intervenants. Une personne impliquée doit être clairement désignée comme le/la proposante avec la responsabilité globale de la session proposée. En plus d’un résumé de 250 à 300 mots pour chaque intervenant, les propositions doivent contenir un résumé de 300 mots justifiant le panel proposé.
Dans des circonstances exceptionnelles (problèmes de durabilité ou de visa), les présentations en ligne peuvent être acceptées, veuillez l’indiquer dans votre proposition.
Les propositions de contribution individuelles de 20 minutes (250-300 mots) sont à envoyer à : nomadismesasmcf@gmail.com avant le 14 Février 2025.
1.8 Francophone Perspectives on New and Radical Forms of Care
Francophone Perspectives on New and Radical Forms of Care
Call for Articles
Edited by
Dr Adina Stroia (University of Leeds) and Prof Natalie Edwards (University of Bristol)
Recent global events have made extraordinary demands on our capacities for empathy and care at an individual and societal level. Precipitated by these developments, our increased awareness of the range of subject positionalities has given rise to affective and political responses which encourage empathetic responses and urge us to learn how to be attentive to and to care for others. And yet, despite such encouragements, we see limitations to what this call to embracing arms seems to propose as well as a potential hollowness. Affective saturation could become a risk. In our attempts to care for everyone, we may in fact care for no one. If seen and felt as a sufficient gesture, putting ourselves in someone else’s shoes may actually prevent us from taking the steps necessary to actively care and then (re)act. The question of empathy and care, we propose, may also be one of translatability for representation can often be a barrier. We may understand and empathize with and care for a particular case but not understand the factors subtending it which may replicate in environments proximate to ours and in which we may generate more immediate effect.
This special issue is not simply concerned with generative forms of care but also wishes to pay special attention to forms of recognition. Our ever-developing precarious situations in the face of a structural lack of care reveal the interconnectedness of vulnerabilities. ‘Radical care’ as care which is ‘fluid and adaptable’ (Lynne Segal) to new contexts would be deployed in full awareness of these entanglements. How has care then already reconfigured itself within these limitations? What new and radical forms do these limitations create? We want to turn our and your attention to what we describe as ‘infra-care’, since the crisis of care happens at a micro-level as well and then propagates, often with seismic force and to drastic consequences. We propose ‘a gestuelle du care’ that could take on a myriad of forms, from the microscopic to the macroscopic scale that could benefit a healthy evolution of society and ensure a future for our endangered planet. We acknowledge a conceptual structure of empathy and care that consequentially moves from and through recognition, attention, action, and reflection.
The proposed special issue draws on a kaleidoscopic understanding of care as refracted through the lenses provided by multiple thinkers, including Pascale Molinier’s definition of care as ‘ne peut pas ne pas’, Sandra Laugier’s understanding of care ‘as attention to ordinary life’ and Joan Tronto’s proposal that ‘we can recognize care when a practice is aimed at maintaining, continuing, or repairing the world’. ‘L’ethique du care’ has overall proven resistant to translation in a Francophone context and has thus maintained a transnational dialogue that invites us to reflect on its evolving dynamics and its position at the intersection of interdisciplinary studies. This special issue proposes to bring into dialogue voices that question and expand the limits as well as the limitations of a politics of empathy and care while looking at its newly acknowledged and future forms by asking a series of structuring questions:
o How have the limitations imposed on care generated new or radical forms of care?
o Does empathy and the provision of care in the form of sustained attention hinder structural change?
o How does care translate at a micro and macro level?
We invite proposals for articles that engage with the contemporary Francophone realm and pertain to the spheres of literature, visual art, film, philosophy, critical theory, activism, and beyond. Below, we offer a series of themes and questions which we wish to open out in this special issue. The list serves as a springboard yet it proposes by no means to be exhaustive and we invite proposals following lines of thought outside the ones listed below. If your article does engage directly with one or more of the strands listed, please feel free to indicate this in your abstracts.
L’éthique du ‘care’ in France : translation and translatability
Negative affect in care relations
Queer kinship, family abolition and the provision of ‘radical care’
Reconfiguring understandings of (after)care in BDSM contexts
Temporalities of empathy and care
Care in the workplace
Spaces of empathy and care as lieux de mémoire
The ‘nanny state’ and government intervention
Parenting, childlessness, and (self)-care
Caring for the environment
Please send an abstract (in English or French) of 300-400 words and a short biography of 100-150 words to both Dr Adina Stroia (a.stroia@leeds.ac.uk) and to Prof Natalie Edwards (natalie.j.edwards@bristol.ac.uk) by 9 February 2025.
1.8 Alice Diop’s Cinema: (Re)formulating the Real (Duke University)
Appel à communications
Le cinéma d’Alice Diop : (Re)formuler le réel
Center for French and Francophone Studies
Duke University
11 avril 2025
En présence d’Alice Diop
English version to follow.
Ces cinq dernières années, Alice Diop s’est imposée comme une figure majeure du cinéma mondial. Le passage du documentaire à la fiction, dont témoigne son plus récent film Saint Omer (2022), lui a permis de remporter un succès considérable aussi bien auprès du grand public que des critiques et des universitaires. Au cours de cette première journée d’étude entièrement consacrée à l’œuvre de la réalisatrice, qui sera des nôtres pour l’occasion, nous souhaitons aborder les différents enjeux politiques, sociétaux et cinématographiques de son travail, ainsi que le dialogue intermédial et transatlantique dans lequel il s’inscrit. À travers une approche théorique plurielle, il s’agira de questionner la construction du regard et la responsabilité éthique engendrés par une telle entreprise.
Voici une liste de pistes d’étude non restrictive :
- Espaces, identités et migrations
- Les lieux explorés dans les films de Diop s’opposent à la violence hégémonique en faisant place aux voix et corps diasporiques ou issus de diasporas, plus particulièrement africaine et maghrébine (La Permanence). Au prisme de points vues multiples, de narrations fragmentées, son œuvre cinématographique dévoile les inégalités créées par les partages territoriaux (Nous). L’exclusion économique, géographique et raciale est donnée à voir comme intrinsèquement liée à l’organisation des structures urbaines dans lesquelles les personnages réels et fictionnels de Diop tiennent des postures à la fois marginalisées socialement et esthétiquement omniprésentes. L’habitation des lieux, l’occupation de l’image, la reconfiguration des espaces du cinéma témoignent d’un désir de circulation libre et égalitaire.
- Faits, fictions et subjectivisation
- L’approche documentaire de Diop ne cesse de jouer de la distance et des échelles dans son approche de la subjectivité et du contact humain. Dans Saint Omer, elle questionne ainsi la possible adaptation d’un fait divers à travers un brouillage des frontières entre réel et fiction. Son cinéma déploie diverses stratégies d’hybridation, telle l’autocitation présente à travers ses courts et ses longs métrages. En intégrant également des archives personnelles et familiales aux références journalistiques, Diop déhiérarchise les sources historiques.
- S’inscrire dans l’histoire : « le goût de l’archive »
- Les films d’Alice Diop affirment une volonté d’inclusion qui passe par une nécessité de représentation et surtout de reformulation singulière et collective. Son cinéma fortement marqué par une dimension politique et éthique appelle non seulement à une déconstruction de l’espace mais aussi à une négociation du temps, de l’histoire et des archives. Le public est confronté à l’inscription de l’altérité comme processus essentiel de la possibilité d’une histoire et d’une culture communes.
- Littérature et filiations
- Que ce soit dans l’héritage de Michel Leiris, de François Maspero, de Marguerite Duras, de Pierre Michon, ou encore sa collaboration avec Pierre Bergounioux dans Nous, Diop inscrit son cinéma au sein de la littérature de langue française. Toutefois, les filiations directement ou indirectement revendiquées portent les traces d’une circulation transatlantique et d’une volonté de déplacement du canon. Les liens entre le travail de Diop, l’afro-féminisme en France et les féministes noires américaines dont elle cite l’influence, Robin Coste Lewis, Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw, bell hooks ou Audre Lorde, sont révélateurs d’une vision qui ne saurait être limitée aux dichotomies usuelles et qui se fait véritable opératrice de traduction.
- Une caméra féministe
- L’œuvre d’Alice Diop permet de penser le cinéma comme technique de transmission d’un savoir situé tel que l’ont articulé les philosophies féministes, notamment Donna Haraway. Les techniques qui sont employées dans son œuvre, particulièrement la voix hors-champ de la réalisatrice qui rend sensible les modulations de ses questions (Vers la Tendresse et La Mort de Danton), permettent un passage de la théorie à l’incarnation cinématographique. Nous cherchons donc à comprendre de quelle manière les différentes caractéristiques du savoir situé (le recours au témoignage, à l’anecdote, à l’intime et à la critique des discours dominants) redéfinissent les pratiques audiovisuelles et narratives.
Prière d’envoyer vos propositions de communication avant le 1er mars 2025 aux adresses suivantes :
mathilde.savard-corbeil@duke.edu
Une décision vous sera transmise au plus tard le 10 mars 2025
Les frais de séjour et de déplacements devront être pris en charge par les participants et les participantes. Les repas de groupe seront fournis.
Call for Papers
Alice Diop’s Cinema: (Re)formulating the Real
Center for French and Francophone Studies
Duke University
April 11th, 2025
Over the past five years, Alice Diop has established herself as a major figure in world cinema. Her transition from documentary film to fiction, reflected in her most recent film Saint Omer (2022), was a critical, academic and popular success. In this first conference entirely dedicated to the work of the director, who will be joining us for the event, we aim to address the various political, societal and cinematographic issues at stake in her work, as well as the intermedial and transatlantic dialogue it both manifests and operates. Through an interdisciplinary theorical approach, we will question the construction of the gaze and the ethical responsibility engendered by such an undertaking.
The following is a non-restrictive list of topics and concepts:
- Spaces, Identities and Migrations
- The places explored in Diop’s films oppose hegemonic violence by making room for diasporic voices and bodies, particularly from Sub-Saharan Africa and the Maghreb (La Permanence). Through the prism of multiple viewpoints and fragmented narratives, her cinematographic work reveals the inequalities created by territorial divisions (Nous). Economic, geographic and racial exclusion are seen as products of urban structures, in which Diop’s real and fictional characters hold positions that are both socially marginalized and aesthetically omnipresent. The inhabitation of places, the occupation of images and the reconfiguration of cinematic spaces testify to a desire for free and egalitarian circulation.
- Facts, Fictions and Subjectivity
- Diop’s documentary approach never ceases to play with distance and scale in her treatment of subjectivity and human contact. Similarly, in Saint Omer, she questions the possible adaptation of a fait divers by blurring the boundaries between reality and fiction. Her cinema deploys various hybridization strategies, such as self-citation present in her short and feature-length films. By integrating personal and family archives to journalistic references, Diop de-hierarchizes historic sources.
- A place in History: “The Allure of the Archives”
- Alice Diop’s films assert a desire for inclusion, which requires representation and, above all, singular and collective reformulation. Her films, marked by a strong political and ethical dimension, call not only for a deconstruction, but also for a renegotiation of time, history and archives. Viewers are confronted with the inscription of otherness as an essential process in the possibility of a common history and culture.
- Literature and Filiation
Whether it’s through the claimed heritage of Michel Leiris, François Maspero, Marguerite Duras, Pierre Michon, or her collaboration with Pierre Bergounioux on Nous, Diop inserts her cinema within French and Francophone literature. However, directly or indirectly claimed filiations bear witness of a transatlantic circulation and a desire to displace the canon. The links between Diop’s work, Afro-feminism in France and the Black American Feminists whose influence she mentions, such as Robin Coste Lewis, Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw, bell hooks and Audre Lorde, reveal a vision that cannot be confined to usual dichotomies.
- A Feminist Camera
Alice Diop’s work allows us to think of cinema as a technique for transmitting situated knowledge, as articulated by feminist theorists, notably Donna Haraway. The techniques employed in her work, including the director’s voice-over, which reveals the modulations of her questions, enable the passing from theory to cinematic embodiment. We therefore seek to understand how the various characteristics of situated knowledge – i.e. the use of testimony, anecdote, intimacy and the critique of dominant discourses – redefine audiovisual and narrative practices.
Please send your proposals before March 1st, 2025, to the following emails:
mathilde.savard-corbeil@duke.edu
A decision will be made by March 10th, 2025, at the latest.
Participants’ travel and accommodations are at their own charge. Group meals will be provided.
1.9 Queer Creoles in French and Francophone Contexts (MLA 2026)
This panel explores queer language use across borders and cultural contexts, which includes, but is not limited to creolization, language accumulation, and translanguaging. This is a guaranteed session. Send 250-word abstract and bio by March 13, 2025 to Denis Provencher: dmproven@ncsu.edu
1.10 ReFocus: The Films of Nabil Ayouch
ReFocus: The Films of Nabil Ayouch
Edited by Siham Bouamer (University of Cincinnati) and Salim Ayoub (Webster University)
Call for chapter proposals
Deadline for proposals: 15 February 2025
Deadline for first draft of chapters: 15 October 2025
From Mektoub (1997) to Everybody Loves Touda (2024), Nabil Ayouch’s body of work offers a compelling lens through which to interrogate the sociocultural and structural dynamics of contemporary Moroccan society. His films engage with issues such as social and cultural alienation, sex work, poverty, and resistance and often focus on marginalized subjectivities that are rarely represented in mainstream media. Ayouch is also recognized for his social engagement, particularly through the Ali Zaoua Foundation or Les étoiles de Sidi Mimoun cultural center, where he creates cultural and educational opportunities for marginalized youth in Morocco. His efforts extend beyond social activism; Ayouch also plays a key role in advancing the Moroccan film industry. Programs like Ali N’Productions and Media Films Development focus on fostering local talent, but also supporting the growth and recognition of Moroccan cinema internationally. The filmmaker has long been a polarizing figure. While praised for pushing the boundaries of Moroccan cinema and addressing tough social issues, he also faces criticism for what some see as unrepresentative and exploitative portrayals of Morocco.
Despite the local themes of Ayouch’s films and the criticism of his work, the filmmaker has found considerable success on the global stage. Ayouch’s prominence in the film industry is evident through the international financial support his films have garnered. For instance, his most recent film, Everybody Loves Touda, is a co-production between Morocco, France, Belgium, Denmark, the Netherlands and Norway. The global appeal of Ayouch’s work is also reflected in its availability on global streaming platforms. Perhaps the most well-know example, Much Loved (2015), banned in Morocco for its controversial depiction of sex work, was sold to Netflix. Ayouch’s global success invites a deeper critical assessment of the factors shaping the reception of his films, whether domestically or internationally. It is certainly important to remain critical of the implications of his global reception, while at the same time recognizing the complexities of his transnational reach. For example, his work reveals a transnational dimension that transcends the postcolonial paradigm often associated with Moroccan cinema. Despite the filmmaker’s upbringing and direct connection with France and his forced association with a constructed and monolithic Arab homogeneity, he challenges any confinement to oversimplified cultural, national, and regional identities in his films.
This edited volume aims to bring together a collection of interdisciplinary scholarly essays that examine various aspects of Ayouch’s work. We invite scholars to submit proposals that explore the diverse thematic, aesthetic, and production dimensions of Nabil Ayouch’s cinema, with particular attention to his transnational approach and its implications for both Moroccan and global cinematic landscapes. In addition to his directorial achievements, we are also interested in his contributions as a producer and writer, particularly in collaborative projects with filmmaker Maryam Touzani. Topics may include, but are not limited to:
- Social realism in contemporary Moroccan cinema
- Cultural identity and hybridity
- Urban spaces and marginality
- Cinema as social commentary
- Resistance and resilience
- Creativity and social change
- Intersections of religion and society
- Gender dynamics
- Sexuality and queerness
- Youth and education
- Cinematic technique and style
- Global perspectives and international co-productions
- Ethics of representation in filmmaking
- Production and distribution
- Transnational and global impact
- Transnational solidarity and resistance
- The politics of language and multilingualism
- International film festivals
- Belonging and displacement
- Decolonial and postcolonial criticism
Please send a 450-word proposal to Siham Bouamer (bouamesm@ucmail.uc.edu) and Salim Ayoub (salimayoub@webster.edu) by February 15, 2025. Accepted proposals will be notified by March 1. The first draft of chapters will be due on October 15, 2025. The volume will be published by Edinburgh University Press in the ReFocus series on international directors. Series editors are Robert Singer, Gary D. Rhodes and Stefanie Van de Peer.
1.11 ‘My Kingdom for a Frame!’: Contextual Dilemmas in French and Francophone Studies (Kings College, Cambridge)
‘MY KINGDOM FOR A FRAME!’
CONTEXTUAL DILEMMAS IN FRENCH AND FRANCOPHONE STUDIES
CAMBRIDGE FRENCH GRADUATE CONFERENCE
CALL FOR PAPERS
King’s College, Cambridge – 22nd April 2025
Keynote: Dr Doyle Calhoun (Cambridge)
The recent history of criticism illustrates a deep love — and contempt — for the contextual analysis of culture, be this textual, visual, theatrical, or social. Consistently, historical and political modes of reading have been confronted by what literary theorists Wimsatt and Beardsley describe as the ‘intentional fallacy’; or, by a ‘hermeneutics of suspicion’ first inspired by Paul Ricœur’s readings of Marx, Freud and Nietzsche, and echoed by Louis Althusser’s ‘lecture symptomale’.
In nineteenth-century France, we witness myriad attitudes towards the relationship between art and context: most famously, critic Sainte-Beuve proposes biographical criticism as a sure means of finding an author’s intention, a method Marcel Proust rejects in his celebrated book of essays, Contre Sainte-Beuve. In the twentieth century, Julia Kristeva argues that art in general, and narrative in particular, are essentially revolutionary, as they overthrow authoritative discourses. In an attempt to emancipate the former from the latter, Kristeva’s Tel-Quel colleague Roland Barthes famously questions the relation between artwork and author.
From D.H. Lawrence’s instruction to trust ‘tale’ and not ‘teller’ through to I. A. Richards’ Practical Criticism and Susan Sontag’s Against Interpretation, the anglophone world also plays host to contextual debates of all kinds. In historiography, the ‘contextualist’ approach of ‘Cambridge School’ historian Quentin Skinner questions the hermeneutic frameworks proposed by post-structuralism (Foucault) and deconstruction (Derrida) to assert that we can salvage authorial intention from even the remotest of texts.
More recently, the enquiry continues. Bruno Latour introduces his ‘Actor-Network-Theory’ with a dialogue between a student and a professor, who explains that context is ‘simply a way of stopping the description when you are tired or too lazy to go on.’ Questioning how literary critics use context, Rita Felski quotes Latour’s evocation of architect Rem Koolhas: ‘Context stinks!’ Building on these insights, Michaela Bronstein highlights criticism’s discomfort towards the transtemporal persistence of art.
However, in our contemporary conjuncture of far-right relativism and contingent universalism, a new question arises: in periods of crisis, is context necessary? Since the appearance of the novel, and in particular the roman psychologique (Mme. de La Fayette), through to the surge, in the early 1980s, of so-called ‘beur fiction’ (Mehdi Charef), and more recently texts engaged with diverse social experiences (Édouard Louis, Alice Zeniter, Tal Madesta), is it possible to think without context? Should we want to? What would happen if we tried?
We invite postgraduate students (PhD, Master’s etc.) to consider these themes with reference to the full range of historical time periods covered by French and Francophone Studies. The question of context is manifold, as is its timeline, and we invite you to interpret it broadly: methodological inquiry, textual analysis, critical, political, historical, and social readings are all welcome.
In addition to those introduced above, papers may consider (but are not restricted to) the following topics:
- Ideology in literature/art
- Tensions between contexts/areas/focuses
- Problems in methodology: clashes, rifts, discrepancies
- Historicism versus trans-historicism
- Literary theory as political thought
- Contexts of contemporary crisis: rethinking practice
- Indifference and disregard
- Spatiality, powerlessness, political writing and résistance
- Economies of ignorance/knowledge
Abstracts of no more than 250 words should be submitted via the following Google Form by midday on the 3rd of March, 2025: https://forms.gle/hdZYwWkjg98ygjSb9
If you have any questions please get in touch with the convenors (Maddison Sumner, Tobias Barnett and Duarte Bénard da Costa) at cambridgefgc2025@gmail.com
1.12 Movement (University of South Carolina)
7th Annual “Cultural Carolina” Graduate Student Conference
Languages, Literatures and Cultures’ Graduate Student Association (LLCGSA)
Department of Languages, Literatures and Cultures
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA
“MOVEMENT” (April 3-4, 2025)
Call for Papers – Extended deadline: Feb. 10th, 2025
A sign of modernity, movement illuminates the multifaceted dynamics of change across time, space, and identity. From transportation, communication, capital flow, gender fluidity, labor migration, diaspora movement, technology innovation, to broader historical transformations and social-political movements, we are surrounded by changes every day in our life. Consciously and unconsciously, we become a “different person” as we experience these movements both on the individual and collective level. Our identity is shaped by the change and exchange of moving experiences, and by doing so, we are ready to embrace the new realities. This raises questions: how does movement shape collective/individual memory and identity? How does adaptation or resistance to movement influence our life? How is the movement historically and concurrently connected to global modernization? And how is this experience represented in literary, artistic, and other works?
The Annual Graduate Student Conference of the DLLC GSA aims to bring together voices from interdisciplinary fields to explore the dynamic experience of movement in relation to global modernity and the formation of subjectivity. We invite academics, students, artists, and activists to engage in this dialogue. Participants are encouraged to think about the topics across disciplines such as literature, linguistics, languages, history, music, women’s & gender studies, cultural studies, sociology, biology, psychology, philosophy, etc.
Possible topics include but are not limited to:
- Global capitalism movement
- Mass communication movement
- Urbanization and rural-urban movement
- Cosmopolitan identities
- Domestic and transnational migration
- Colonial and post-colonial movement
- Gender movement
- Labor migration
- Migration and memory
- Health and epidemic movement
- Movement and form in literary and art history
- Spiritual movement
- Technology movement
- Food and culinary journey
If you would like to participate in the conference, please send a 250-word abstract and a short author biography to Clyde Tilson, chtilson@email.sc.edu by Feb 10th, 2025. For panels, please submit a 250-word abstract for the panel and an abstract for each paper in the panel. Please put “Graduate Student Conference 2025” in the email subject. Papers will be accepted in English only.
1.13 Conditions (King’s College London)
CONDITIONS
Society for French Studies
Postgraduate Conference 2025
Friday 30th May 2025
King’s College London
Keynote: Dr Sophie Marie Niang (University of Cambridge)
Call for Papers
This year’s Society for French Studies Postgraduate Conference invites Master’s and doctoral students to reflect on the theme of ‘conditions’. Held annually, this conference offers postgraduates the opportunity to share and discuss research-in-progress with a supportive and collaborative audience. Contributions are invited from across the full (and ever-expanding) range of fields, disciplines, cultures, historical time periods and geographies that make up French and Francophone Studies today.
Papers will consider what it means to navigate ‘conditions’ and the diverse senses conveyed by that term. Conditions might be understood as requirements, restrictions or contingencies: for example, as stipulations on which certain concepts or communities depend; or, alternatively, as factors that regulate futurity, historical understanding or political action. In the French and francophone context, therefore, conditions might recall the limits and exclusions of nation-building and Republican universalism; or, past and present debates around topics including citizenship, community, revolutionary change, (non-)violence, (de)colonisation and historiography. Conditions could also evoke the hypothetical or counterfactual; questions of information, communication and pedagogy; or, if understood in purely philosophical terms, the conditions of possibility. Contributions may wish to re-evaluate questions of epistemology, and particularly those regarding the production and mediation of knowledge by experience and/or reason.
Perhaps paradoxically, then, the immediate connotations of ‘conditions’ also stand for potential, and recall the generative value of cultural and linguistic study in French and Francophone Studies and beyond. Accordingly, contributions might direct their attention towards methodological or self-reflexive concerns. The ambivalence of conditions, explored above, could be examined as a symptom of tensions between theory and praxis; or, as a clarion call to rethink the structures, functions and responsibilities associated with academic inquiry.
Stretching across textual, visual, sonic and material cultures, the conference theme also invites papers interested in materiality, media and genre, as well as those wishing to address the interplay between conditions and technology, be this historical or contemporary. Linguistic approaches to the conference theme are also encouraged, including, for example, considerations of contact zones and the linguistic expression of power dynamics.
Further lines of enquiry may include:
- Conditions and the law
- Physical states and modes of being
- Creation, production and degeneration
- Conditions, discourse and linguistics
- Architectural conditions and the built environment
- Conditions and sociology
- Race and movement
- Conditions to community, belonging, freedom and liberation
- Discrimination and selective solidarity
- Medical humanities
- Disciplinarity
- Necessity versus contingency
- Moral conditions
- Bioethics and biopolitics
Presentations should be no more than 15 minutes in length and may be given in French or English.
The conference will be held in-person at King’s College London. The venue has step-free access. Registration and catering are free of charge. Students who are members of the Society for French Studies are eligible to apply for funding to help with transport costs. Speakers who are non-members are kindly asked to seek financial help from their own institutions to cover travel costs. Information about joining the Society (at a discount rate for postgraduates) can be found on our website.
To apply, please send an abstract (300 words max.) along with your name, institution (if applicable), and level of study to sfspg2025@gmail.com by 3 March 2025. After the conference, there will be the opportunity to publish papers in a special issue of French Studies Bulletin.
If you have any questions, including questions about accessibility, please do not hesitate to contact the organisers at the above address.
Organised by: Tobias Barnett and Airelle Amédro
CONDITIONS
Society for French Studies
Postgraduate Conference 2025
Vendredi 30 mai 2025, King’s College London
Keynote: Dr Sophie Marie Niang (University of Cambridge)
Appel à communications
Cette année, la Society for French Studies invite les étudiant.e.s de master et les doctorant.e.s à réfléchir de façon imaginative et critique au thème ‘conditions’. Ce colloque annuel sera l’opportunité de partager le travail de recherche de chacun dans un cadre collaboratif et bienveillant. Nous encourageons les communications couvrant toutes périodes historiques, zones géographiques et disciplines en lien avec les études françaises et francophones.
Nous invitons les participant.e.s à examiner ce que négocier différentes « conditions » implique ainsi que les divers sens véhiculés par ce terme. Ce dernier peut être compris comme faisant référence aux exigences et restrictions nécessaires à la création de concepts dont dépendent certaines communautés. En effet, dans le contexte français et francophone, la notion de conditions rappelle les limites et l’exclusion pouvant aller de pair avec l’universalisme républicain et l’édification de la nation. Ainsi, les communications peuvent réfléchir aux débats, présents et passés, autour de sujets tels que la citoyenneté, le changement révolutionnaire, la (non-)violence, la (dé)colonisation et l’historiographie. En ce sens, certaines conditions peuvent être pensées comme des facteurs façonnant notre compréhension de l’histoire et régulant la possibilité même de toute action politique ou de pérennité. De même, l’hypothétique, le contrefactuel, les questions d’information, de communication et de pédagogie invitent à l’étude des modalités et des circonstances qui les influencent. Compris de façon purement philosophique, le thème de la conférence peut également se prêter à l’analyse des conditions de possibilité. Les questions épistémologiques et plus particulièrement celles concernant la production et la médiation de la connaissance et du savoir par l’expérience et/ou par la raison peuvent s’avérer être une piste de recherche fructueuse.
De manière paradoxale, certaines conditions se révèlent être une source de création. Cette ambivalence permet aux participant.e.s d’interroger la valeur génératrice qu’ont les études culturelles et linguistiques ainsi que les approches méthodologiques et autoréflexives. Enfin, il est possible d’examiner cette ambiguïté comme symptômatique des tensions entre théorie et pratique ou comme un appel à repenser les structures, fonctions et responsabilités associées à la recherche universitaire.
Les conditions liées aux questions de matérialité, de médias et de genre, ainsi qu’à l’interaction entre conditions et technologie peuvent être examinées au travers d’études textuelles, visuelles, sonores et matérielles. Les approches linguistiques portées sur des sujets tels que les zones de contact et l’expression linguistique des dynamiques de pouvoir sont également encouragées.
Les pistes de recherche suivantes peuvent être envisagées :
- Les conditions et la loi
- Les conditions morales
- Les états physiques et les modes d’existence
- La création, la production et la dégénérescence
- Conditions, discours et linguistique
- Conditions et sociologie
- Conditions, architecture et environnement bâti
- Conditions, race et mouvement
- Conditions, communautés, appartenance, liberté et libération
- Formes de discrimination et de solidarité sélective
- Les humanités médicales
- La disciplinarité
- Nécessité versus contingence
- Les questions bioéthiques et biopolitiques
Chaque intervention durera 15 minutes, et les intervenant.e.s seront libres de présenter en anglais ou en français.
Le colloque aura lieu en présentiel à King’s College London et la participation sera gratuite, y compris le déjeuner. Les étudiant.e.s membres de la SFS pourront postuler à une bourse (Research Support Grant) pour les aider à couvrir leurs frais de déplacement. Nous conseillons aux participant.e.s non-membres de contacter leur institution pour couvrir ces frais. Toutes les informations nécessaires pour devenir membre (à prix réduit pour les étudiants) se trouvent sur le site de la SFS.
Pour candidater, veuillez envoyer une proposition de communication (300 mots maximum) accompagnée de votre nom, affiliation institutionnelle (si applicable), et niveau d’études à sfspg2025@gmail.com avant le 3 mars 2025. Après la conférence, les communications pourront être publiées dans un numéro spécial du French Studies Bulletin.
Si vous avez des questions au sujet de l’accessibilité, n’hésitez pas à contacter les organisateurs par email à sfspg2025@gmail.com.
Organisé par: Tobias Barnett et Airelle Amédro
1.14 Définir le “Corridor Créole” : Culture et identité le long du Mississippi (WashU, Saint-Louis, Missouri)
Appel à communications
Colloque : Définir le “Corridor Créole” : Culture et identité le long du Mississippi
Le Centre d’Excellence French Connexions de l’Université de Washington à Saint-Louis (WashU, Etats-Unis), en collaboration avec la French Heritage Society (FHS) et le Center for French Colonial Life, invite à soumettre des propositions de conférence pour son colloque sur la notion de “corridor créole”, et plus précisément sur la culture et identité créole en Haute-Louisiane, colloque qui aura lieu le 23 avril 2025 sur le campus de WashU.
Ce colloque interdisciplinaire vise à explorer le concept émergent de « Corridor Créole » — un vaste et dynamique carrefour culturel s’étendant du Québec à la Nouvelle-Orléans, le long du fleuve Mississippi. Ce corridor désigne un espace historique et géographique nord-ouest, effacé par le narratif de l’historiographie anglo-américaine qui a construit le mythe de la conquête de l’ouest, symbolisé à St. Louis (Missouri) par l’arche qui identifie notre ville (la “Porte vers l’Ouest“).
Notre colloque a pour objectifs de :
Définir le “Corridor Créole” comme cadre historique et culturel
Explorer les interactions et les identités, en mettant l’accent sur les dimensions raciales, genrées, linguistiques et ethniques de la culture créole.
Enquêter sur la manière dont les cultures juridique, économique, environnementale et matérielle ont façonné la vie créole le long de ce corridor.
Axes de recherche possibles, qui peuvent adopter une perspective littéraire, historique et/ou artistique :
Les interactions culturelles entre Amérindiens, personnes d’origine africaine, colons français et espagnols .
L’identité créole et son évolution en Haute-Louisiane, notamment à Sainte-Geneviève et Saint-Louis.
Le rôle du fleuve Mississippi en tant que carrefour commercial et culturel.
Les intersections du droit, de la langue, de la médecine, de la religion et de la culture matérielle dans la formation de la société créole.
Les connexions mondiales du Corridor Créole avec la vallée du Saint-Laurent, les Caraïbes et l’Europe.
Les facteurs environnementaux, tels que l’agriculture, le climat et les relations homme-animal.
Instructions pour les soumissions :
Les chercheurs de toutes disciplines sont invités à soumettre un résumé de 300 mots maximum, accompagnés d’une courte biographie, avant le 31 janvier 2025. Les propositions peuvent inclure des communications individuelles, des panels ou des ateliers. Les soumissions doivent être envoyées à Lionel Cuillé, à l’adresse lcuille@wustl.edu avec pour objet Corridor Créole French Connexions 2025.
Points forts de l’événement :
Lieu : Le colloque se tiendra à l’Université de Washington à Saint-Louis (WashU)
Opportunités de réseautage : Des chercheurs de France, du Québec et des grandes institutions américaines participeront à l’événement, favorisant la collaboration transatlantique.
Les participants auront la possibilité d’assister à la convention annuelle de la French Heritage Society le 24 avril 2025 (au même endroit) et seront invités le 25 avril à visiter l’ancien village de Sainte-Geneviève, fondé par les Français en 1764 (à une heure au sud de Saint-Louis, Missouri).
Organisateurs :
Peter Kastor, Professeur Samuel K. Eddy d’Histoire et d’Études Culturelles Américaines (WashU)
Elizabeth B. Allen, Professeur d’Enseignement de Français (WashU)
Lionel Cuillé, Directeur, Centre d’Excellence French Connexions (WashU)
Nathan Dize, Professeur Assistant de Français (WashU)
Nous remboursons l’hébergement pour deux nuits et la plupart des repas pour les chercheurs invités.
1.15 The Hospital in Contemporary French and Francophone Thought, Literature, Film and Visual Art
Call for Chapters for Edited Book:
THE HOSPITAL IN CONTEMPORARY FRENCH AND FRANCOPHONE THOUGHT, LITERATURE, FILM AND VISUAL ART
Edited by
Benjamin Dalton (Lancaster University) and Áine Larkin (Maynooth University)
The hospital has occupied a dynamic and generative position in French and Francophone cultural production. Whilst biomedical science has enjoyed an intimate, symbiotic relationship with French philosophy – from René Descartes’ interest in neurological approaches to the brain in the 17th century, to Georges Canguilhem’s analysis of the biomedical production of the “normal” in the 20th century, to Catherine Malabou’s philosophical engagements with neuroplasticity, brain trauma, and epigenetics today – the hospital occupies a similarly integral, if underexplored, position in French and Francophone cultural production. More recently, engagements with the hospital across thought, film and literature range from philosopher Michel Foucault’s influential critique of clinical space and biopolitical control in Birth of the Clinic (1963); to the Moroccan writer Ahmed Bouanani’s oneiric imagining of clinical landscapes in The Hospital (1989) and Franco-Ivarian writer Véronique Tadjo’s engagement with clinical spaces of the West African Ebola crisis from both human and non-human perspectives in En Compagnie des hommes; to engagements with hospital environments in documentary, from Nicolas Philibert’s look at the Clinique de la Borde psychiatric facility in Every Little Thing (1996) to Claire Simon’s Notre corps(2023)’s surveying of diverse patient narratives in a gynaecology department in Tenon hospital in Paris. French and Francophone documentary cinema has a longstanding interest in clinical spaces and the communities who inhabit and work within them, in films such as Raymond Depardon’s San Clemente (1980), Urgences (1987), and 12 jours (2017); Malek Bensmaïl’s Aliénations (2004); as well as La Moindre des choses (1996), Nicolas Philibert’sDe chaque instant (2019) and his very recent triptych Sur l’Adamant, Averroès et Rosa Parks (2024) and La Machine à écrire et autres sources de tracas (2024) examine clinical spaces and their communities. Maylis de Kerangal’s magisterial Réparer les vivants (2014) breaks new ground in its representation of the hospital; other literary works by Martin Winckler, Antoine Sénanque and Sophie TalMen, and graphic narratives such as Mahieux and Levitre’s Tombés dans l’oreille d’un sourd (2017) offer a wide variety of perspectives on medical professionals’ and patients’ lived experiences of care in hospitals. Across these diverse texts and contexts, the hospital figures at once as a site of both care and of violence; as a source of discovery and inspiration for thought, literature, film, and visual art; and as a physical architecture within which biomedical science and art come together.
This edited collection explores the relationship between the hospital and contemporary French and Francophone thought, literature, film and visual art today, asking: How is the hospital represented in contemporary French and Francophone culture? How do contemporary engagements with the hospital differ from prior literary, filmic and philosophical inhabitations of clinical space? What dialogues exist between these philosophical and artistic engagements and architectural theories and hospital transformation projects? And further: how might philosophical and artistic engagements with the hospital dialogue productively and collaborate with such theories in a mutually transformative relationship? How can filmic, literary and philosophical texts help us to imagine, design, and construct the hospitals of the future?
Possible sections and themes might include, but need not be limited to:
- The hospital in French and Francophone philosophy post-Foucault (Malabou, Nancy, Preciado, Stengers, Stiegler, Mbembe)
- Representations of the hospital and healthcare environments in sub-Saharan Francophone African contexts
- The hospital and the clinic in DOMTOM and Outremer contexts
- The hospital in French and Francophone horror and body-horror cinema
- The hospital and clinical environments in illness narratives
- The role of the hospital in narratives of sexuality, romance and pleasure in hospital
- The hospital in queer writing and film
- The hospital and French/Francophone HIV/AIDS writing and cinema
- Legacies of post-May 68 innovation
- Comparative studies
- Interdisciplinary studies of hospital design and building, for instance across architecture and the Critical Medical Humanities
Please send an abstract of 250-300 words to both Dr Benjamin Dalton (b.dalton@lancaster.ac.uk) and Dr Áine Larkin (aine.larkin@mu.ie) by 31 January 2025.
1.16 Discours contre-hégémoniques dans l’océan Indien et en Afrique : Penser et écrire un monde en commun ? (La Réunion)
Discours contre-hégémoniques dans l’océan Indien et en Afrique : Penser et écrire un monde en commun ? (La Réunion)
- Date de tombée (deadline) : 14 Mars 2025
Appel à communications
Discours contre-hégémoniques dans l’océan Indien et en Afrique : Penser et écrire un monde en commun ?
Colloque international, du 12 au 14 novembre 2025
Lieu : Université de La Réunion, île de La Réunion
Langues : français et anglais
Calendrier
Publication de l’appel à communication : semaine du 6 janvier 2025
Date limite de soumission des résumés : vendredi 14 mars 2025
Notification d’acceptation : 15 avril 2025
Programme prévisionnel : 23 juin 2025
Dates du colloque : 12-14 novembre 2025
—
Modalités de soumission
Un résumé de 500 mots et une notice biographique de 150 mots à envoyer aux organisatrices et organisateurs : valerie.magdelaine@univ-reunion.fr , issa.kante@univ-reunion.fr , veronique.bonnet8@wanadoo.fr , yolaine.parisot@u-pec.fr
Comité d’organisation
– ASSANI, Meila, Université de La Réunion,
– BALASUBRAMANIAN, Jenni, Tagore Government Arts and Science College, Inde
– BARET, Christelle, Université de La Réunion
– BONNET, Véronique, Université Sorbonne Paris-Nord,
– HUET, Elisa, Université de La Réunion
– KANTÉ, Issa, Université de La Réunion
– MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO, Valérie, Université de La Réunion
– PARISOT, Yolaine, Université Paris-Est Créteil (UPEC)
– TOQUET, Carla, Université Paris Nanterre
Soutenu par l’Observatoire des Sociétés de l’océan Indien – OSOI-FED4127
—
Appel à communications (English version follows)
Dans un monde en proie à diverses formes d’impérialisme, les grandes puissances et les multinationales, bénéficiant souvent de la complicité ou de la résignation des élites locales, cherchent à imposer leur conception du monde et à maintenir leur domination sur les pays dits du « Tiers Monde » ou du « Sud ». Les îles du sud-ouest de l’océan Indien, qu’elles soient départements français ou Nations indépendantes, sont aux prises avec des formes différentes, mais rémanentes, de colonialité de la pensée et du pouvoir auxquelles, par des soubresauts ou par des stratégies constituées, elles tentent d’échapper. À rebours de ces tentatives d’asservissement, d’autres discours, prenant parfois la forme de contre-discours, se sont imposés (S. B. Diagne, M. Diouf, N. Etoke, P. Hountondji, L. Miano, A. Mbembe, B. Mouralis, V. Mudimbe, F. Sarr, F. Vergès, N. wa Thiong’o, K. Wiredu…) qui prônent un renversement des logiques impérialistes et une déconstruction des mécanismes hégémoniques à l’œuvre depuis des siècles en Afrique (en l’occurrence subsaharienne) comme dans les zones anciennement colonisées, dont l’océan Indien. Plus encore, des formes de convergence entre îles de l’océan Indien et Afrique francophone apparaissent à travers le maniement de concepts et de notions réappropriés et réinvestis dans des sens parfois différents. Ainsi peut-on voir, dans les essais de certains intellectuels africains francophones ou lors des Ateliers de la pensée à Dakar, apparaître des allusions à la notion de créolisation (voir M. Arnold, 2021) ou aux structures sociales rhizomiques définissant généralement les situations créoles – usage qui se fait souvent dans l’ignorance des problématiques spécifiques à l’océan Indien. Inversement, on constate, après un évitement profond de l’Afrique, qui n’avait été présente qu’à titre sporadique (rôle de Rabemananjara dans la négritude et Présence africaine ; « négritude mauricienne » tissant des liens avec Senghor…), que ces relations symboliques, ainsi qu’un certain désir de « devenir africain » (A. Mbembe), s’intensifient. C’est le cas dans le monde littéraire et artistique, où l’on voit des mentions récurrentes au « Nègre » de Césaire et à l’Afrique (notamment dans la poésie de Raharimanana, de Djailani…). Au sein du monde associatif et dans ses manifestations sur les réseaux sociaux (Rasine Kaf, Fondation Héva) s’exprime la volonté d’une reconnaissance accrue de la part « noire » de l’identité créole ainsi que de formes de panafricanisme, au risque d’une certaine radicalité idéologique, souvent revendiquée par certains mouvements politiques, par exemple les Economic Freedom Fighters (EFF) en Afrique du Sud. Ces mouvements intellectuels ou militants associatifs et politiques œuvrent à des rapprochements qui sont des résonances et des allusions symboliques plus que des références, mais qui ont un objectif commun, celui de lutter contre des représentations et des discours hégémoniques. Dans le discours intellectuel, ces résonances sont souvent issues d’un tissu théorique et référentiel mondialisé. On ne les retrouve pas dans les discours politiques, en particulier africains, qui visent une portée plus directement décoloniale en se recentrant essentiellement sur les problématiques propres à l’Afrique. C’est autour de ces croisements de références – ou de leur absence – à un « devenir africain » de l’Afrique comme des îles de l’océan Indien que nous nous interrogerons, pour mieux observer leur volonté contre-hégémonique, mais aussi les limites de ces tentatives de recentrement sur soi, voire la constitution de nouvelles hégémonies notionnelles et discursives.
Issu du vocabulaire politique, le concept d’hégémonie a pris une ampleur particulière à la suite des écrits d’Antonio Gramsci, et s’est élargi à plusieurs champs disciplinaires. Dans cette perspective gramscienne, la transposition de ce concept à différentes problématiques permet d’analyser les diverses modalités d’adhésion et de domination hégémoniques – celles-ci s’appuyant sur une série d’idées, de valeurs, de croyances et de comportements visant à renforcer le pouvoir et l’idéologie de l’élite (Savoie et Rizzuto, Lexique Socius). Dans l’océan Indien et sur le continent africain, le discours contre-hégémonique dans son acception large, que l’on peut définir comme l’ensemble des pratiques et formes discursives qui remettent en cause les idéologies, pratiques et structures hégémoniques, s’érige en moyen de résistance et comme nouveaux champs de réappropriation anti-impérialiste, décoloniale, antiraciste et égalitaire. On gardera à l’esprit, comme le rappelle M. Angenot (1989), qu’une entité cognitive ou discursive dominante (hégémonique) à une époque donnée peut également entrer en composition avec de multiples stratégies (contre-hégémoniques) qui la contestent, l’antagonisent, et en altèrent les éléments. En proposant une alternative aux différentes strates et manifestations politiques, culturelles et linguistiques de l’hégémonie, de quelles façons les discours contre-hégémoniques dans l’espace indianocéanique et africain visent-ils à penser, à écrire et à établir des possibilités de changement social, d’émancipation et d’autodétermination ? Les discours (littéraires, artistiques, politiques, médiatiques…), panafricanistes, contre-hégémoniques et décoloniaux, posent évidemment la question de savoir dans quelle mesure ils parviennent à une « provincialisation de l’Europe » (D. Chakrabarty) et à un recentrement sur soi sans mettre en place de nouvelles hégémonies ou sans s’engager dans « une recherche hégémonique » (J.-F. Bayart). Plus encore, que dit le recours à des points de convergence, jusque-là inédits, d’une volonté contre-hégémonique émanant des Suds et à destination des Suds ? Il est en effet pertinent que ces réflexions soient réinfléchies en investissant la question indianocéanique trop souvent minorée, voire oubliée, et en prenant autant en considération les discours politiques africains que des essais devenus parfois « nouveau catéchisme médiatique » (Elgas; Mangeon). Il s’agit en outre de proposer un recentrement des discours et des épistémès et un questionnement sur les notions d’hégémonie/contre-hégémonie: voit-on naître de nouvelles hégémonies postcoloniales ? On peut se demander si, de manière sous-jacente, ce recentrement cherche à créer « un monde en commun » entre les îles et archipels du sud-ouest de l’océan Indien et le continent.
Ce colloque international pluridisciplinaire entend analyser aussi bien les écrits, littératures et arts des îles du sud-ouest de l’océan Indien invoquant l’Afrique dans le but de créer de nouvelles solidarités « des suds » voire d’une « Afrasian sea » (Karugia et Erll) que, à rebours, la façon dont les discours africains construisent leurs propres stratégies d’émancipation, et ce, dans leur dimension poétique, anthropologique, politique et médiatique. Pour le dire autrement, l’une des questions majeures que pose ce colloque est de savoir comment les discours (littéraires, politiques et médiatiques) visant une émancipation, une décolonisation de la pensée indianocéanique comme de la pensée africaine et une réévaluation de la notion de créolisation (qu’elle soit expressément mentionnée ou sous-jacente) permettent de dessiner de nouvelles « relationalités » voire un « en-commun » ou bien s’ils établissent de nouveaux champs de force entre îles de l’océan Indien et continent africain. S’intéressant particulièrement aux discours contre l’hégémonie politique et culturelle (A. Gramsci), l’hégémonie discursive et langagière (M. Angenot, 1989), et l’hégémonie médiatique, cet appel à communication invite, dans une démarche interdisciplinaire, à s’interroger sur la façon dont ces différentes formes de discours essaient de déconstruire les idéologies, structures et normes sociales et culturelles dominantes. Ces constructions et stratégies discursives témoignent-elles d’une volonté de rapprochement des îles de l’océan Indien avec l’Afrique, et d’une recherche de réévaluation de leur histoire commune ?
Quelques pistes de réflexion :
– Quel est le degré de pénétration de l’idée d’une « Afrique au futur » (Mangeon, 2022) dans l’océan Indien, et dans quels types de discours ?
– Comment s’exprime, et à travers quels supports, la part noire et africaine longtemps minorée des identités des îles de l’océan indien ?
– La rencontre entre une « africanisation » de la pensée et les mutations immédiatement contemporaines de l’océan Indien permet-elle la mise en place de nouveaux discours et de nouvelles esthétiques ?
– Quelles sont les nouvelles formes de cosmopolitismes des Suds qui apparaissent dans les divers discours et essais africains et quelles en sont les résonances pour les îles du sud-ouest de l’océan Indien ?
– De quelle manière peut-on éclairer la pensée et le devenir des îles de l’océan Indien à la lumière des nouvelles pensées africaines ?
– Comment ces pensées, en passe de devenir de nouveaux discours hégémoniques du « Sud global », s’articulent-elles avec les anciennes utopies de l’indianocéanisme ?
– Dans quelle mesure les représentations idéologiques et politiques dans les questionnements et repositionnements des acteurs politiques, intellectuels et de la société civile se présentent-elles différemment, de façon similaire, inclusive ou exclusive dans l’océan Indien et en Afrique ?
– Quel est le degré d’articulation entre pensées contre-hégémoniques et discours politiques décoloniaux africains ?
– Comment est-il, poétiquement et politiquement, possible de « faire pays » (Chamoiseau et al., 2023) sans reconduire, dans la pratique, un geste hégémonique, d’où qu’il vienne ?
Axes et perspectives d’études
Axe 1 : Littératures (orales, écrites, plurilingues) et arts :
– Réévaluation des rêves d’unification de l’indianocéanisme à la lumière des pensées africaines contemporaines.
– Conception et inscriptions d’un « devenir nègre » ou d’un « devenir africain du monde » (A. Mbembe).
– Inscriptions du « Nègre » dans les littératures contemporaines de l’océan Indien.
– Retour sur les formes de « négritude » dans l’océan Indien (J. Rabemananjara, R. Noyau, E. Maunick…).
– Inscriptions de l’Afrique ou du Noir dans les arts plastiques contemporains de l’océan Indien (« artcréologie » de W. Zitte…), liens avec l’Afrique de l’Est et du Sud dans les arts plastiques, la musique, la danse contemporaine.
– Ecritures de la migration et des frontières.
– Modalités de représentation d’une « Afrasian Sea » : une volonté d’écrire « les Suds » apparaît-elle et comment met-elle en relation Afrique, Inde et océan Indien ?
– Ecocritique partagée pour la mise en procès d’une dévastation transnationale des ressources.
– Pensée africaine et réévaluation de la notion de créolisation.
– Traductions et intraduisibles : Nations, frontières, migrations, création d’un « En-commun » ?
Axe 2 : Analyse de discours et linguistique critique :
– Analyse du discours dite « française » (A. O. Barry, D. Maingueneau, S. Moirand, A.-M. Paveau…), analyse des discours médiatiques (P. Charaudeau, S. Moirand…) Critical Discourse Studies (N. Fairclough, T. A. van Dijk…).
– Discours et idéologies anti-néocoloniales, anti-impérialistes, décoloniales, panafricanistes dans les sociétés du sud-ouest de l’OI et les sociétés africaines
– Conception du monde et représentations (contre-)hégémoniques des sociétés, des cultures, des langues et des nations.
– Rôle contre-hégémonique des médias : traditionnels, numériques et des réseaux sociaux.
– Activisme en ligne et élaboration de discours contre-hégémoniques.
– L’activisme environnemental et le développement durable comme formes de résistance.
Axe 3 : Pensées et théories
– Réévaluation de la pertinence et des intérêts pour l’océan Indien des essais contemporains sur la traduction
– Réhabilitation philosophique du panafricanisme
– Universalisme, « pluriversalisme », agentivité ou antiennes,
– Utopies cosmopolitiques, « Afrofuturisme », « Afrotopia »
– Liens entre créolisation et Ateliers de la pensée (M. Arnold)
– Représentation de soi et de l’autre dans le discours contre-hégémonique.
– Black feminism dans l’océan Indien ainsi qu’en Afrique, nouvelles masculinités contre-hégémoniques, questions queer et d’identité, genre et hégémonie (R. Connell et J. Messerschmidt, R. Connell).
Call for Papers
Counter-Hegemonic Discourses in the Indian Ocean and in Africa: Thinking and Writing a Shared World?
In a world beset by various forms of imperialism, the great powers and multinational companies, often benefiting from the complicity or resignation of the local elites, seek to impose their conception of the world and to maintain their domination over countries of the so-called “Third World” or “Global South”. The islands in the south-western Indian Ocean, whether independent nations or French overseas territories, have been facing different but persistent forms of coloniality of the mind and the power system, from which they unsteadily or strategically attempt to escape. To challenge these forms of subjugation, wide range of intellectual discourses, often expressed as counter-discourses, have emerged (S. B. Diagne, M. Diouf, N. Etoke, P. Hountondji, L. Miano, A. Mbembe, B. Mouralis, V. Mudimbe, F. Sarr, F. Vergès, N. wa Thiong’o, K. Wiredu, etc.). They advocate a reversal of the imperialist logic and a deconstruction of the hegemonic mechanisms that have been at work for centuries in Africa (particularly in sub-Saharan Africa) as well as in other formerly colonized societies, including the Indian Ocean ones. Interestingly, forms of convergence between the islands of the Indian Ocean and French-speaking Africa have been emerging through the use of concepts and notions that have been re-appropriated and reinvested, sometimes with different or subtle meanings. For instance, in the essays of some French-speaking African intellectuals or at the Ateliers de la pensée in Dakar, there are allusions to the notion of creolization (see M. Arnold, 2021) or to rhizomatic social structures, which is generally applied to Creole contexts – though this usage often overlooks issues specific to the Indian Ocean. Similarly, after a period of profound avoidance of Africa, which had only been present sporadically (Rabemananjara’s role in negritude and Présence africaine, the “Mauritian negritude” forging connections to Senghor, etc.), there is now a re-appropriation of symbolic relationships as well as a certain desire to “becoming African” (A. Mbembe). This can be seen in the literary and artistic expressions, with recurring references to Cesaire’s notion of “Nègre” and to Africa (particularly in the poetry of Raharimanana and Djailani…). In the sphere of associations and their activism on social networks (Rasine Kaf, Fondation Héva, for example), there is a desire for a greater recognition of the “black” portion of Creole identities. Certain forms of pan-Africanism are also endorsed and may lean toward ideological radicalism – an approach openly advocated by some political movements, such as the Economic Freedom Fighters (EFF) in South Africa. Whether intellectual movements or militant and political organizations, they all seek to create connections that are more resonances and symbolic allusions than actual references. Yet they share a common objective: the fight against hegemonic representations and discourses. In the intellectual discourse, these resonances often stem from a globalized theoretical and referential fabric. They are absent from political discourses, especially in Africa, which primarily pursue a decolonial fight focused on issues specific to Africa. This conference aims to reflect on the intersections of these references (or their absence) to a “becoming African” of Africa as well as of the islands of the Indian Ocean, in order to better understand not only their counter-hegemonic intentions but also the limits of the attempts to refocus on oneself, or even the emergence of new notional and discursive hegemonies.
Stemming from the political vocabulary, the concept of hegemony took on particular importance following Antonio Gramsci’s writings, and has been extended to a number of disciplines. In this Gramscian perspective, the transposition of this concept to various issues enables the analysis of the different modes of hegemonic adherence and domination, which are based on a system of ideas, values, beliefs and attitudes aimed at reinforcing the power and ideology of the elite (Savoie and Rizzuto, Lexique Socius). In the Indian Ocean and on the African continent, the counter-hegemonic discourse in its broadest sense (i.e. all discursive forms and practices which challenge hegemonic ideologies, practices and structures) emerges as a means of resistance and as a new field of anti-imperialist, decolonial, anti-racist and egalitarian re-appropriation. As M. Angenot (1989) argues, a dominant (hegemonic) cognitive or discursive entity at a given time can also be combined with multiple (counter-hegemonic) strategies which oppose it, antagonize it and alter its elements. Adopting an alternative to the various political, cultural and linguistic strata and manifestations of hegemony, in what ways do counter-hegemonic discourses in the Indian Oceanic and African societies seek to think, write and forge possibilities for social change, emancipation and self-determination? The counter-hegemonic, pan-Africanist and decolonial discourses (whether literary, artistic, political, media, etc.) raise the question of how they somehow lead to a “provincialization of Europe” (D. Chakrabarty) and to a self-refocusing which would not establish new hegemonies or engage in “hegemonic search” (J.-F. Bayart). Additionally, what does the recourse to hitherto unseen points of convergence tell us about a counter-hegemonic intent from the South towards the South? It is indeed relevant to rethink these issues by integrating the Indian-oceanic question, which has often been marginalized or even forgotten, and by giving equal consideration to African political discourses and essays that have sometimes become a kind of “new media catechism” (Elgas; Mangeon). Moreover, the aim is also to propose a refocusing of discourses and epistemes and to question the concepts of hegemony and counter-hegemony: are we witnessing the emergence of new postcolonial hegemonies? Can this refocusing be seen as an underlying attempt to create “a world in common” between the islands and archipelagos of the south-west Indian Ocean and the continent.
This multidisciplinary international conference aims to analyze not only the writings, literatures and arts of the islands of the south-west Indian Ocean which invoke Africa in order to create new solidarities “of the Souths” or even for an “Afrasian sea” (Karugia and Erll), but also, in reverse, the way in which African discourses construct their own strategies of emancipation, and particularly in their poetic, anthropological, political, and media dimensions. To put it differently, one of the major questions brought up by this conference is to understand how these discourses (literary, political and media) – which pursue the emancipation and decolonization of both the Indianoceanic and African thought and a re-evaluation of the notion of creolization, whether explicitly mentioned or underlying – can help to shape new “relationalities” or even a “common ground”. Could they establish new fields of force between the islands of the Indian Ocean and the African continent? Focusing particularly on discourses against political and cultural hegemony (A. Gramsci), discursive and linguistic hegemony (M. Angenot, 1989), and media hegemony, this conference invites interdisciplinary perspectives to examine how these various forms of discourse attempt to deconstruct dominant ideologies, and social-cultural structures and norms. Do these discursive constructions and strategies reflect a desire to bring the islands of the Indian Ocean closer to Africa, and to seek a reappraisal of their shared history? Researchers are invited to address the questions outlined above, as well as the following topics – this list is not exhaustive:
– What is the degree of spreading of the idea of the “future of Africa” (Mangeon, 2022) in the Indian Ocean, and in what types of discourses?
– How and through what media is expressed the historically downplayed black and African part of the identities in the Indian Ocean islands?
– Does the encounter between an “Africanization” of thought and the immediately contemporary mutations of the Indian Ocean allow the implementation of new discourses and new aesthetics?
– What are the new forms of cosmopolitanism of the Souths that emerge in the various African discourses and essays, and what are the resonances for the islands of the southwest Indian Ocean?
– How can we clarify the thought and future of the islands of the Indian Ocean in the light of new African thoughts?
– How do these thoughts, which are in the process of becoming new hegemonic discourses of the “Global South”, articulate with the old utopias of Indianoceanism?
– To what extent are ideological and political representations in the questioning and repositioning of political, intellectual, and civil society actors expressed differently, similarly, inclusively or exclusively in the Indian Ocean and in Africa?
– What is the degree of articulation between counter-hegemonic thinking and African decolonial political discourse?
– How is it possible, poetically and politically, to “make a country” (Chamoiseau et al., 2023) without, in practice, renewing a hegemonic gesture, wherever it stems from?
Panels and perspectives of analysis
Panel 1: Literature (oral, written, multilingual) and the arts:
– Reassessment of dreams of unification of Indianoceanism in the light of contemporary African thoughts.
– Conception and inscriptions of a “becoming Black” or a “becoming African of the world” (A. Mbembe).
– Inscriptions of the “Black” in contemporary literature of the Indian Ocean.
– A look back at forms of “negritude” in the Indian Ocean (J. Rabemananjara, R. Noyau, E. Maunick, etc.).
– Inscriptions of Africa or blackness in the contemporary visual arts of the Indian Ocean (“art-creology” by W. Zitte, etc.), and connexions with East and South Africa in the visual arts, music and contemporary dance.
– Migration and border writings.
– Perspectives on the notion of “Afrasian Sea”: is there a desire to write “the Souths”, and how does it connect Africa, India and the Indian Ocean?
– A shared ecocriticism for putting on trial the transnational devastation of resources.
– African thought and the re-evaluation of the notion of creolization.
– Translation and untranslatable: nations, borders, migrations, the creation of an “In-common”?
Panel 2: Discourse analysis and critical linguistics
– French discourse analysis (A. O. Barry, D. Maingueneau, S. Moirand, A.-M. Paveau…), media discourse analysis (P. Charaudeau, S. Moirand…) Critical Discourse Studies (N. Fairclough, T. A. van Dijk…).
– Anti(neo)colonial, anti-imperialist, decolonial and pan-Africanist discourses and ideologies in south-western Indian Ocean and African societies.
– (Counter-)hegemonic worldviews and representations of societies, cultures, languages and nations.
– The counter-hegemonic role of the media: traditional, digital and social networks.
– Online activism and the spreading of counter-hegemonic discourses.
– Environmental activism and sustainable development as forms of resistance.
Panel 3: Thoughts and theories
– Reassessment of the relevance and interest for the Indian Ocean of contemporary essays on translation.
– Philosophical rehabilitation of pan-Africanism
– Universalism, “pluriversalism”, agentivity or antiphons.
– Cosmopolitical utopias, “Afrofuturism”, “Afrotopia”.
– Connexions between creolization and Ateliers de la pensée (M. Arnold).
– Representation of the self and the other in counter-hegemonic discourse.
– Black feminism in the Indian Ocean and Africa, new counter-hegemonic masculinities, queer and identity issues, gender and hegemony (R. Connell and J. Messerschmidt, R. Connell).
Pistes bibliographiques
Textes littéraires
Cabon, Marcel. Kélibé-Kéliba. Port-Louis, Mauritius Printing, 1956.
Damas, Léon-Gontran, dir. “Nouvelle Somme de poésie du monde noir”. Présence africaine, 1966/1, n° 57.
Djailani, Nassuf. Une saison aux Comores. Moroni, KomEDIT, 2014.
—. L’Irrésistible nécessité de mordre dans une mangue. Moroni, KomEDIT, 2014.
Elbadawi, Soeuf. Un dhikri pour nos morts. La rage entre les dents. La Roque d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2013.
Lorraine, Alain. Tienbo le rein et Beaux Visages cafrines sous la lampe. Paris, L’Harmattan, 1975.
—. Sur le black. Saint-Denis, Page libre, 1990.
Martial, Alain-Kamal. Cicatrices. La Roque d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2011.
Maunick, Edouard J. Les Manèges de la mer. Paris, Présence africaine, 1964.
—. Ensoleillé vif. Paris, éditions Saint-Germain–des-Prés, 1976.
—. En mémoire du mémorable. Paris, L’Harmattan, 1979.
—. Toi laminaire.(Italiques pour Aimé Césaire). Maurice, Editions de l’Océan Indien, La Réunion, Editions du CRI, 1990.
Noyau, René. Œuvres, 4 vol.. Ed. par Gérard Noyau et Robert Furlong. Port-Louis, Pamplemousses Editions, 2012.
Raharimanana. Les Cauchemars du gecko. La Roque d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2011.
—. “Raharimanana : Journal du vide 3” https://blogs.mediapart.fr/theatre-divry/blog/020318/raharimanana-journal-du-vide-3
Raharimanana, Tisser. Montréal, Mémoire d’encrier, 2021.
Renaud, Pierre. Pour une même bâtardise. Trou d’eau douce, Alma, 1995.
Robèr, André. Carnets de retour au pays natal. Ille-sur-Tèt, K’A, 2002.
Torabully, Khal. Cahier d’un retour impossible au pays natal. Ille-sur-Tèt, K’A, 2009.
Ouvrages et articles
Åkesson, Lisa, Anette Hellman, Inês M. Raimundo, et Cesaltina Matsinhe. “Civilising the Ex-Colonisers? Counter-Hegemonic Discourses at Workplaces in Maputo”, Journal of Southern African Studies n° 48, vol. 3, 2022, pp. 473–488. doi:10.1080/03057070.2022.2077016.
Angenot, Marc, 1889, un état du discours social, Longueuil, Le Préambule, « L’Univers des discours », 1989, réédité sur le site Médias 19, URL : < http://www.medias19.org/index.php?id=11003 >.
Arnold, Markus, « Entre créolisation, Afropolitanisme et Afrotopia : résonances et lignes de partage entre trois ‘stylistiques du monde’ », French Studies in Southern Africa, n° 51-1, 2021, pp. 25-43.
Arnold, Markus, « Les tissages d’imaginaires et de possibles de Raharimanana : échos afrotopiques », French Studies in Southern Africa, n°53, 2023, pp. 104-128
Arnold, Markus et Elara Bertho, « Poétiques afropolitaines et afrotopiques : imaginer les possibles, recréer le monde », French Studies in Southern Africa, n°53, 2023, pp. 1-22,
Barry, Alpha Ousmane (Ed.), Discours d’Afrique, T. 1. Pour une rhétorique des identités postcoloniales d’Afrique subsaharienne, PU de Franche Comté, 2009.
Barry, Alpha Ousmane, Pour une sémiotique du discours littéraire postcolonial d’Afrique francophone, Paris, L’Harmattan, 2009.
Bayart, Jean-François, « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne. La ‘politique de la chicotte’ », Politique africaine, vol. 110, no. 2, 2008, pp. 123-152.
Bermudez, Juan Pablo, « Postface. La décolonisation est un projet d’inspiration éthique », in Mignolo, Walter D. La Désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la colonialité et grammaire de la décolonialité, Bruxelles, Peter Lang, Coll. Critique sociale et pensée juridique, n°2, 2015, pp. 151-174.
Boqui-Queni, Laëtitia, « De l’espace océan Indien comme espace ouvert ou comment devenir des Enfants de l’océan Indien », dans Jauze, J.M., Définis-moi l’Indianocéanie, Saint-Denis, Université de La Réunion, 2019, pp. 141-152.
Boukari-Yabara, Amzat, Africa unite!: une histoire du panafricanisme, Paris, La Découverte, 2017 (2nd édition).
Bunwaree, Sheila, “Politics of Identity – Recognition, Representation and Reparation – Articulating Afro Mauritians, Mauritius and Africa”, in Sudel Fuma, dir., Regards sur l’Afrique et l’océan Indien, Paris, Le Publieur, 2005, pp. 351-364.
Charaudeau, Patrick, Le Discours d’information médiatique, la construction du miroir, Nathan-INA, coll. Médias recherches, 1997.
Chiniah, Anil Dev, « L’Afrique et la littérature mauricienne. Les poètes créoles mauriciens », Notre librairie, n° 114, 1993, pp. 74-77
Connell Raewyn, Messerschmidt James, “Hegemonic Masculinity : Rethinking the Concept”, Gender & Society, vol. 19, n° 6, 2005, pp. 829-859.
Connell Raewyn, Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, édition établie par Meoïn Hagège et Arthur Vuattoux, Paris, Éditions Amsterdam, 2014 (1995).
Diagne, Souleymane Bachir, De langue à langue : l’hospitalité de la traduction, Paris, Albin Michel, 2022.
Diagne, Souleymane Bachir, et Jean-Louis Amselle, En quête d’Afrique(s), Paris, Albin Michel, 2018.
Diouf, Mamadou, L’Afrique dans le temps du monde, Rot-Bo-Krik, 2023.
Elgas, « ‘L’inachèvement’ est une promesse d’avenir », Présence africaine, n° 159, 2016, pp. 175-187.
Elgas, Les bons ressentiments, Essai sur le malaise post-colonial, Riveneuve, 2023.
Etoke, Nathalie, Melancholia Africana, Paris, Du Cygne, 2010.
Fairclough, Norman, Discourse and social change, Cambridge, Polity, 1992.
Fauvelle, François-Xavier et Anne Lafont (Dir.), L’Afrique et le monde : histoires renouées. De la préhistoire au XXI è siècle, Paris, La Découverte, 2022.
Flipo, Fabrice, « Un renouveau des utopies cosmopolitiques », Sens Public, Article publié en ligne : 2008/03. http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=567.
Foucault, Michel, L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.
Fuma, Sudel, (Dir.), Regards sur l’Afrique et l’océan Indien. Paris, Le Publieur, 2005.
Furlong, Robert, « Senghor et l’île Maurice », Francofonía 15, 2006, pp. 25-29.
Garnier, Xavier, Écopoétiques africaines : Une expérience décoloniale des lieux, Paris, Karthala, 2022.
Giovalucchi, François, « Le devenir africain du monde, une utopie ambiguë », Esprit, mars 2022/3, pp. 131-140.
Glissant, Édouard, Noudelmann François, L’entretien du monde, Presses universitaires de Vincennes, 2018.
Glissant, Édouard, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990.
Gramsci, Antonio, Gramsci dans le texte. De l’Aventi aux derniers écrits de prison (1916-1935), Paris, Éditions sociales, 1975, réédité sur le site de la collection « Les classiques des sciences sociales », URL : < http://classiques.uqac.ca/classiques/gramsci_antonio/dans_le_texte/dans_le_texte.html >.
Grosfoguel, Ramón, « Vers une décolonisation des ‘uni-versalismes’ occidentaux : le ‘pluri-versalisme décolonial’, d’Aimé Césaire aux zapatistes », Achille Mbembe éd., Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 2010, pp. 119-138.
Hountondji, Paulin J., Combats pour le Sens : un itinéraire africain, Cotonou, Les éditions du flamboyant, 1997.
Imorou, Abdoulaye, « Le nouveau discours africain, version bêta », Études littéraires africaines, n° 43, 2017, pp. 145–151. https://doi.org/10.7202/1040923ar
Jean-François, Emmanuel Bruno, et Neelima Jeychandran. « African-Asian Affinities: Indian Oceanic Expressions and Aesthetics », Verge: Studies in Global Asias, vol. 8, n° 1, 2022, https://doi.org/10.1353/vrg.2022.0011.
Karugia, John Njenga et Astrid Erll, “Afrasian Sea Memories: Between Competitive and Multidirectional Remembering » in Afrasian Transformations, Brill, 2020, pp. 63-87.
Magdelaine-Andrianjafitrimo, Valérie, “Voyez comme nous sommes beaux,“Negro” and négritude avatars in the islands of the south-western Indian Ocean: hybridity and “racialised” thinking”, dans Sheila Khan, Nazir Can et Héléna Machado, Racism and Racial Surveillance. Modernity Matters, London and New York, Routledge, 2022, pp. 108-131.
Mahler, Anne Garland, From the Tricontinental to the global South: Race, radicalism, and transnational solidarity, Duke University Press, 2018.
Mangeon, Anthony, L’Afrique au futur : le renversement des mondes, Paris, Hermann, coll. « Fictions pensantes », 2022.
Mbembe, Achille et Sarr Felwine, Écrire l’Afrique-monde, Paris, Philippe Rey, 2017, pp. 243-260.
Mbembe, Achille et Sarr Felwine, Politique des Temps : Imaginer les devenirs africains, Paris & Dakar, Philippe Rey & Jimsaan, 2019.
Mbembe, Achille, « Afro-futurisme et devenir-nègre du monde », Politique africaine, 2014/4, n° 136, pp. 121-133.
Mbembe, Achille, Rémy Rioux et Séverine Kodjo-Grandvaux , Pour un monde en commun, regards croisés entre l’Afrique et l’Europe, Arles, Actes Sud, 2022.
McKinney, Carolyn, Language and Power in Postcolonial Schooling: Ideologies in Practice, New York: Routledge (Language, Culture and Teaching Series), 2017.
Mignolo, Walter D., La Désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la colonialité et grammaire de la décolonialité, Bruxelles, Peter Lang, « Critique sociale et pensée juridique, n°2 », 2015
Moirand, Sophie « Retour sur l’analyse du discours française », Pratiques [En ligne], 185-186 | 2020. URL : http://journals.openedition.org/pratiques/8721
Moirand, Sophie, Les discours de la presse quotidienne, Paris, PUF, 2007.
Mouralis, Bernard, Les contre-littératures, 1975 (rééd. corrigée, 2011), Paris, Hermann.
Mudimbe, Valentin Yves, The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge, Bloomington, Indiana University Press, 1988; L’Invention de l’Afrique. Gnose, philosophie et ordre de la connaissance, (traduit de l’anglais par L. Vannini), Présence africaine, 2021.
Niang, Mame-Fatou et Suaudeau, Julien, Universalisme, collection « Le mot est faible », Anamosa, 2022.
Ngadi Maïssa, Laude; Arnold, Markus; de Meyer, Bernard et Mbégane Ndour, Emmanuel (éds.), Les manifestes littéraires et artistiques d’Afrique francophone subsaharienne : formes et enjeux, French Studies in Southern Africa, n° 51-1, 2021 (Numéro spécial).
Okech, Awino, (Ed.), Gender, Protests and Political Change in Africa, Cham: Palgrave Macmillan. (Gender, Development and Social Change), 2020.
Paveau, Marie Anne, “Une analyse du discours contre-hégémonique. Intersectionnalité critique et pluriversalité décoloniale”, Langage et société, 1, n°178, 2023, pp. 161-190.
Prosper, Jean-Georges, Mauritius Anthology of Literature in the African Context, Ministère de l’éducation et des affaires culturelles de Maurice, 1977.
Quijano, Aníbal, “‘Race’ et colonialité du pouvoir”, Mouvements, 2007/3, n°51, pp. 111-118.
Rabemananjara, Jacques, “Le poète noir et son peuple”, Présence africaine, n°16, octobre-novembre 1957, pp. 9-25.
Rauville, Camille de, Indianocéanisme : Humanisme et négritude suivi de Mythes et structures indianocéaniques, Port-Louis, Le livre mauricien, 1970.
Sarr, Felwine, Afrotopia, Paris, Philippe Rey, 2016.
Savoie, Chantal et Liliana Rizzuto, “Hégémonie”, dans Glinoer, Anthony et Denis Saint-Amand (Dir.), Le lexique socius, URL : http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/196-hegemonie.
Spivak, Gayatri Chakravorty, The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, Ed. Sarah Harasym. London: Routledge, 1990.
Tonda, Joseph, L’Impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, Paris, Karthala, 2015.
Treffel, Frédéric, La Tentation de l’Afrique. Néo-gritude, Afropolis, Mondialité, Paris, Honoré Champion, 2019.
Van Dijk, Teun A., Discourse and Power, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008.
Vergès, Françoise, et Marimoutou, Carpanin, Amarres : créolisations india-océanes, [2003], Paris, L’Harmattan, 2005.
Vergès, Françoise, Un féminisme décolonial, La Fabrique, Paris, 2019.
Wa Thiong’o, Ngugi, Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature, 1986, trad. Décoloniser l’esprit, Paris, La Fabrique, 2011.
Zamalin, Alex, Black utopia: The history of an idea from Black nationalism to Afrofuturism, New York, Columbia University Press, 2019.
- Responsable :
Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo - Url de référence :
https://drive.google.com/file/d/1L5CM1SWyqIoiBKKKkTY7Ci8Ed5PWppNV/view - Adresse :
Université de La Réunion, Saint-Denis
1.17 Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones (Sousse Tunisie)
Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones (Sousse Tunisie)
- Date de tombée (deadline) : 15 Décembre 2025
Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones
Colloque international, Sousse Tunisie
16-17-18 avril 2026
« Vous n’avez pas seulement saccagé la terre, les rochers, les ressources minérales, […] De votre fait, même les animaux, partie de nous-mêmes, […] ne sont plus les mêmes. Ils sont altérés ».
Tahca Ushte, Richard Erdoes, De mémoire indienne,
Plon, Terre humaine, 1977, p. 153.
Durant des siècles, en Occident, la nature et la culture ont été opposées, l’humain, rangé du côté de la culture qu’il représentait, cherchait à dominer, à maîtriser, à exploiter la nature, si ce n’est parfois à l’éliminer, sans en mesurer les conséquences sur son environnement. La nature sauvage, et particulièrement la mer, les montagnes, les déserts, et surtout les forêts, remplis de bêtes sauvages imaginaires ou non (la licorne l’est ainsi que le dragon, pas le loup), représentaient des dangers mortels. L’analogie sémantique qui nourrissait l’imaginaire peut se présenter ainsi : /culture : nature :: bien : mal :: vie : mort/ ; soit : la culture est à la nature, ce que le bien est au mal, ce que la vie est à la mort.
Nature et culture sont ainsi opposées et complémentaires, comme le montrent bien les écrits de l’écrivaine-paysanne Marcelle Delpastre, ainsi que les travaux anthropologiques du groupe de Robert Jaulin. Pour Philippe Descola, il y a un « au-delà de la nature et de la culture », puisqu’il découvre, en étudiant l’ethnie des Jivaro Achvars parmi laquelle il séjourne, que humains et non-humains communiquent par incantations magiques et que, finalement, les non-humains sont tout sauf la nature, car ce sont d’abord et avant tout des partenaires sociaux, des sujets [1].
Il est clair cependant, que les rapports à une nature dégradée et méprisée, sont typiquement occidentaux et relèvent d’un capitalisme forcené, d’une industrialisation polluante et d’une urbanisation échevelée où seuls les gains et les intérêts personnels sont valorisés, dans un esprit de conquête. En revanche, dans de nombreuses civilisations, la nature est riche de symboles interprétés au quotidien de sorte qu’elle est respectée et que l’humain en fait partie intégrante. Comme l’exprime l’Indien sioux en s’adressant aux « Blancs » : « Pour vous les symboles ne sont que des mots qu’on dit ou qu’on écrit dans les livres. Pour nous, ils sont une partie de la nature, une partie de nous-mêmes » [2]. Il précise : « Vous, les Blancs, votre présence nous rend difficile la véritable approche de la nature qui consiste à devenir partie d’elle »[3].
Ce mode de pensée des Amérindiens est probablement très proche de celui des cultures africaines, et de la tradition européenne. En conséquence, dans nos approches, il faut prendre garde à la tentation ethnocentriste et plus particulièrement européocentriste qui voudrait appliquer le même schéma de réflexion à toutes les cultures.
Par ailleurs, un renversement épistémologique s’est opéré depuis la fin du XXe siècle, à la suite d’une prise de conscience écologique, de sorte que la question des rapports de l’humain avec la nature et son environnement est devenue cruciale et vitale. Par ce colloque, il s’agit d’explorer et de mettre en évidence la façon dont la littérature d’enfance et de jeunesse dans les pays francophones se saisit de cette problématique, comment les œuvres manifestent et représentent cet environnement, par quels moyens iconiques ou verbaux – ou les deux à la fois – quelles valeurs et quelles solutions elle prône, comment elle alerte l’enfant sur les dangers de la dégradation des conditions climatiques pour l’humain et le non-humain.
Il s’agira, entre autres, de s’intéresser aux écho-graphies, au sens où l’entendent Nathalie Prince et Sébastien Thiltges : « Nous pourrons définir les écho-graphies pour la jeunesse comme les représentations de l’écologie et de l’inquiétude environnementale par le texte et par l’image, selon une esthétique et une poétique adaptées à un public particulier, un destinataire spécifique, en l’occurrence l’enfant et / ou l’adolescent. » [4]. Si cette question a déjà été abordée dans le cadre hexagonal dans quelques colloques et revues, citons par exemple le numéro 3 de la revue Natures consacré aux archifictions, ou le colloque organisé conjointement par les universités de Hradec Kralové (République tchèque) et de Lille (France) « Écrire la nature : du symbolisme à l’écopoétique en littérature/littérature de jeunesse [5] » dont le premier volet est consacré à l’eau, il nous semble pertinent d’ouvrir ce questionnement à un espace plus large afin de confronter les différentes perspectives et sensibilités au problème. En effet, si l’écopoétique questionne les discours sur la nature, elle est également au cœur d’une visée comparative qui s’intéresse aux formes, mais aussi aux contextes sociaux, aux spécificités culturelles, aux lieux et frontières des champs littéraires et scientifiques » [6]. De la sorte, la crise environnementale oblige à dépasser les frontières naturelles et culturelles pour confronter à l’échelle internationale les discours et les représentations à l’œuvre dans la littérature de jeunesse.
Dans ce cadre, nous attacherons la plus grande importance aux littératures francophones quel que soit l’espace géographique où elles se déploient et quelles que soient les problématiques qu’elles développent dès l’instant qu’elles questionnent le rapport de l’humain à son environnement. En Tunisie, par exemple, la problématique de l’eau se pose avec la plus grande acuité, en Mauritanie, au Sénégal c’est la déforestation massive qui inquiète, au Canada, comme dans la plupart des pays, c’est davantage le réchauffement climatique etc.
Dans cette perspective et sans prétendre à l’exhaustivité, sont retenus les axes suivants :
– Diversité et richesse de la nature (désert, mer, forêt, montagne) et leurs manifestations en littérature de jeunesse des pays francophones
– Modalités d’écriture et de représentation, poétique (s)
– Rapports à l’environnement : respect/protection/ (sur)exploitation/antagonisme/
– Postures par rapport au jeune lectorat (démarche de sensibilisation par ex.) ; effets de la mondialisation, des nouvelles technologies (internet, réseaux sociaux)
– Rapports nature/culture : opposition, complémentarité, intégration corporelle, négation, par-delà nature et culture
– Approches intermédiales : les œuvres plastiques, l’oralité, le numérique
Ce colloque accordera la priorité aux réflexions interculturelles et fera découvrir ou redécouvrir les diverses voies/voix qui cherchent à sensibiliser la jeunesse à la nécessité vitale de mieux connaître, d’apprécier et de préserver son environnement.
Bibliographie indicative
Auraix-Jonchière Pascale et al. (dir.), Abécédaire de la forêt, Paris, Honoré Champion, 2024.
Ayadi Boubaker « La littérature de jeunesse d’expression arabe en Tunisie », dans Itinéraires et contacts de cultures, 32, Imaginaire du jeune méditerranéen, Jean Foucault (dir.), l’Harmattan, 2002.
Calas Frédéric et Auraix-Jonchière Pascale (dir.), Nouveaux récits sur la forêt, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, « Mythographies et société », 2023.
Casta Isabelle Rachel « Anne “Contre” Heidi : ruralité heureuse, villes dangereuses ? » Ondina-Ondine n°8, 2022, p. 31-48. [Enligne] https://doi.org/10.26754/ojs_ondina/ond.202285837
Chelebourg Christian, Écofictions & Cli-Fi : l’environnement dans les fictions de l’imaginaire, Nancy, Presses universitaires de Nancy & Éditions universitaires de Lorraine, 2019.
––––, Les Écofictions. Mythologies de la fin du monde, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2012.
Clermont Philippe, « Les écofictions pour la jeunesse, une forme spécifique ? », dans Christiane Connan-Pintado et Gilles Béhotéguy (dir.), Littérature de jeunesse au présent. Genres littéraires en question(s), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, « Études sur le livre de jeunesse », 2015, p. 59-75.
Kunešová Kveta, « Apprendre à vivre avec la nature », Ondina-Ondine, n°8, 2022, p. 96-112. [En ligne] https://doi.org/10.26754/ojs_ondina/ond.202285835
Laso y Leon Esther, « La montagne en littérature de jeunesse : aspects symboliques », dans Maria Manuela Merino Garcia (dir.), L’appréciation langagière de la nature : le naturel, le texte et l’artifice, Jaen, Universidad de Jaen, 2017, p. 347-354
Prince Nathalie, Thiltges Sébastien (dir.), Éco-graphies. Écologie etlittérature pour la jeunesse, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2018.
Modalités et calendrier
Les propositions de communication (titre, résumé de 1500 caractères maximum (espaces comprises), mots clés, et références bibliographiques seront accompagnées d’une brève biobibliographie de 1500 caractères maximum (espaces comprises) comprenant : statut, établissement et équipe d’accueil ainsi que les principales publications récentes.
Les propositions sont à envoyer, au plus tard, le 15 décembre 2025 à l’adresse suivante :
Une réponse sera adressée aux contributeurs au plus tard le 15 janvier 2026.
Frais d’inscription à prévoir.
Comité scientifique
Saloua BÉJI, LAREL, Faculté des lettres et Sciences humaines de Sousse/Tunisie
Nizar BEN SAAD, LAREL, Faculté des lettres et Sciences humaines de Sousse/Tunisie
Ibtissem BOUSLAMA, LAREL, Faculté des lettres et Sciences humaines de Sousse/Tunisie
Mohamed CHAGRAOUI, LAREL, Faculté des lettres et Sciences humaines de Sousse/Tunisie
Bochra CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
Christiane CONNAN-PINTADO, UR Plurielles (24142) Université Bordeaux Montaigne
Yvon HOUSSAIS, UR ELLIADD, Université de Franche-Comté
Comité directeur
Nizar BEN SAAD, LAREL, Faculté des lettres et Sciences humaines de Sousse/Tunisie
Bochra CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
Fethi ELKHIRI, UR ELLIADD, Université de Franche-Comté
Yvon HOUSSAIS, UR ELLIADD, Université de Franche-Comté
Partenaires
Unité de Recherche ELLIADD, université Franche-Comté et Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
Unité labellisée de recherche 1061 ALITHILA, Université de Lille
Laboratoire de recherche : École et Littératures (LAREL), faculté des lettres et Sciences humaines de Sousse/Tunisie
Institut supérieur des beaux-arts de Sousse/Tunisie (ISBAS)
Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba / Tunisie (ISAMM)
Association tunisienne des arts visuels (ATAV)
[1]Interview de Philippe Descola par Hervé Kempf, sur le site de la revue Reporterre le 01/02/2020, accessible via ce lien : https://reporterre.net/Philippe-Descola-La-nature-ca-n-existe-pas
[2] Tahca Ushte, Richard Erdoes, De mémoire indienne, Plon, Terre humaine, 1977, p. 138.
[3] Ibid, p. 152-153.
[4] Nathalie Prince et Sébastian Thiltges, (dir.), Éco-Graphies Écologie et littératures pour la jeunesse, PUR, 2018 p. 10.
[5]https://www.fabula.org/actualites/117587/colloque-international-visioconferenceecrire-la-nature-du-symbolisme-a.html
[6] Nathalie Prince et Sébastian Thiltges, (dir.), Éco-Graphies Écologie et littératures pour la jeunesse, op. cit., p. 28.
- Responsable :
Fethi Elkhiri, Yvon Houssais, Bochra Charnay, Thierry Charnay, Saida Boukamcha - Url de référence :
https://uso.rnu.tn/ - Adresse :
Université de Sousse, Tunisie
1.18 Créations littéraires et lectures (Safi, Maroc)
Créations littéraires et lectures (Safi,Maroc)
- Date de tombée (deadline) : 28 Février 2025
« Créations littéraires et lectures »
15-16 avril 2025 à la Faculté Polydisciplinaire de SAFI MAROC
Le Département de Langue, Littérature et Communication Françaises, la Faculté Polydisciplinaire de Safi, l’Équipe de recherche « Représentations Culturelles et Modes de Pensées » (RCMP) et le laboratoire « Analyse du Discours et Systèmes de Connaissances » (ADSC) de la FPS, organisent le IVe Colloque international qui aura lieu à Safi (Maroc) sous le thème : « Créations littéraires et lectures », les 15-16 avril 2017.
Argumentaire du colloque international
La notion de lecture littéraire a été marquée durant les dernières décennies par un renouvellement de ses approches théoriques et critiques, renforçant de multiples perspectives compte tenu de sa complexité conceptuelle et critique. Actuellement, la lecture littéraire est considérée comme une activité culturelle ou esthétique parmi d’autres.
Les théories contemporaines de la lecture littéraire accordent une place déterminante à l’activité des lecteurs dans l’actualisation des œuvres. Autrement dit, un texte littéraire n’adviendrait véritablement que lorsqu’il est pris en charge par un lecteur qui lui aurait donné sa forme finale. Dès lors qu’on pose comme préalable que le texte littéraire ne peut véritablement exister sans l’activité d’un lecteur, deux conceptions générales de la réalisation du texte sont envisageables. La première, désormais traditionnelle, conçoit que le lecteur, pour faire advenir le texte littéraire, doit respecter des limites et contraintes imposées par le texte. Les interprétations doivent être objectivables dans l’espace circonscrit par le texte. Il s’agit de la perspective générale proposée par Iser, Jauss, Charles et Eco. Hors des limites du texte, il n’est pas sûr que le sujet lecteur trouve le salut. En imposant les conditions de sa réception, le texte maintient le lecteur dans un rôle de penseur rationnel qui cherche à expliquer, de manière obéissante, les injonctions du texte. La démarche d’explication oblige à déployer des connaissances potentiellement sans rapport avec les connaissances expérientielles et référentielles du sujet lecteur.
La deuxième conception, plus récente, remplace le lecteur agent du texte par un lecteur mobile, singulier, autorisé à élaborer sa propre compréhension-interprétation des textes littéraires. Conséquemment, elle conçoit aussi que le texte littéraire soit intrinsèquement mobile, le résultat d’une élaboration singulière et subjective par chaque lecteur. Selon cette conception, chaque intervention singulière d’un lecteur fait advenir un texte singulier. C’est le lecteur qui configure le texte littéraire. Consciemment et inconsciemment, il lui donne sa forme ultime en imaginant la majorité des détails qui ne lui sont pas fournis par le matériau textuel. Le lecteur puise dans son univers personnel pour attribuer au texte des éléments qui relèvent de l’atmosphère, du paysage, d’autres qui lui permettent de caractériser les personnages. Le processus d’identification, notamment, permet au lecteur de reconfigurer le texte. Sur le plan axiologique, la lecture subjective amène le lecteur à donner un sens personnel au texte littéraire. Se référant à ses propres valeurs, il pose des jugements moraux sur les personnages, comprend ou conteste les situations décrites et, ce faisant, reconfigure le texte littéraire pour l’interpréter. C’est pour toutes ces raisons qu’on reconnaît aujourd’hui la réalisation du texte littéraire comme fortement dépendante de la subjectivité du lecteur.
Prendre en compte la lecture qui émane d’un sujet, c’est reconnaître que le lecteur joue un rôle actif et singulier dans la réalisation des textes littéraires, c’est porter attention à la façon singulière dont un lecteur habite et réalise un texte littéraire, c’est ouvrir un espace pour s’intéresser à ce texte qu’il fait advenir à la première lecture, mais aussi pour être à l’écoute de sa compréhension-interprétation, c’est ouvrir un espace de rencontre entre le texte et le lecteur, de dialogue entre les lecteurs, c’est, enfin, reconnaître que le lecteur, autant que le texte, impose ses contraintes.
Le texte littéraire, en tant qu’outil de médiation de connaissance entre le monde et le lecteur, participerait à la formation du sujet, à la fois par les regards qu’il porte sur l’autre et sur lui-même dans l’acte de lire. En reposant les questions qui sont nées avec l’humanité et qui se rapportent au conflit toujours actuel entre le bien et le mal, le texte littéraire cadre un enjeu d’ordre axiologique. C’est dans les mailles du texte littéraire que des hommes – dont les auteurs et les lecteurs – mettent en mots des valeurs, créent, par l’analogie, des métaphores porteuses de sens et poussent le lecteur à se demander ce que lui, à la place de l’autre, ferait.
Barthes nous fait penser à ce que l’on pourrait sans doute appeler aussi le pouvoir de la littérature et de sa lecture, un pouvoir qui, comme nous l’avons vu, est complexe et va très au-delà de la surface de ce qui est représenté en elle, touchant de façon subtile l’homme qui lit comme un ensemble : intellect, corps, affects, émotions. Le lecteur en explore tous les langages, revisite ses dimensions philosophiques, culturelles, psychanalytiques, idéologiques et linguistiques, se réfère à des auteurs et à des œuvres qui lui permettent de soutenir et affirmer ses propos. La critique littéraire articule la lecture et l’écriture : dans l’écriture critique, dit Roland Barthes dans « Critique et vérité», on renvoie « l’œuvre au désir de l’écriture, dont elle était sortie. Ainsi tourne la parole autour du livre : lire, écrire : d’un désir à l’autre va toute littérature. ».
L’écriture littéraire offre également une variété de styles et de techniques littéraires. Les lecteurs, en s’immergeant dans ces œuvres, enrichissent leur vocabulaire et leur compréhension des subtilités de la langue. La littérature expose, en effet, le lecteur à un langage riche et varié. L’écriture littéraire inspire souvent le lecteur à développer sa propre créativité. La rencontre avec des styles narratifs variés peut encourager le lecteur à écrire lui-même, à expérimenter et à partager ses propres expériences. La lecture littéraire encourage, en fait, le lecteur à analyser et à interpréter des textes de manière critique. Cela développe des compétences analytiques précieuses.
Ce sont des pratiques profondément interconnectées qui se nourrissent mutuellement et offrent une richesse d’expériences, d’apprentissages et de réflexions. Elles sont une porte ouverte sur la connaissance, l’empathie et la créativité.
Annie Rouxel définit la lecture littéraire, qui découle des théories de la réception comme étant « le fait de lire littérairement un texte littéraire ». Autrement dit, les textes littéraires ont pour spécificité « d’instaurer un mode de communication particulier », de « créer leur propre référent » et de « s’inscrire dans le vaste ensemble de la production littéraire ». La lecture littéraire est une posture de lecture qui confère au texte son caractère littéraire : le lecteur, engagé dans une démarche interprétative, est sensible au fonctionnement du texte et à sa dimension esthétique ; il se permet de lire et de relire pour savourer le texte. Le plaisir esthétique, dimension essentielle à la lecture littéraire, résulte du texte et de l’activité déployée par le lecteur pendant la lecture.
Depuis Qu’est-ce que la littérature ? de Sartre, le lecteur a pris un rôle central dans la théorie et l’analyse littéraire. Il a donné lieu à une multitude de noms : narrataire (Gerald Prince), lecteur implicite ou impliqué (Wolfgang Iser), lecteur modèle (Umberto Eco), etc. Suite à ces évolutions théoriques, on peut dégager deux constantes : Ces théories de la lecture littéraire reconnaissent le rôle que joue le lecteur, celui d’un sujet actif qui construit le sens d’un texte littéraire et selon les mêmes théories, le texte littéraire a pour fonction de contraindre le lecteur à l’intérieur d’un horizon d’attente, de rendre la lecture opératoire dans la relation dialogique entre le lecteur et le texte.
Allant de la création littéraire à sa réception, ce colloque propose donc une analyse critique des théories de la lecture littéraire. De quelle lecture parle-t-on ? Si, comme le soulignait Vincent Kaufmann, « une grande partie des travaux de la critique et de la théorie littéraires s’articulent aujourd’hui autour de la question de la lecture », il convient de situer cette évolution dans le double contexte d’une remise en cause de la thèse de l’autonomie de la littérature, posée par Barthes dans Le Degré zéro de l’écriture. Il faut, en effet, prendre en compte, d’une part, la nouveauté de la question « Pour qui écrit-on ? » posée en 1948 par Jean-Paul Sartre dans Qu’est-ce que la littérature ?, de l’autre, les théories allemandes de la réception. Ces deux courants de pensée semblent confirmer l’idée de Valéry, selon laquelle c’est moins l’auteur que les fluctuations du lecteur qui constitueraient le vrai sujet de l’histoire de la littérature qui, tout en posant à l’écrivain la question de l’autre, pose le lecteur comme «modèle » préalable de l’écriture pour l’esthétique de la réception. Il est donc intéressant de voir, aujourd’hui, l’évolution de certains genres qui caractérisent le rapport création littéraire ou artistique et lecture. Dans cette perspective, Barthes proposait de passer de l’écriture à la lecture littéraire comme l’on passe d’un code littéraire à un autre. Cette nouvelle conception pourrait produire, selon Jean-Charles Margotton des textes hybrides, comme les essais, où la littérature est associée à des formes extra-littéraires.
C’est cette pratique de la lecture qui est considérée comme un apport du sujet lisant à la réalisation de l’œuvre lue, que nous entendons explorer à travers ce colloque international et qui sera une occasion fructueuse de penser la création et la lecture littéraire dans leurs spécificités théoriques et critiques, et d’échanger sur la création littéraire et la lecture. Il s’agit de faire connaître les recherches récentes qui prennent en compte des axes thématiques variés et interdisciplinaires en cours de développement dans le domaine des études littéraires.
Pour répondre à ces questions complexes, il y a lieu d’étudier tout d’abord, la conception de l’œuvre littéraire et artistique chez les créateurs eux-mêmes, qui se sont impliqués dans cette perspective transversale et qui demeure au centre des réflexions d’un grand nombre d’auteurs, en suite, il s’agit de s’intéresser à l’interaction entre les créations littéraires des écrivains, classiques ou contemporains, et lectures littéraires qui présentent une certaine collaboration pour créer une œuvre littéraire nouvelle ou tout simplement une interprétation de l’œuvre littéraire ou plastique. En abordant notre thématique de cette façon, on la fait émerger à partir de la disparité des matériaux: du côté du texte, des ouvrages, des essais, des correspondances ; du côté de l’œuvre littéraire ou artistique. C’est l’objectif que s’assigne ce colloque, dans le cadre d’une approche interdisciplinaire.
Prenant acte de cette situation, notre propos n’est pas de refaire ce qui a déjà été élaboré par d’autres ni de prétendre renouveler les débats en cours. Cependant et en dépit de ces réserves, les modalités d’aborder le sujet ne sont assurément pas épuisées pour autant.
Ainsi se profile la possibilité réelle, sinon de comprendre, du moins de pouvoir décrire, à travers l’analyse d’une série d’exemples parlants, comment l’écriture littéraire et le texte se rapportent l’une à l’autre.
Les axes thématiques non exhaustifs qui suivent pourront donner lieu à des réflexions :
– Créations littéraires et lectures comme stimulation de la créativité stylistique et littéraire,
– Créations littéraires et lectures comme transmission de la culture et de l’histoire,
– Créations littéraires et lecture comme réflexion critique et théorique.
– L’Ekphrasis comme lecture des œuvres d’art
– Du texte-image à l’hybridité générique.
– Corrélation texte littéraire/image et « être-au-monde » du démiurge.
Loin d’être exhaustif, cet inventaire de suggestions est purement indicatif. On serait à même d’y joindre d’autres axes allant dans le sens de la problématique soulevée et proposée au débat. Une approche pluridisciplinaire exposant les multiples facettes de la relation Ecritures/lectures sera forcément enrichissante. Elle sera d’un profit inestimable.
Modalités de soumission :
Les titres et résumés des communications, d’environ une demi-page, accompagnés d’une notice biographique sont à envoyer uniquement par voie électronique avant le 28 février 2025 à : colloques-fps@uca.ac.ma
Langues du colloque : Français-Arabe- Anglais
Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes.
Dates importantes
- Date limite d’envoi des propositions: 28 février 2025
- Décision du comité scientifique : 08 mars 2025
- Date du colloque: 15 et 16 avril 2025 à la salle des conférences de la FPS
Une publication des actes du colloque est envisagée dans la Revue Mots et mondes indexée.
Les organisateurs ne prennent pas en charge l’hébergement et le transport.
La participation au colloque est gratuite.
Coordonnateurs:
- Pr. Ali RAHALI : a.rahali@uca.ac.ma
- Pr. Abdelaadim TAHIRI : a.tahiri@uca.ac.ma
Comité d’organisation
- Pr. Abdelaadim TAHIRI (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Adil FATHI (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Ali RAHALI (UCAM, FPD Safi, Maroc),
- Pr. Brahime NADINE, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Elmustapha LEMGHARI (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Hassane TAKROUR, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Ikhlas SAIDI, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Mohamed HABIBALLAH, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Mohssine FATHI, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Mokhtar BELARBI (UMI, Meknès, Maroc),
- Pr. Rajae BABALAHCEN, (UCAM, ENSA Safi, Maroc),
- Pr. Touria LACHHAB, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Les Doctorants de la FPS.
Comité scientifique
- Pr. Abdelaadim TAHIRI (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Abir ABID, (Université de Tunis, FSHS de Tunis,Tunisie),
- Pr. Adil FATHI (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Ali RAHALI (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Bernadette REY MIMOSO-RUIZ (L’Institut Catholique de Toulouse, France),
- Pr. Brahime NADINE, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Driss AIT ZEMZAMI, (UMI, Meknès, Maroc),
- Pr. Elmustapha LEMGHARI (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. José Guimarães (University of Minho, Braga Portugal),
- Pr. Mohammed OUBLOUHOU, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Mokhtar BELARBI (UMI, Meknès, Maroc),
- Pr. Pr. Hassane TAKROUR, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Rahhali Erradouani, (UCAM, FP Safi, Maroc),
- Pr. Rajae BABALAHCEN, (UCAM, ENSA Safi, Maroc),
- Pr. Sadik MADANI ALAOUI, (U M B A, FLSH Dhar El Mehraz Fès, Maroc).
Bibliographie indicative
Barthes R. Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, ,
Charles M. Rhétorique de la lecture, Paris, Seuil, 1977,
Eco U. Lector in fabula, trad. franç., Paris, Grasset, 1985,
Iser W. L’Acte de lecture, trad. franç., Bruxelles, Mardaga, 1985,
Jauss H. R. Pour une esthétique de la réception, trad. franç., Paris, Gallimard, 1978, M. Picard La Lecture comme jeu, Paris, Minuit, 1986,
Ricœur P. Le Conflit des interprétations, Paris, Seuil, 1969,
ROUXEL A. Enseigner la lecture littéraire. Rennes, Presses universitaires de Rennes (Didact. français), 1996,
STIERLE K. : « Réception et fiction », in Poétique.N° 39, 1979.
- Responsable :
A. Rahali - Url de référence :
https://fps.uca.ma/2025/01/09/colloque-international-creations-litteraires-et-lectures/ - Adresse :
Faculté Polydisciplinare Safi UCA
https://www.fabula.org/actualites/124976/creations-litteraires-et-lectures.html
1.19 Afrotopies. La science-fiction africaine contemporaine
Afrotopies. La science-fiction africaine contemporaine (revue Africanías)
- Date de tombée (deadline) : 15 Mars 2025
L’appel à contributions pour le numéro 3 de la Revue Africanías. Revista de literaturas est ouvert. Africanías est une publication de la Universidad Complutense de Madrid consacrée aux études littéraires (y compris les traditions culturelles et artistiques liées aux études littéraires) sur le continent africain, sa diaspora et l’afro-descendance.
Pour ce dossier monographique, nous invitons les chercheur.es à présenter des articles, des traductions et des comptes-rendus sur la science-fiction écrite par des auteurs et des autrices dans le continent africain (Maghreb et Afrique subsaharienne) et par des afro-descendants dans les différentes diasporas.
Dès sa consécration en tant que genre dans les années 1950 jusqu’à nos jours, le terme « science-fiction » a fait l’objet de débats et s’est trouvé confronté avec d’autres qui, cependant, non pas réussi à le remplacer : fiction spéculative, littératures de l’imaginaire, littératures de l’extraordinaire, littératures de l’insolite… Les dénominations se succèdent sans qu’aucune d’entre elles ne parvienne à s’imposer, sans que les experts venant de traditions culturelles diverses, les spécialistes des différents sous-genres qui le conforment ne se mettent d’accord sur quel terme est le plus pertinent, le plus partagé, le plus exact[1].
Un débat encore plus tendu quand il s’agit de classer dans la science-fiction les œuvres écrites dès et sur le continent africain et ses sociétés. Le lexème « science » qui fait partie de la dénomination de ce genre pose beaucoup de problèmes pour se référer à des textes dans lesquels la science, en tant que synonyme de développement technologique, est, en général et pour plusieurs raisons, très peu présente. Mais là aussi, les dénominations qui sont apparues pour tenter de résoudre cette contradiction (afro-futurisme, africanfuturisme, jujuisme, afro-optimisme, …) sont sujettes à controverse et à révision permanente.
C’est pourquoi nous ouvrons ce numéro monographique à toutes les soumissions s’inscrivant dans le domaine de ce que les lecteurs et les lectrices reconnaissent comme de la science-fiction, une dénomination comprenant les œuvres qui représentent des mondes différant du réel et qui incorporent, dans des proportions variables, des éléments fantastiques, futuristes, surnaturels, des mondes possibles. Bref, des œuvres se caractérisant par ce que Philip K. Dirk appelle « dislocation conceptuelle », seul élément que semblent partager la multiplicité de sous-genres conformant la science-fiction. Nous encourageons la présentation d’articles contribuant à explorer ce genre encore en construction[2] mais qui a fermement établi ses fondations dans les littératures africaines et afro-descendantes au cours de ce siècle. Les soumissions peuvent s’intéresser à n’importe quel sous-genre ou tendance de la science-fiction. Des analyses de langages et d’approches autres en plus du littéraire (cinéma, arts visuels, BD, genres hybrides) trouvent également leur place dans ce numéro ainsi que des traductions inédites et des comptes-rendus d’études récentes sur le sujet.
Voici quelques axes thématiques (non exhaustifs) dans lesquels les soumissions peuvent s’inscrire :
- Thèmes, formes et figures de la science-fiction africaine contemporaine.
- Dialogues continentaux et intercontinentaux. Quelles relations, quelles influences mutuelles s’établissent entre les productions de science- fiction dans le continent africain et dans les différentes diasporas à partir de leurs langues et cultures respectives (science-fiction anglophone, francophone, lusophone, en langues autochtones) ?
- Cinéma, littérature, BD, arts plastiques et science-fiction africaine. Quelles passerelles se tendent entre les différents arts ?
Afro-futurisme, africanfuturisme, jujuisme, afro-optimisme. - Hybridation dans la science-fiction africaine : perméabilité et redéfinition des genres classiques, slipstream.
- Poétique de la science-fiction africaine : tradition et expérimentation.
- Science-fiction africaine et afrotopie[3]. Comment les œuvres africaines de science-fiction contribuent à décoloniser le présent et le futur de l’Afrique, à « articuler une proposition africaine de civilisation en dehors d’une dialectique de la réaction et de l’affirmation, sur un mode créatif, [à] affirmer une présence au monde sur le mode libre de la présence à soi » ?[4]
- Magie vs science ? La fiction spéculative africaine joue un rôle important dans la redéfinition du concept de science dans des contextes africains selon des écrivains comme Wanuri Kahiu ou des académiciens comme Abd El Khadr Hamza[5], pour qui la magie et la sagesse ancestrale constituent une science/technologie alternative. Dans le même ordre d’idées, des auteurs comme Istvan Csicsery-Ronay Jr. o Rosi Braidotti voient dans la science-fiction africaine un champ d’expérimentation où le post humanisme critique occidental et l’humanisme non occidental, avec ses ontologies alternatives et ses propres mythes, peuvent se rencontrer et dialoguer[6].
- Quel est le rôle joué par les prix (Nebula, Nommo, World Fantasy), les magazines de création (Omenana), le marché de l’édition à l’intérieur ou à l’extérieur du continent africain dans l’essor actuel du genre ?
- Femme et science-fiction africaine. De nombreuses études relient cet essor avec la notoriété d’autrices telles que Nnedi Okorafor ou Lauren Beukes. Comment peut être expliquée, par exemple, la forte présence d’écrivaines (et de protagonistes féminines) dans un genre traditionnellement masculin ?
- La traduction de la science-fiction africaine.
—
Merci de faire parvenir vos résumés (200-300 mots) et une présentation bio-bibliographique de l’auteur.e (100-200 mots) à anai.labra@uah.es ou maya.garcia@uah.es avant le 15 mars 2025. Les soumissions peuvent être écrites en espagnol, portugais, français et anglais.
Date prévue de réponse aux auteur.es : le 21 mars 2025.
Soumission définitive des articles/comptes-rendus/traductions : le 15 mai 2025.
Veuillez consulter les informations concernant la soumission des textes et les normes d’édition de la revue sur https://revistas.ucm.es/index.php/AFRI/about/submissions.
—
[1] Lorris Murail y fait référence avec ironie lorsqu’il intitule l’avant-propos de son guide classique du genre, Les Maîtres de la science-fiction (Paris, Bordas, 2003) « Les neuf milliards de définitions de la science-fiction ».
[2] Flora Amabiamina, Alain Roger Boayéniak Bayo, La science-fiction africaine. Questionnement et enjeux d’un genre en construction, Éditions Pygmies, 2024.
[3] Terme créé par Felwine Sarr dans l’essai du même nom: Afrotopie, Paris, Philippe Rey, 2016.
[4] Felwine Sarr, Afrotopie, p. 152.
[5] Abd El Khadr Hamza, Afrique(s) et Science-fiction. Histoire(s) et représentations. Thèse de Littérature générale et comparée. Université de la Sorbonne Nouvelle- Paris III, 2022.
[6] Cela est possible car, comme le rappelle à juste titre Teresa Pellisa, «las epistemologías no occidentales, como las cosmogonías indígenas y la tradición ancestral de las culturas africanas, ya partían de presupuestos que hoy denominamos poshumanistas», dans «Futurismo afrolatinoamericano y poshumanismo indigenista en la ciencia ficción latinoamericana». Kamchatka. Revista de análisis cultural, 2023, nº 22, p.8.
- Responsable :
Africanías. Revista de literaturas (Universidad Complutense de Madrid) - Url de référence :
https://revistas.ucm.es/index.php/AFRI/index - Adresse :
Africanías. Revista de literaturas (Universidad Complutense de Madrid)
https://www.fabula.org/actualites/125027/afrotopies-la-science-fiction-africaine-contemporaine.html
1.20 Quelle autorité pour quelle auctorialité ? Mise en fiction de l’écrivain.e dans les romans francophones
Quelle autorité pour quelle auctorialité ? Mise en fiction de l’écrivain.e dans les romans francophones (Nouvelles Études Francophones)
- Date de tombée (deadline) : 30 Avril 2025
Appel à contributions – Nouvelles Études Francophones
Dossier : Quelle autorité pour quelle auctorialité ? Mise en fiction de l’écrivain.e dans les romans francophones (dir. Marie Bulté)
La Plus Secrète Mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, a singulièrement remis à l’honneur le roman de l’écrivain.e, dans une œuvre que hantent de nombreuses figures fictionnelles de romancières et de romanciers, traçant toute une nébuleuse autour d’une question aussi décisive que clivante : comment être un.e écrivain.e francophone ? Comment écrire dans une langue d’altérité, comment écrire dans un espace d’aspérités, comment éprouver toutes ces hétérogénéités ?
Ce dossier spécial de la Revue Nouvelles Études Francophones cherchera à examiner les représentations francophones de ce questionnement si spécifique à travers ce que Charline Pluvinet a pu appeler des Fictions en quête d’auteur (2012). Comment l’écrivain.e, comme personnage de roman, affronte ces questions de disparité des temps, des espaces et des langues ? Comment cette mise en fiction de la question auctoriale fait vaciller la question même de ce qui peut faire autorité dans le champ littéraire ? Comment elle met en doute ou en défaut les aspirations tant à une littérature qui revendique une identité autre que française métropolitaine qu’à une littérature qui se postule comme mondiale ? Ce dossier se concentrera sur des romans en français au sein desquels des figurations fictionnelles de l’écrivain.e francophone incarnent un trouble de l’autorité et de l’auctorialité.
Les propositions de contribution (300 à 500 mots, en français) sont à envoyer d’ici le 30 avril 2025 à l’adresse suivante : marie.bulte@univ-lille.fr
Veuillez inclure, sur la première page, les informations suivantes : un titre provisoire, votre nom, votre affiliation universitaire, votre adresse électronique, et une courte notice bio-bibliographique (environ 120 mots).
Remise des articles (5500-6000 mots maximum) : le 15 novembre 2025. Si votre proposition est retenue, vous recevrez le protocole de rédaction avec une réponse de la coordinatrice du dossier vous invitant à soumettre vos travaux. Tous les articles soumis feront l’objet d’une évaluation en double aveugle par les pair.e.s.
—
Nouvelles Études Francophones (NEF), ISSN 1552-3152, publiée par les Presses Universitaires du Nebraska, est la revue officielle du Conseil International d’Études Francophones (CIÉF). Revue scientifique biannuelle de langue française, NEF diffuse la recherche dans les domaines de la langue française, de la littérature, des arts, des sciences sociales, de la culture et de la civilisation des pays et régions francophones.
- Responsable :
Marie Bulté - Url de référence :
https://secure.cief.org/wp/?page_id=112 - Adresse :
CIEF
1.21 Littératures : légitimité et (l)égalité
Littératures : légitimité et (l)égalité
- Date de tombée (deadline) : 11 Mai 2025
Les laboratoires de recherche Intersignes (Université de Tunis)
et Analyse Textuelle, Traduction et Communication (Université de la Manouba),
en partenariat avec la Chaire Senghor de la Francophonie de l’Université de Tunis et
Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb,
organisent un
Colloque international :
Littératures : légitimité et (l)égalité
Tunis – les 13 et 14 novembre 2025
Procès, crimes, châtiments, quête de vérité et de justice, sont au cœur de bien des œuvres et soulèvent le problème de la légitimité et de l’illégitimité, de l’égalité et de la légalité, du juste et de l’injuste. Littérature de fiction et littérature d’idées s’interrogent sur ces questions depuis l’Antiquité (Euripide, Sophocle, Socrate, Platon, etc.). En effet, le monde de la littérature et le droit de la Cité et celui des individus sont étroitement liés : ils entrent en dialogue et provoquent des tensions, reflétant ainsi la complexité des rapports humains souvent marqués par les inégalités.
Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote pose la définition suivante : « Le juste est ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l’égalité ; l’injuste, ce qui est contraire à la loi et ce qui manque à l’égalité » (V, 2). Égalité et légalité devraient ainsi permettre d’agir en vue de garantir le partage équitable des biens et le vivre-ensemble. L’association dialectique de ces deux principes pose indéniablement problème car l’idéal égalitaire aristotélicien se confronte au réel brut et inextricable.
Cette tension est au cœur de deux genres littéraires qui questionnent les possibles de la société. Alors que l’utopie est « critique du réel » (Drouin-Hans, 2015), la dystopie, elle, se fait « miroir déformé du présent » (Claisse, 2010 : § 3). Intégrant une réflexion sur les lois et les droits qui régissent les rapports humains, ces deux appréhensions politiques, sociales et morales de l’avenir engendrent un rêve d’égalité (More, 1516) ou une menace d’injustices (Orwell, 1949 ; Jardin, 2004 ; Rufin, 2004 ; Le Clézio, 2006, etc.). Mais cette réflexion doit également s’ouvrir aux hétérotopies, ces contre-espaces isolés, ancrés dans le temps présent et gouvernés par leurs propres règles (Foucault, 2009).
Par ailleurs, la méditation des écrivains sur la société au présent a donné lieu à des œuvres qui défendent les subalternes et placent l’équité comme valeur fondamentale. En quête de justice sociale, les auteurs abordent diverses thématiques comme la condition ouvrière, le monde de l’entreprise, les droits de la femme et ceux des minorités. À travers des récits qui mettent en scène des personnages de victimes ou de révoltés qui tentent de prendre en main leur destin, ces auteurs pointent les inégalités qui rongent le corps social (Hugo, 1862 ; Sand, 1832 ; Bon, 1982 ; Despentes, 2006, etc.).
Ainsi ces œuvres invitent-elles à aborder la littérature selon une approche fonctionnelle dans la mesure où leur dimension réparatrice (Gefen, 2017) se fait prégnante. Il est toutefois nécessaire de remarquer que la notion de réparation connaît, de nos jours, une réelle évolution. Elle n’est plus uniquement expiation et satisfaction, elle implique désormais l’accès à la justice et la reconstruction psychologique. La littérature offre dès lors un espace d’expression aux sans-voix et leur assure la reconnaissance des blessures et maux subis. Si la littérature carcérale illustre bien cette démarche (Ghandi, 1932 ; Naccache, 1982 ; El-Saadawi, 1984 ; Genet, 1946, Liscano, 2008, etc.), la production littéraire qui se développe dans le cadre de la libération de la parole des victimes de violences sexuelles l’atteste tout autant. Des textes comme Le Consentement (Springora, 2020) et La Familia grande (Kouchner, 2021) ont, en effet, joué un rôle essentiel dans la sensibilisation du grand public et dans l’adoption en France de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
La parole juste, le discours qui convainc et persuade, à la tribune ou dans le prétoire, éveille également les consciences et influence les esprits : des figures emblématiques comme Gisèle Halimi et Martin Luther King ont mis leur maîtrise de l’éloquence et de la rhétorique au service de leurs combats contre l’injustice et les inégalités. Mais le pouvoir de la parole ne se réduit pas à la défense des causes justes. Il est le garant de l’équité, car tout un chacun, victime ou criminel, plaignant ou défendeur, a le droit de se défendre et d’être défendu (Markowic, 2018).
D’autre part, le dévoilement de la vérité, la quête de justice, nourrissent une littérature judiciaire qui aspire, par le récit, à interroger les dilemmes moraux. Se développe ainsi une littérature envahissant les palais de justice et les tribunaux et encourageant dans un même temps le lecteur à aborder avec empathie faits divers et autres affaires complexes réelles ou fictionnelles (Gide, 1913 ; Giono, 1947 ; Von Schirach, 2015 ; Jaenada, 2017, 2021, 2022 ; Reza, 2024, etc.). Le monde en procès n’exclut pas cependant de pointer les iniquités du monde judiciaire. Instrumentalisation de la loi et mise en scène d’affaires judiciaires menacent la liberté et l’égalité (Kafka, 1925 ; Camus, 1942). Le texte littéraire devient une « lutte engagée pour la vérité contre le mensonge, pour la justice contre l’arbitraire » (Clemenceau, 1899 : 276). Happés par la machine judiciaire, certains écrivains tels que Flaubert, Zola ou encore Guyotat, sont poursuivis en raison de leurs œuvres et de leurs idées ; d’autres, tel que Giono, sont confrontés à des litiges les opposant à leurs éditeurs.
Le juste et l’injuste irriguent en outre les récits relatant des enquêtes. Dans les textes d’auteurs comme Simenon, Fred Vargas ou encore Agatha Christie, résoudre un crime, élucider un mystère, lever le mensonge, est la mission de l’enquêteur chevronné, décidé à retrouver les criminels, à les poursuivre et à faire justice. Mais la littérature n’exclut pas l’erreur judiciaire (Postel, 2013 ; Menegaux, 2018) et n’hésite pas à mettre en fiction des détectives amateurs qui essaient de remédier aux défaillances humaines dans un souci éthique.
Notre colloque s’articulera autour des notions et concepts liés au rapport entre légitimité, égalité et légalité et leurs représentations littéraires. Pour interroger cette question, nous proposons les axes de réflexion suivants, sachant que toute autre proposition pertinente pourra être acceptée :
- Utopies, dystopies et hétérotopies : critiques sociales et espaces alternatifs ;
- Égalités, inégalités et justice sociale en littérature ;
- Figures du justicier et du criminel : enjeux littéraires et éthiques ;
- Procès et justice : entre fiction littéraire et réalité.
Ce colloque est ouvert à tous les champs et corpus littéraires, et à toutes les cultures sans restriction aucune. Nous encourageons les participants à mettre en œuvre différentes approches et démarches théoriques (littérature, anthropologie, linguistique, sémiotique, stylistique, sociologie de la littérature, histoire, géographie humaine, psychanalyse, analyse du discours, etc.).
Modalités de participation
Les propositions devront comporter un titre, le résumé de la communication (300 mots max.) et une courte notice biographique. Elles sont à envoyer avant le 11 mai 2025 à l’adresse suivante : litteratures.legitimite.legalite@gmail.com. Nous précisons que les communications ne pourront se faire qu’en français ou en anglais.
– Les frais d’inscription au colloque s’élèveront à :
50 € / 165 DT pour les chercheur-e-s professionnel-le-s.
20 € / 65 DT pour les étudiant-e-s, doctorant-e-s ou jeunes chercheur-e-s encore sans profession.
– Les frais de déplacements et d’hébergement sont à la charge des participants. L’organisation pourra néanmoins fournir des informations pratiques pour faciliter leurs démarches (suggestions d’hôtels, itinéraires, etc.).
Organisation du colloque
Laboratoire Intersignes (LR14ES01), Université de Tunis (UT);
Laboratoire Analyse Textuelle, Traduction et Communication (ATTC), Université de la Manouba (UMA).
Coordination
Afef Arous-Brahim (Université de Jendouba / Intersignes LR14ES01– UT)/Textes & Cultures UR4028 — U. Artois).
Donia Boubaker (Université de Jendouba / ATTC – UMA/ UMR 9022 Héritages — CY Cergy Paris Université/ CNRS/Ministère de la Culture).
Comité scientifique
Christine Baron (Université de Poitiers)
Emna Beltaif (Université de Tunis)
Sylvie Brodziak (CY Cergy-Paris Université)
Jamil Chaker (Université de Tunis)
Mounira Chatti (Université Paris VIII)
Samia Kassab-Charfi (Université de Tunis)
Fadhila Laouani (Université de la Manouba)
Laure Lévêque (Université de Toulon)
Sonia Mbarek (Université de Tunis)
Mohamed Salah Omri (Université d’Oxford)
Hela Ouardi (Université de la Manouba)
Jouda Sellami (Université de la Manouba)
Farah Zaïem (Université de la Manouba)
Sonia Zlitni-Fitouri (Université de Tunis)
Comité d’organisation
Meriem Abbes (Université de Tunis)
Afef Arous-Brahim (Université de Jendouba / Université de Tunis/Université d’Artois)
Donia Boubaker (Université de Jendouba / Université de la Manouba/ CY Cergy Paris Université)
Zeineb Golli (Université de Tunis)
Yosr Larbi ( Université de la Manouba)
Oumaima Mayara (Université de Tunis)
Marouene Souab (Université de la Manouba)
Eya Trabelsi (Université de la Manouba)
⁂
The Academic research laboratories Intersignes (University of Tunis)
and Analyse Textuelle, Traduction et Communication (University of Manouba),
In partnership with The Senghor Chair of the Francophonie of the University of Tunis and
The Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb
organize an
International Conference
Literature: Legitimacy, Legality and Equality
Tunis – From November 13th to 14th 2025
Trials, crimes, punishments and the quest for truth and justice, are at the heart of many literary works and raise the issues of legitimacy and illegitimacy, equality and legality, of justice and injustice. Fiction and philosophical works dealing with these issues can be traced as far back as the Antiquity (Euripides, Sophocles, Socrates, Plato, etc). The laws that govern individual and public life are, indeed, closely linked to the literary world and, ensuing dialogues and tensions, reflect the complexity of human relationships often marked by inequalities.
In his Nicomachean Ethics, Aristotle gives the following definition: “The ‘just’ therefore means that which is lawful and that which is equal or fair, and ‘the unjust’ means that which is illegal and that which is unequal or unfair” (V, 2). Equality and legality should thus make it possible to guarantee the equitable distribution of goods and social harmony. Undeniably, the dialectical association of these two principles poses a problem as the Aristotelian egalitarian ideal is confronted with the raw and inextricable aspects of the real world.
This tension gave way to two literary genres which explore possible alternatives to society. While utopia is “critical of reality” (Drouin-Hans, 2015), dystopia becomes a “distorted mirror of the present” (Claisse, 2010: § 3). By including a reflection on the laws and rights that govern human relations, these two visions of the future (Political, social and moral), gave birth to dreams of equality (More, 1516) or threats of injustice (Orwell, 1949; Jardin, 2004; Rufin, 2004, Le Clézio, 2006, etc.). Such a reflection, however, must also be open to heterotopias, those isolated counter-spaces, deeply rooted in the present time but governed by their own rules (Foucault, 2009).
Moreover, reflections on present time society have given rise to literary works defending the “underdog” and placing equity as a fundamental value. Seeking social justice, they address various themes such as working-class conditions, the corporate world, women’s and minorities rights. Through stories featuring characters of victims or rebels who try to take their destiny into their own hands, these authors point out the inequalities that plague society (Hugo, 1862; Sand, 1832; Bon, 1982; Despentes, 2006; etc).
Such works invite us to have a “functional” approach to literature as its “restorative” dimension (Gefen, 2017) is quite significant. We would note, however, that this “restorative” dimension is going through a substantial evolution nowadays. It is no longer a matter of “expiation” and “satisfaction” only, it now involves access to justice and psychological reconstruction. Literature therefore offers a space for expression to the voiceless and ensures that they are recognized for the wounds and evils they have suffered. While prison literature is a good illustration of this approach (Ghandi, 1932; Naccache, 1982; El-Saadawi, 1984; Genet, 1946, Liscano, 2008; etc.), the literary production evolving from the liberation of speech on sexual violence contributes to it just as much. Texts such as Le Consentement (Springora, 2020) and The Familia grande (Kouchner, 2021) have indeed played an essential role in raising awareness among the general public and in the adoption, in France, of the 21 April 2021 law protecting minors from sexual crimes and incest.
Using the right words, delivering convincing and persuasive speeches, in tribunes and courtrooms, also contribute to awaken consciences and influences minds: emblematic figures such as Gisèle Halimi and Martin Luther King have put their eloquence and rhetoric skills at the service of their fights against injustice and inequality. But the power of speech is not limited to defending just causes. It guarantees fair treatment, because everyone, whether victim or criminal, plaintiff or defendant, has the right to defend himself/ herself and to be defended (Markowic, 2018).
Unveiling the truth and seeking justice, are at the core of a judicial literature which aspires, through its narrative, to question moral dilemmas. This gave way to a literary genre relating to courthouses and courts of justice engaging the reader to approach news items and other complex cases, whether real or fictional, with empathy (Gide, 1913; Giono, 1947; Von Schirach, 2015; Jaenada, 2022, 2021, 2017; Reza, 2024; etc). Putting the world on trial does not exclude pointing out the inequities of the judicial world. The instrumentalization of the law and the staging of legal cases threaten both freedom and equality (Kafka, 1925; Camus, 1942). The literary text becomes a “committed struggle for truth against lies, for justice against arbitrariness” (Clemenceau, 1899: p. 276). Caught up in the judicial machine, some writers, such as Flaubert, Zola and Guyotat, were prosecuted because of their works and ideas; others, such as Giono, were confronted with disputes with their own publishers.
The notion of justice and injustice is pervasive in the story telling process when it comes to investigations. In the works of Simenon, Fred Vargas or Agatha Christie, solving a crime, elucidating a mystery or exposing a lie, is the mission of the seasoned investigator, determined to find the criminals, prosecute and bring them to justice. But this literature does not exclude judicial error cases (Postel, 2013; Menegaux, 2018) and does not hesitate to invent amateur detectives who will, for ethical reasons, try to make up for any human shortcomings.
Our conference will focus on notions and concepts pertaining to legitimacy, equality and legality and their literary representations. In our proceedings, we would propose to examine the following themes, but we remain open to any relevant alternative proposals:
- Utopias, dystopias and heterotopias: social critiques and alternatives.
- Equality, Inequality and Social Justice in Literature.
- Figures of the Vigilante and the Criminal: Literary and Ethical Issues.
- Trial and justice: between literary fiction and reality.
This conference is open to all literary fields and corpuses, to all cultures with no restriction of whatsoever nature. We urge and encourage all participants to implement different practical and theoretical approaches in their contributions (literature, anthropology, linguistics, semiotics, stylistics, literary sociology, history, human geography, psychoanalysis, discourse analysis, etc.).
Participations
Proposals should include a title, an abstract (300 words max.) and a short bio. They are to be sent before 11th May 2025 to the following address: litteratures.legitimite.legalite@gmail.com.
We would draw your attention that presentations can only be made in French or in English.
– Registration Fees :
- 50 € / 165 TD for researchers and professionals.
- 20 € / 65 TD for students, doctoral students or junior researchers (still seeking jobs).
– Travel and accommodation costs are at participants’ expenses.
The organisers shall, however, provide them with practical information to facilitate their efforts (hotel suggestions, itinerary, etc.).
Organizers
The Academic research laboratory Intersignes, University of Tunis (UT)
The Academic research laboratory Analyse Textuelle, Traduction et Communication (ATTC), University of Manouba (UMA)
Coordination
Afef Arous-Brahim (University of Jendouba / Intersignes LR14ES01 – UT/Textes et Cultures UR 4028 — University of Artois);
Donia Boubaker (Université de Jendouba / ATTC – UMA/ UMR 9022 Héritages— CY Cergy Paris University— CNRS/Ministry of Culture).
Scientific Committee
Christine Baron (University of Poitiers)
Emna Beltaif (University of Tunis)
Sylvie Brodziak (CY Cergy-Paris University)
Jamil Chaker (University of Tunis)
Mounira Chatti (University of Paris VIII)
Samia Kassab-Charfi (University of Tunis)
Fadhila Laouani (University of Manouba)
Laure Lévêque (University of Toulon)
Sonia Mbarek (University of Tunis)
Mohamed Salah Omri (University of Oxford)
Hela Ouardi (University of Manouba)
Jouda Sellami (University of Manouba)
Farah Zaiem (University of Manouba)
Sonia Zlitni-Fitouri (University of Tunis)
Organizing Committee
Meriem Abbes (University of Tunis)
Afef Arous-Brahim (University of Jendouba / University of Tunis)
Donia Boubaker (University of Jendouba / University of Manouba)
Zeineb Golli (University of Tunis)
Yosr Larbi (University of Manouba)
Oumaima Mayara (University of Tunis)
Marouene Souab (University of Manouba)
Eya Trabelsi (University of Manouba)
Bibliographie indicative
Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, Flammarion, 2004.
Baron, Christine, « La littérature, auxiliaire de l’acte de juger ? Contexte américain, contexte continental » dans Les Cahiers de la Justice, 2016 ǀ 2, n° 2, 2016, p. 371-382.
Baron, Christine, La littérature à la barre (XXe-XXIe siècle), Paris, CNRS, 2021.
Barraband, Mathilde et Demanze, Laurent, « Littérature du procès, procès de la littérature » dans Revue critique de fixxion française contemporaine [en ligne], 26 | 2023, mis en ligne le 15 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/fixxion/10406
Bellagamba, Ugo, « L’utopie a-t-elle des leçons de justice à nous donner ? » dans Délibérée, 2022 ǀ 1, n° 15, 2022, p. 43-48.
Chardin, Philippe et Leclerc, Yvan, « Crimes écrits. La littérature en procès au XIXe siècle » dans Romantisme, 1993, n° 79, Masques, p. 124-126. URL : www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1993_num_23_79_6202
Claisse, Frédéric, « Futurs antérieurs et précédents uchroniques : l’anti-utopie comme conjuration de la menace » dans Temporalités [En ligne], 12 | 2010, mis en ligne le 15 décembre 2010. URL : http://journals.openedition.org/temporalites/1406
Clemenceau, Georges, Iniquité, Paris, Stock, 1899.
Drouin-Hans, Anne-Marie, « Rêves d’éducation, éducations de rêve : les leçons de l’utopie » dans Le Philosophoire, 2015 ǀ 2 n° 44, 2015, p. 39-54. URL : shs.cairn.info/revue-le-philosophoire-2015-2-page-39?lang=fr
Dubois, Jacques, L’Institution de la littérature. Introduction à une sociologie, Paris, Bernard Nathan / Editions Labor, 1978.
Foucault, Michel, Les Corps utopiques, les hétérotopies [1966], Paris, Nouvelles Éditions Lignes, 2009.
Gefen, Alexandre, Réparer le monde, Paris, Corti, 2017.
Genel, Katia et Deranty, Jean-Philippe, Reconnaissance ou mésentente ? Un dialogue critique entre Jacques Rancière et Axel Honneth, Paris, Éditions de la Sorbonne, coll. « Philosophies pratiques », 2020.
Lacroix, Justine et al., « Justice ou réparation ? : Introduction » dans Esprit, 2024 ǀ 3, 2024, p. 35-39.
Lévêque, Laure, Le Rouge ou le noir ? Quand la fiction futorologique française prophétisait des lendemains qui (dé)chantent (1800-1975), Arcidosso, Effigi Edizione, 2023.
Mantovani, Dario (dir.), L’Équité hors du droit, Paris, Collège de France, 2023.
Meyer-Plantureux, Chantal, « Théâtre et justice d’Eschyle à Jean Vilar » dans Les Cahiers de la Justice, 2015 | 1, n° 1, 2015, p.37-58. URL : droit.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2015-1-page-37?lang=fr
Nussbaum, Martha, L’Art d’être juste. L’imagination littéraire et la vie publique [1997], trad. Solange Chavel, Paris, Flammarion, 2015.
Pironnet, Quentin, « Droit et dystopies » dans Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2016 ǀ 2, vol. 77, 2016, p. 363-392.
Ricoeur, Paul, L’Idéologie et l’utopie, Paris, Seuil, 1997.
Roman, Myriam, Le Droit du Poète : la justice dans l’œuvre de Victor Hugo, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2023.
Vergès, Jules, Justice et littérature, Paris, PUF, 2011.
- Responsable :
Les laboratoires de recherche Intersignes (Université de Tunis) et Analyse Textuelle, Traduction et Communication (Université de la Manouba) - Url de référence :
https://www.fshst.rnu.tn - Adresse :
Tunis
https://www.fabula.org/actualites/125091/litteratures-legitimite-et-l-egalite.html
1.22 Boualem Sansal et la littérature mondiale / Boualem Sansal and World Literature
Boualem Sansal et la littérature mondiale / Boualem Sansal and World Literature (ENS Lyon)
- Date de tombée (deadline) : 20 Février 2025
Boualem Sansal et la littérature mondiale
Boualem Sansal and World Literature
Journée d’étude le 14 mars 2025 à l’ENS Lyon
Journée organisée par les laboratoires CERCC de l’ENS Lyon et CEREdI de l’Université de Rouen-Normandie,
avec le concours du collectif Littérature et liberté.
(English text follows.)
Les langues de travail seront le français et l’anglais, mais les communications pourront être prononcées dans d’autres langues si une traduction est possible.
Cette journée est la première d’une série intitulée «Je l’ai entendu comme un appel…»1, à l’initiative du collectif Littérature et liberté (https://www.litterature-liberte.org/), pour continuer à faire vivre l’œuvre de Boualem Sansal tandis qu’il est réduit au silence, détenu depuis plus de deux mois au moment de la publication de cet appel à communications. Les journées suivantes porteront notamment sur «Boualem Sansal et la philosophie», et sur la traduction et la réception de Sansal dans le monde.
Appel à communications
Dans une communication mettant en évidence la veine faulknérienne qui irrigue l’œuvre de Rachid Boudjedra, Hafid Gafaïti s’est étonné de voir qu’on supposait toujours que les influences des écrivains algériens francophones se réduisaient à la littérature française et à la littérature algérienne2. L’actualité et la réception de Boualem Sansal le cantonnent trop souvent à ce face-à-face franco-algérien, champ qu’élargit pourtant très clairement l’auteur, dont l’œuvre est nourrie par des lectures ouvertes à tous les horizons. Le terreau intertextuel mondial de Sansal est particulièrement riche: Dante, le théâtre élisabéthain, Cervantès, Dostoïevski, Thoreau, Kafka, Soljenitsyne, Orwell, Gheorgiu, Eco, Grossman… Et la liste est loin d’être exhaustive: dans un article récent, Michel Pierre montre que Boualem Sansal se place dans «la lignée des grands auteurs sud-américains, de Garcia Marquez à Pablo Neruda, d’Alejo Carpentier à Vargas Llosa», avant de rappeler que «son œuvre a l’ampleur des grand récits universels finalement rares à l’échelle mondiale»3. Or, c’est aussi à cette échelle que Boualem Sansal entend de plus en plus explicitement réfléchir et agir4.
La visée de cette journée est de relire l’œuvre de romancier et d’essayiste de Sansal à la lumière de son inscription dans la littérature mondiale, afin de mieux en dégager l’ampleur et la portée. Elle permettra également de préciser la conception que Boualem Sansal se fait lui-même de la «littérature mondiale» (notion formulée par Goethe en 1824, relayée par les interrogations sur la mondialisation de la littérature), ou de la «littérature-monde» (Boualem Sansal a contribué au manifeste Pour une littérature-monde5). Nous nous demanderons notamment si la pratique de la «littérature-monde» telle que Sansal l’envisage peut contribuer à la réalisation de son idéal du «citoyen du monde», c’est-à-dire du citoyen de la «République mondiale des Hommes libres, rois en leurs demeures»6.
Les communications pourront porter notamment sur:
- l’étude de sources et d’influences sur la pensée comme sur l’écriture de Sansal, venant de la littérature mondiale de toutes périodes historiques et de toutes langues;
- l’étude des relations concrètes que Sansal entretient avec des auteurs de différents pays du monde;
- le rapport de Sansal romancier et essayiste à l’intertexte mondial;
- le regard porté par Sansal sur des cultures ou des littératures particulières;
- la relation entre langue, culture et littérature dans l’idée que Sansal se fait du «citoyen du monde»;
- le regard posé par Sansal sur la mondialité, son point de vue sur la mondialisation culturelle, sa pensée du cosmopolitisme et de l’articulation du particulier avec l’universel;
- le message adressé à l’humanité dans son ensemble par le romancier ou par l’essayiste Sansal, ancré dans la spécificité de son rapport au monde.
Les différentes journées d’étude du cycle «Je l’ai entendu comme un appel…» feront l’objet d’une publication, sur internet ou en volume.
Comité d’organisation: Éric Dayre (CERCC, ENS Lyon), Hubert Heckmann (CEREdI, Université de Rouen-Normandie), Guillaume Houdant, Lisa Romain, Jean Szlamowicz (Université de Bourgogne).
Comité scientifique: Mohamed Aït-Aarab (maître de conférences en Littératures francophones, Université de la Réunion), Éric Dayre (Professeur de littératures comparées à l’ENS de Lyon), Guy Dugas (Professeur émérite de Littérature comparée, Université Montpellier III), Michel S. Laronde (Professor Emeritus of French and Francophone Studies, University of Iowa), Lisa Romain (enseignante et auteur d’une thèse sur l’œuvre de Boualem Sansal).
Les propositions de communication (environ 300 mots), accompagnées d’une courte biobibliographie (situation institutionnelle, laboratoire, champs de recherche et publications), devront être envoyées avant le 20 février 2025 à l’adresse suivante : contact [a] litterature-liberte.org
Notes:
1 Écho à l’incipit de Boualem Sansal, Rue Darwin, Gallimard, 2011.
2 Hafid Gafaïti, dans une communication intitulée: «L’héritage faulknérien du Nouveau Roman et sa transmission au roman maghrébin francophone», entend ainsi par exemple réaffirmer l’influence exercée par le roman américain sur cette génération. Cf. Programme du 32e Congrès Mondial du CIEF, p. 40. https://www.crhia.fr/doc_upload/Programme_congres%20CIEF%202018-.pdf.
3 Michel Pierre, «Pour Boualem Sansal. Plaidoyer pour un grand écrivain et un homme libre», herodote.net, 5 janvier 2025, en ligne : Pour Boualem Sansal – Plaidoyer pour un grand écrivain et un homme libre – Herodote.net (consulté le 5 janvier 2025).
4 C’est en ce sens que se comprend la réflexion du Train d’Erlingen sur «le livre qui reste à écrire» et l’appel de sa narratrice: «j’ai découvert que notre histoire n’était pas racontable en la forme d’un roman, j’avais présumé de mes forces littéraires. L’histoire est multiple, elle se déroule sur plusieurs plans, plusieurs pays, plusieurs strates historiques, impliquant des personnes n’ayant pas de lien entre elles» (Boualem Sansal, Le Train d’Erlingen ou La Métamorphose de Dieu, Gallimard, 2018, p. 242). De fait, Léa invite immédiatement après le lecteur à se joindre à une grande chaîne qui traverse le temps et l’espace et à compléter les «pièces détachées» du roman, dont certaines sont, précisément, des fiches de lecture consacrées à La Métamorphose de Kafka ou aux Immortels d’Agapia de Gheorghiu.
5 Michel Le Bris et Jean Rouaud (dir.), Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007.
6 Boualem Sansal, Lettre d’amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la terre, Paris, Gallimard, 2021.
—
Boualem Sansal and World Literature
Symposium organized by the CERCC (ENS Lyon) with the support of the CEREdI (University of Rouen-Normandy) and “Littérature et Liberté”.
Date: 14th March 2025
Location: ENS Lyon
Languages: French and English will be the working languages, but presentations can also be made in other languages if translation is possible.
This symposium is the first in a series entitled “I Heard It as a Call…”,7 initiated by the “Littérature et Liberté ” organisation (https://www.litterature-liberte.org/) to keep Boualem Sansal’s work alive while he remains silenced, being detained for two months at the time of publishing this call for papers. Upcoming symposiums will focus on topics such as “Boualem Sansal and Philosophy” and the translation and reception of Sansal’s work worldwide.
Call for Papers
In a presentation on Faulkner’s influence on the works of Rachid Boudjedra, poet and critic Hafid Gafaïti,8 expressed his surprise at how French-speaking Algerian writers are often assumed to be influenced solely by French and Algerian literature. Boualem Sansal is all too often confined to such a limited French-Algerian framework. Yet, he transcends categories and labels, drawing inspiration for his work from diverse authors in many languages and cultural contexts.
Sansal’s intertextual references are particularly rich, including Dante, Elizabethan theater, Cervantes, Dostoevsky, Thoreau, Kafka, Solzhenitsyn, Orwell, Gheorghiu, Eco, Grossman, and many more. In a recent article, historian Michel Pierre noted that Boualem Sansal positions himself “in the lineage of great South American authors, from Gabriel Garcia Marquez to Pablo Neruda, from Alejo Carpentier to Mario Vargas Llosa,” further adding that “his work has the magnitude of the great universal stories, which are ultimately rare on a global scale.”9 Moreover, Sansal explicitly aims to present an increaasingly global perspective.10
The objective of this symposium is to revisit the novelist and essayist’s body of work in light of its place within world literature to better understand its scope and significance. This event will also aim to clarify Boualem Sansal’s own conception of “Weltliteratur” (a term coined by Goethe in 1824, now given new relevance by discussions on the globalization of literature) or “littérature-monde” (Sansal contributed to the manifesto Pour une littérature-monde11). One may reflect on whether the practice of “littérature-monde” as envisioned by Sansal can contribute to the realization of his ideal of a “world citizen,” that is, the citizen of the “Global Republic of Free Men, kings in their own homes.”12
Proposed Topics for Papers
Contributions may address, among other topics:
- Studies on sources and influences that have shaped Sansal’s thought and writing, derived from world literature across various historical periods and languages;
- Analyses of Sansal’s concrete relationships with authors from various countries;
- Sansal’s relationship with global intertexts as a novelist and essayist;
- Sansal’s perspective on specific cultures or literatures;
- The relationship between language, culture and literature in Sansal’s conception of the “world citizen”;
- Sansal’s views on global interconnectedness, cultural globalization, cosmopolitanism, and the balance between the particular and the universal;
- Messages addressed to humanity by Sansal, as both novelist and essayist, grounded in his unique connection to the world.
The various symposiums in the cycle “I Heard It as a Call…” will be published either online or in print.
Organizing Committee: Éric Dayre (ENS Lyon), Hubert Heckmann (Université de Rouen-Normandie), Guillaume Houdant, Lisa Romain, Jean Szlamowicz (Université de Bourgogne).
Scientific Committee: Mohamed Aït-Aarab (maître de conférences en Littératures francophones, Université de la Réunion), Éric Dayre (Professeur de littératures comparées à l’ENS de Lyon), Guy Dugas (Professeur émérite de Littérature comparée, Université Montpellier III), Michel S. Laronde (Professor Emeritus of French and Francophone Studies, University of Iowa), Lisa Romain (enseignante et auteur d’une thèse sur l’œuvre de Boualem Sansal).
Abstracts (around 300 words) accompanied by a short biobibliography (institutional affiliation, laboratory, research areas, and publications) should be sent before February 20, 2025 to the following email address: contact [a] litterature-liberte.org
Notes
7 A phrase taken from the opening of Boualem Sansal’s novel Rue Darwin, Gallimard, 2011.
8 «L’héritage faulknérien du Nouveau Roman et sa transmission au roman maghrébin francophone» asserts the influence of American novels over his generaiton of writers. Cf. Programme of the 32nd Congrès Mondial du CIEF, p. 40. https://www.crhia.fr/doc_upload/Programme_congres%20CIEF%202018-.pdf.
9 Michel Pierre, «Pour Boualem Sansal. Plaidoyer pour un grand écrivain et un homme libre», herodote.net, 5 January 2025 (online).
10 This is how one should read Sansal’s reflection in Le train d’Erlingen about “the book that remains to be written”, as well as the call from the narrator: “I discovered that our story could not be told in the form of a novel. I had overestimated my literary abilities. The story is multifaceted; it unfolds across multiple layers, multiple countries, and multiple historical strata, involving people who have no connection with each other” (Le train d’Erlingen ou la metamorphose de Dieu, Boualem Sansal, Gallimard, 2018, p. 242). Léa thus immediately invites the reader to join a great chain through time and space so as to complete the “scattered pieces” of the novel, some of which are, precisely, reading notes dedicated to Kafka’s Metamorphosis or Gheorghiu’s The Immortals of Agapia.
11 Michel Le Bris et Jean Rouaud (dir.), Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007.
12 Boualem Sansal, Lettre d’amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la terre, Paris, Gallimard, 2021
- Responsable :
CERCC (ENS Lyon), CEREdI (Université de Rouen-Normandie), - Url de référence :
https://www.litterature-liberte.org/appel-a-communications-boualem-sansal-et-la-litterature-mondiale/ - Adresse :
ENS Lyon
1.23 Et plus ultra… III. L’outre-vie dans les littératures francophones (Lille)
Et plus ultra… III. L’outre-vie dans les littératures francophones (Lille)
- Date de tombée (deadline) : 19 Mai 2025
Appel à communications
Journée d’étude : « Et plus ultra… III. L’outre-vie dans les littératures francophones »
6 novembre 2025
Université de Lille, ALITHILA (ULR 1061), Centre SémaFores (observatoire des écritures dans les mondes francophones)
Organisée par Frédéric Briot et Marie Bulté
Et plus ultra… est un cycle de trois journées d’étude, qui donnera lieu à un ouvrage collectif, consacrées aux outrepassements et autres formes de débordements observables dans les littératures des mondes francophones, voire qui les constituent intrinsèquement. En prenant comme figure tutélaire Ulysse et son dernier voyage tel qu’il le narre lui-même dans la Divine Comédie de Dante, la première journée (tenue en novembre 2022) s’était tout logiquement consacrée au franchissement, et aux points de bascule et de non-retour : comment passer d’un dedans à un dehors en bravant l’interdit pesant sur ce passage ? La deuxième journée (en novembre 2023) s’était alors attachée, autant qu’il est possible de le faire, à prêter l’oreille et l’attention aux voix du dehors, ces voix entre inouï et inaudible, ces voix impossibles et qui sont pourtant là, aporétiques en un mot. La troisième journée, prévue le jeudi 06 novembre 2025, va avoir moins un sujet d’étude que d’inquiétude : après le passage transgressif vers un dehors, puis la confrontation à l’altérité, un retour est-il possible vers le dedans ? Et s’il y a suspicion de retour, qu’est-ce qui revient exactement ?
Chez Dante, Ulysse – après être revenu à Ithaque – transgresse les limites du monde connu et, bravant l’interdit des colonnes d’Hercule, navigue vers l’inconnu puis sombre corps et biens. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, puisque Dante le voit dans la huitième bolge du huitième cercle de l’Enfer. Ulysse est parti du monde grec, pour revenir dans le monde chrétien. Il est parti vivant, pour revenir comme mort à tout jamais. Il est parti en héros, héros de la victoire sur Troie, héros venant à bout de tous les obstacles qui se dresseront ensuite (Polyphème, les Sirènes…), il revient comme damné perpétuel. Ce qui revient n’a plus rien à voir avec ce qui est parti – le temps du dehors et celui du dedans ne sont point synchrones, et comme dans toute histoire de fantôme ou de spectre qui se respecte, le temps est déjointé. C’est cet écart, cette différence, cette altération, qui sera l’objet de nos inquiétudes et de nos soins. D’une certaine manière, après l’anabase et l’aporie, voici désormais venu le temps de la métalepse, le retour comme autre, le retour comme jamais au même niveau.
Ainsi, du dehors, rien ne peut revenir indemne, que ce soit de l’ordre du dommage, de la perte, ou du gain, mais comment en être sûr ? On peut penser naturellement au Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire où le retour, entre doute et exaltation, entre euphorie et dysphorie, fait naître le chant de la Négritude, ou à sa plus inquiétante résurgence dans L’Énigme du retour de Dany Laferrière. Pensons également au personnage écrivain de Wirriyamu de Williams Sassine qui, plus mort que vivant, cherche à rejoindre son village natal. L’on peut aussi ne pas réussir à revenir, comme dans la nouvelle « Retour non retour » du recueil Oran, langue morte d’Assia Djebar ; on peut même ne pas en revenir, comme Samba Diallo dans L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane.
Revenir du dehors, faire retour, c’est inexorablement entrer dans l’outre-vie, comme l’exprime magistralement Solo d’un revenant de Kossi Efoui où la polysémie du titre parle d’elle-même. Mais l’outre-vie peut aussi être outrepassante, peut déborder, franchir violemment les limites qui la confinait à un éternel dehors. Ainsi en va-t-il des « revenance[s] de l’histoire » (Jean-François Hamel). Ces revenances s’incarnent, au cœur du roman Les Aubes écarlates de Léonora Miano, en spectres de la Traite négrière, spectres de celles et ceux qui n’ont jamais atteint les Caraïbes, aux marges tant du dedans que du dehors, et qui font retour pour réclamer une place dans le dedans oublieux. Elles s’incarnent également en zombies de la littérature haïtienne qui viennent faire exploser toute butée stable entre le dehors et le dedans, entre le passé et le présent, entre la vie et la mort, où la mémoire de l’esclavage s’énonce d’outre-vie comme dans Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre. Elles s’incarnent encore en fantômes de victimes de génocides mises au dehors de l’imaginaire collectif, mises au silence de l’Histoire, comme les Héréros et les Namas dans Pistes de Penda Douf, qui reviennent pour tenter de transmuer le nulle part en quelque part. Mais il arrive aussi que le dehors fasse voler en éclats le dedans, quand l’un et l’autre deviennent indiscernables. Ainsi en va-t-il du dedans si vainement cloisonné du protagoniste de L’Attentat de Yasmina Khadra que sa femme fait exploser, que sa femme spectralise, ouvrant alors le dedans au dehors à moins que ce ne soit l’inverse ; ainsi en va-t-il, différemment certes, de Littoral ou d’Incendies de Wajdi Mouawad, quand ce qu’on croyait être un départ devient un retour, inaugurant un vertigineux va-et-vient entre dehors et dedans où la vie ne peut désormais qu’être outre, au-delà, au bord de l’abîme.
Ce retour comme écart et dissemblance, comme altérité et aspérité, comme énigme et incertitude, moins comme retour ferme sur une terre à soi que ricochet labile de soi, nous semble marquer avec acuité les littératures des mondes francophones, ces littératures précisément non métropolitaines, ces littératures si aisément reléguées au dehors, ces littératures où le pays natal se mue bien souvent en « pays fatal » pour reprendre la formule forte de La Plus Secrète Mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr. Il s’agira donc d’examiner toutes les formes que peut prendre cette outre-vie, cette nouvelle façon d’habiter et de hanter le dedans, un dedans qui ne serait plus un début, une origine mais un devenir.
—
Les propositions de communication (notice bio-bibliographique, titre de la communication, résumé de 300 mots) pourront nous parvenir jusqu’au 19 mai 2025 aux adresses suivantes : marie.bulte@univ-lille.fr et frederic.briot@univ-lille.fr .
- Responsable :
Frédéric Briot & Marie Bulté - Url de référence :
https://semafores.hypotheses.org/category/actualite-de-la-recherche/semafores/appels - Adresse :
Université de Lille
https://www.fabula.org/actualites/125384/appel-a-communications-journee-d-etude-et-plus.html
2.24 Penser (ou repenser) les recherches sur les Afriques depuis la France. Doctoriales 2025 (Campus Condorcet, Aubervilliers)
Penser (ou repenser) les recherches sur les Afriques depuis la France. Doctoriales 2025 (Campus Condorcet, Aubervilliers)
- Date de tombée (deadline) : 28 Février 2025
DOCTORIALES
Penser (ou repenser) les recherches sur les Afriques depuis la France,
les 27 et 28 mai 2025 à Aubervilliers, Campus Condorcet
Organisées par le Bureau des Jeunes Chercheur.euse.s du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur les “Études africaines en France” (UAR 2999 “Études aréales”)
Le Bureau Jeunes Chercheur.euse.s du GIS Etudes africaines en France organise ses premières (post)doctoriales autour des pratiques de recherche de jeunes chercheur.e.s dont les objets d’études portent sur les Afriques depuis la France. L’objectif est d’inviter les jeunes chercheur.e.s à avoir une approche réflexive sur leur positionnalité, c’est-à-dire une analyse introspective sur “ l’impact des structures de pouvoir explicites et implicites sur le processus de recherche” (Balla, 2024); ainsi que les choix subjectifs opérés dans la conduite des enquêtes (Quiroz, 2019). Cela englobe les rapports et relations établis avec les terrains de recherche et les personnes enquêté.e.s, notamment au regard des ancrages épistémologiques qui situent la production et la restitution des connaissances.
Il s’agit en effet de caractériser les pratiques et postures qui constituent le champ des études africaines, dans l’idée de questionner la construction de discours et de savoirs sur les Afriques (Mudimbe, 1988; Ndlovu-Gatsheni, 2018), et plus spécifiquement depuis la France. La question se pose aujourd’hui dans un contexte où les études africaines sont particulièrement institutionnalisées en France, avec des structures identifiées à l’échelle des universités, nationale, ainsi qu’à l’étranger avec des centres de recherche (Copans, 1971). En parallèle de cette organisation institutionnelle et scientifique, se poursuivent les débats sur la décolonisation et la nature de la coopération dans les sciences sociales entre le continent et la France. Ces débats se retrouvent au sein même du champ d’études qualifié d’études africaines (Marchesin, 2021 ; Olivier de Sardan, 2000; Barro, 2010). En effet, la production de savoirs depuis la France s’inscrit dans un champ historiquement marqué par des inégalités structurelles, issues notamment de l’héritage colonial, et au sein duquel les appels à la décolonisation épistémologique fusent, que ce soit depuis le Nord ou les Suds (Comaroff et Comaroff, 2012 ; Ansoms, Nyenyezi et al, 2020). Aussi, il n’est plus uniquement question de renforcer la visibilité des études africaines mais de mettre en discussion les processus de construction des savoirs, notamment par la prise en compte et la remise en question de “la suprématie épistémologique occidentale” (Beaud, 2021), ainsi que le poids des rapports de pouvoir et de domination qu’elle entraîne. Cela implique évidemment de questionner le statut du champ au sein des sciences sociales en France en général (Banégas, 2015).
C’est dans la lignée de ces réflexions enclenchées depuis une vingtaine d’années (par des acteur.es inscrit.es dans les études africaines ou non) que sont pensées ces doctoriales, en prenant le parti d’un regard réflexif sur les modalités d’une production scientifique sur les Afriques. L’ambition de ces journées est ainsi de rassembler des jeunes chercheur.e.s pour discuter des conditions matérielles et symboliques de production de leurs recherches. En créant un temps d’échanges et de rencontres propice à l’introspection épistémologique, éthique et méthodologique par les acteur.ice.s d’une “jeune recherche” sur les Afriques, le BJC s’inscrit dans la continuité des débats et réflexions qui animent depuis sa création ce vaste champ d’études.
Lorsque les études s’organisent depuis la France, comment se construisent et se mettent en œuvre les processus de recherche ? Quels enjeux de pouvoirs sont susceptibles de se (re)jouer dans la recherche sur les Afriques ? Quelles modalités de restitutions sont envisagées dans les pays de recherche ? Quelles sont les conditions matérielles (financement, éloignement familial, etc.) de ces recherches ? Comment la “jeune recherche” peut-elle développer des collaborations fructueuses avec les collègues depuis les Afriques ? Quels sont les contours de ce champ d’études en pratique? Existe-t-il un renouvellement des pratiques de recherche ?
Il s’agira, en somme, de réfléchir collectivement à ce que cela signifie d’être un.e chercheur.e qui travaille sur les Afriques depuis la France et sur les implications de conduire son travail de recherche, notamment à l’heure où une approche décoloniale des savoirs invite à des positionnements privilégiés/percutants/originaux/pertinents et propices pour (re)penser les études africaines (Ndlovu-Gatsheni, 2021). Ces contextes et cet enjeu de “décolonisation” de la pensée pourront constituer un questionnement transversal aux réflexions développées.
Les communications attendues peuvent s’inscrire, sans toutefois s’y limiter, dans l’un ou plusieurs des cadres de réflexion suivants :
- Construction de la recherche
Le premier axe portera sur la construction des objets d’études entrant dans le champ scientifique et sur la planification des études en terrains africains. Pourront être interrogés tant les ancrages épistémologiques qui façonnent la recherche que son inscription institutionnelle. Le panel pourra accueillir par exemple des travaux analysant des situations d’injustice épistémiques (Chakrabarty, 2009; Fricker, 2011) ou proposant la mise en valeur des épistémologies du sud (Santos, 2016). Les contributeur.ice.s reviendront sur l’environnement académique, sur leurs statuts de chercheur.euse.s au sein de cet environnement, sur les apports théoriques et méthodologiques mobilisés. Nous interrogerons le procédé par lequel ce “bagage” scientifique façonne les recherches menées et pourrait représenter des apports et/ou des limites dans la production des savoirs. En ce sens, ce premier axe pourra ouvrir des pistes de réflexion sur les opportunités ou les défis liés à la “décolonisation” des savoirs.
- Travail de terrain et inégalités dans un contexte postcolonial
Ce deuxième axe s’intéressera à la conduite à proprement parler des enquêtes de terrains africains. Il s’agira d’interroger les relations construites avec les enquêté.e.s, les négociations d’accès aux terrains, les rapports de pouvoir qui limitent ou a contrario ouvrent des pistes d’investigations, ou encore les questions de traduction. Il sera également possible de présenter des travaux qui analysent la place de chercheur.es / enquêteur.trices, de voir les stratégies de recherches déployées, mais également les effets de leur plus ou moins grande familiarité avec le terrain d’étude, ainsi qu’avec l’objet étudié (Quashie, 2022). Dans cette perspective, il sera proposé des réflexions autour des impacts des rapports de genre, de classe, de race et leurs intersections dans les processus de recherche.
Enfin, cet axe pourra éventuellement rassembler des communications sur les enjeux politiques, administratifs et écologiques de l’accès au terrain. A titre d’exemple, ce sera l’occasion de s’intéresser aux enjeux dans la mobilité des chercheur.es provenant des universités françaises par rapport à l’obtention de visas; l’articulation du statut de chercheur.es-militant.es; les effets psycho-sociaux d’expériences de terrains violents ou difficiles; ou encore les incidences des restrictions à la mobilité aérienne liées à l’empreinte carbone pour les chercheurs et chercheuses, dont les missions ont lieu loin de la France.
- Production, restitution et valorisation des savoirs
Ce troisième axe portera sur la construction des connaissances durant les différentes composantes du processus de recherche. Il s’agira de réfléchir aux ajustements et “détours” méthodologiques nécessaires dans la conduite des recherches et dans la valorisation des données collectées envisagées
L’on pourra ainsi se concentrer sur les modalités d’écriture dites “alternatives” de la recherche, permettant d’examiner à la fois la légitimité des autres formes de circulation des savoirs comme l’oralité et la place de celle-ci dans la restitution. Ce sera le lieu de s’intéresser à des formes telles que la photographie, la poésie, le documentaire, le théâtre-forum, etc. Il y aura là aussi l’occasion d’ouvrir des discussions sur des conditions de l’inter et de la trans-disciplinarité, de l’écriture prospective, des uchronies ou encore des “afrotopies” (Sarr, 2016) ; ainsi que les enjeux liés à la représentation des Afriques et la façon dont les jeunes chercheur.e.s parviennent à naviguer entre ceux-ci de manière critique.
Enfin, nous entendons porter, ici, un regard sur les modalités de valorisation et de restitution des savoirs produits sur les Afriques depuis des universités françaises (Quashie, 2022). Seront les bienvenus des travaux présentant des projets qui mettent en œuvre ou discutent des modes de valorisation et de restitution innovants, pensés tant dans une idée “d’échange” avec les publics enquêtés que dans une dynamique de science ouverte comme la recherche-action ou la recherche-création.
Ces réflexions incluent également la thématique des réseaux au sein desquels circulent ces savoirs produits, allant de la question de l’édition à celle des contours du champ académique. Les réflexions transversales qui guideront nos échanges viendront nourrir les débats actuels sur le positionnement du chercheur.e inscrit dans une approche postcoloniale (Brahimi et Idir, 2020). Elles permettront d’examiner les effets d’une approche intersectionnelle dans l’analyse des phénomènes étudiés, et enfin sur les propositions et dynamiques de démocratisation de la recherche qui suscitent un intérêt grandissant dans ce champ disciplinaire.
—
Les doctoriales se dérouleront sur deux journées, composées de tables rondes et d’ateliers. Cette rencontre se construira autour de temps de mises en dialogues des approches ainsi qu’autour de temps de pratiques et d’expérimentations. Les contributions des participant.e.s prendront comme racines les recherches menées (antérieures, en cours, à venir), ancrant ainsi les échanges dans une réalité empirique. D’autres temps seront organisés afin de penser des méthodes de recherches dites “alternatives”, au croisement des disciplines, et offrant, en ce sens, des perspectives originales de productions des savoirs (par exemple avec des intervenant.e.s extérieur.e.s au monde académique).
Conditions de participation :
La participation à ces doctoriales est ouverte à tou.te.s les doctorant.e.s et chercheur.e.s post‐doctorant.e.s (ayant soutenu leur thèse il y a moins de 5 ans) issu.es d’établissements supérieurs français et travaillant sur les Afriques. Les contributions peuvent s’inscrire dans l’ensemble des disciplines de SHS. Nous encourageons les recherches qui sont en cours de construction, ainsi que les présentations dans différentes langues où s’articulant autour de formats divers (ateliers, posters, production artistique, …).
Vous pouvez soumettre par mail une proposition de 500 mots (précisant l’axe dans lequel s’inscrit la communication) accompagnée d’une brève notice bibliographique avant le 28 février 2025, à l’adresse suivante : gisjeuneschercheurs@gmail.com.
Les candidatures seront évaluées par le comité scientifique des doctoriales qui sélectionnera les propositions et informera les candidat.e.s avant la fin du mois de mars.
Le programme complet de l’évènement sera diffusé au mois d’avril 2025. La prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement par les unités de rattachement des participant.e.s est à privilégier. Toutefois, le comité d’organisation pourra étudier les besoins de prises en charge lorsque cela sera nécessaire.
—
Comité d’organisation :
- Kadiatou BARRY, chargée d’appui au pilotage du GIS Etudes Africaines
– Alexandre GAUDRY, doctorant en aménagement de l’espace et urbanisme, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, laboratoire d’Étude et de Recherche sur l’Économie, les Politiques et les Systèmes Sociaux (LEREPS) et UMR G-Eau (Gestion de l’Eau, acteurs, usages), membre du Bureau Jeunes Chercheur.euses du GIS Etudes Africaines en France
– Noémie GOUX, doctorante en géographie, Université Bordeaux Montaigne, laboratoire PASSAGES, membre associée laboratoire MIGRINTER et LMI MOVIDA (Mobilités, Voyages, Innovations et Dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne),
membre du Bureau Jeunes Chercheur.euses du GIS Etudes Africaines en France
– Rubis LE COQ, postdoctorante en anthropologie de la santé, Université Paris-Dauphine, Institut de Recherches Interdisciplinaires en Sciences humaines et Sociales (IRISSO),
membre du Bureau Jeunes Chercheur.euses du GIS Etudes Africaines en France
– Hugo MAZZERO, doctorant en géographie, Université Bordeaux Montaigne, laboratoire PASSAGES, ATER à l’Université Picardie Jules Verne, membre du Bureau Jeunes
Chercheur.euses du GIS Etudes Africaines en France
– Stevellia MOUSSAVOU NYAMA, docteure en littérature comparée, Aix-Marseille Université, Centre Interdisciplinaire d’Etudes des Littératures d’Aix Marseille (CIELAM),
chargée d’enseignement et professeure de lettres, membre du Bureau Jeunes Chercheur.euses du GIS Etudes Africaines en France
– Anja RAKOTONIRINA, doctorante en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP), membre du Bureau Jeunes Chercheur.euses du GIS Etudes Africaines en France
—
Comité scientifique:
- Sylvie KANDE, History and Philosophy Department, SUNY Old Westbury
– Nadia Yala KISUKIDI, Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie (LLCP, EA 4008), Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
– Stéphanie LIMA, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST, UMR 5193), Université Toulouse 2 Jean Jaurès
– Hervé PENNEC, Institut des Mondes Africains (IMAF, UMR 8171) Aix-en-Provence, CNRS
– Florence RENUCCI, Institut des Mondes Africains (IMAF, UMR 8171) Aix-en-Provence, CNRS
– Maboula SOUMAHORO, Laboratoire Interactions Culturelles et Discursives (ICD, EA6297), Université de Tours François Rabelais
—
Le bureau jeunes chercheur.euse.s du GIS Etudes Africaines en France est une équipe interdisciplinaire créée en 2023, composée de doctorant.e.s et docteur.e.s qui travaillent bénévolement dans l’optique de créer des espaces de rencontres, d’échanges et de visibilité entre les jeunes chercheurs et chercheuses s’intéressant aux Afriques. Le bureau entend, à travers ces actions, accompagner les jeunes chercheur.euse.s dans leur insertion au sein du champ des études africaines en France, et faciliter la circulation des informations. À l’image de la composition du bureau, ces missions sont abordées au prismede l’interdisciplinarité au sein des lettres arts et SHS, dans une perspective de mise en dialogue des approches, des démarches et des postures.
—
Bibliographie indicative
Ansoms, A., & Nyenyezi bisoka, A.et al. (ed.). La série Bukavu: vers une décolonisation de
la recherche. Presses universitaires de Louvain, 2020.
Assogba, Y. A., La raison démasquée sociologie de l’acteur et recherche sociale en Afrique,
Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval, 2007.
Balla, S. “Positionnalité”, Anthropen, 2024.
Ballarin, M.-P., Banégas R., Beauville E., Boilley P., Bourlet M., et al. “Les études africaines
en France : un état des lieux.” [Rapport de recherche] Groupement d’intérêt scientique (GIS)
Études africaines en France, 2016.
Banégas, R., “Etudes africaines : l’exotisme est-il devenu banal ? Décentrement du regard,
comparatisme et doxa disciplinaire”, Les Dossiers du CERI, mai 2015.
Barro A., “Coopération scientifique et débat sur les « sciences sociales africaines » au
CODESRIA”, Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, (9), 2010.
Beaud, G., “Rendre compte des tensions et hégémonies épistémiques qui sous-tendent la
production de savoirs sur l’Afrique”, Revue d’anthropologie des connaissances, 15-1, 2021.
Bonnecase, V., Brachet, J., “Introduction au thème. Afrique et engagement scientifique: sur le mouvement des lignes”, Politique africaine, vol. 161162, no 1, 2021.
Brahimi, M. A. et Idir, M., “Études postcoloniales et sciences sociales : pistes d’analyse pour un croisement théorique et épistémologique”, Revue Interventions économiques, n°64, 2020.
Copans, J., “Pour une histoire et une sociologie des études africaines..”, Cahiers d’études
africaines, vol. 11, n°43, 1971.
Comaroff, J., & Comaroff, JL., “Théorie du Sud : ou comment l’Euro-Amérique évolue vers
l’Afrique.”, Forum anthropologique, 22 (2), 2012.
Chakrabarty, D., Provincialiser l’Europe : La pensée postcoloniale et la différence historique,
(O. Ruchet & N. Vieillescazes, Trad.), Éditions Amsterdam, 2009.
Dufoix, S., Décolonial. Paris, Anamosa, 2023.
Despres, A., « Les figures imposées de la mondialisation culturelle. À propos de la
socialisation des danseurs contemporains en Afrique », Sociétés contemporaines, n° 95/3, 2014.
El Hady Ba, M., “Science et injustice épistémique. Le cas Cheikh Anta Diop”, Tumultes,
58‑59(1‑2), 2022.
Fricker, M., Epistemic injustice : Power and the ethics of knowing, Oxford University Press, 2011.
Kane, O., “Épistémologie de la recherche qualitative en terrains africains : considérations
liminaires”, Recherches qualitatives, 31(1), 2012.
Kisukidi, N.Y., “Décoloniser la philosophie. Ou de la philosophie comme objet anthropologique”, Présence africaine, vol. 192, no 2, 2015.
Lanne, J.B., et Morange M., “Penser les citadinités depuis l’Afrique de l’Est”, EchoGéo, 67, 2024.
Marchesin, P., La politique française de coopération. Je t’aide, moi non plus, L’Harmattan, 2021.
Mudimbe V., The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge,
Bloomington, Indiana University Press, 1988 ; traduit sous le titre : “L’Invention de l’Afrique.
Gnose, philosophie et ordre de la connaissance”, Paris, Présence africaine, 2021
Ndlovu-Gatsheni, S., “Le long tournant décolonial dans les études africaines. Défis de la
réécriture de l’Afrique.” Traduit de l’anglais par G.-D., N., Politique africaine, n°161-162(1), 2021.
Olivier de Sardan, J-P,. “Le « je » méthodologique. Implication et explicitation dans l’enquête
de terrain”, Revue française de sociologie, 417-445, 2000.
Quashie, H. “What does restitution mean in Francophone postcolony? Reflections from
Senegal”, Jahazi Journal. Culture, arts, performance, vol. 10, no 1, 2022.
Quiroz, L. “Le leurre de l’objectivité scientifique. Lieu d’énonciation et colonialité du savoir”, La production du savoir: formes, légitimations, enjeux et rapport au monde, 2019.
Santos, B. de S, Épistémologies du Sud : Mouvements citoyens et polémique sur la science, Desclée de Brouwer, 2016.
Sarr, F., Afrotopia, Paris, Philippe Rey, 2016.
- Responsable :
le Bureau des Jeunes Chercheur.euse.s du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur les “Études africaines en France” (UAR 2999 “Études aréales”) - Url de référence :
https://etudes-africaines.cnrs.fr/ - Adresse :
Aubervilliers, Campus Condorcet
2.25 Les grandes figures féminines dans les littératures et les bandes dessinées africaines (Douala, Cameroun)
Les grandes figures féminines dans les littératures et les bandes dessinées africaines (Douala, Cameroun)
- Date de tombée (deadline) : 03 Mars 2025
« Les grandes figures féminines dans les littératures et les bandes dessinées africaines»
Symposium
Les 8-9 avril 2025
Alors même que la question des femmes dans les littératures africaines, orales et écrites, a fait l’objet d’une attention critique abondante, force est de constater que la représentation des figures féminines se limite très souvent aux rôles classiques de mères, d’épouses et de filles. Confinées à la condition de victimes d’un patriarcat aliénant, ou au contraire, louées pour leurs vertus dans l’éducation des enfants et la stabilité de la cellule familiale, elles sont rarement portraiturées en tant que résistantes ou leaders. Jusqu’à tout récemment, l’espace littéraire africain, et spécifiquement celui circonscrit au sud du Sahara, a révélé que la prise de parole des figures féminines est essentiellement le fait de la vague des écrivaines des années 1970-1980 qui modifient la perception idyllique et mythique de la femme. Ces autrices décrivent des femmes confrontées à des situations traumatisantes, tant dans la société que dans leurs foyers. Leur démarche vise à déconstruire les représentations véhiculées par le discours social et la littérature à leur sujet. Par la suite, les années 1980 et 1990 ont marqué l’émergence d’une nouvelle génération de femmes dans ces littératures. Des amazones des temps modernes qui s’engagent dans les luttes pour les libertés individuelles ; en affirmant leur identité singulière1. Force est donc de constater que les figures féminines restent sous-étudiées ou limitées à des archétypes ; leur représentation apparaissant toujours sous des formes brumeuses chez Beyala2, ou inédites chez Eugène Ebodé3, pour ne citer que ces deux auteurs.
Par ailleurs, du point de vue de l’historiographie africaine, les figures féminines sont très souvent absentes, marginales ou encore sous-représentées. Il y a une sorte de « silencement » du passé4 et de l’histoire des femmes africaines. La tendance au demeurant majoritaire, est encore de restituer les femmes à l’histoire, d’écrire ce que Gerda Lerner5 a appelé l’histoire « compensatoire » et « de contribution ». Or, il ne s’agit pas seulement d’ajouter des femmes à l’histoire, mais d’adopter une pratique blasphématoire de contestation du système de représentation ; voire de repenser les récits historiques en reconnaissant leur contribution essentielle, et en incluant des perspectives de genre.
La lecture qui précède s’applique autant à la production romanesque qu’à la bande dessinée. A titre de rappel, le neuvième art est en pleine ébullition dans l’ensemble du continent africain. Mais pour de nombreux bédéistes, les limites de cette effervescence se résument à un seul mot : l’extraversion. C’est du moins l’avis de deux figures importantes de cet art au Cameroun, à savoir Joëlle Epée Mandengue et Nathanaël Ejob6. La première, autrice de La Vie rêvée d’Ebène Duta, pose ce diagnostic sans fards : « Certains sont de brillants dessinateurs mais qui ont copié Bleach en changeant juste la coupe de cheveux d’Ichigo, en lui mettant des nattes ! […] Il faut que les auteurs créent véritablement ». Le second, scénariste et dessinateur au sein du collectif Zebra Comics, affirme quant à lui : « J’ai grandi avec Batman et Superman alors, inconsciemment, mes histoires ressemblaient à ce monde-là, qui n’est pourtant pas le mien […] Ça a été comme un sursaut, l’envie de raconter mes propres histoires. » L’enracinement consiste aussi en la sauvegarde des langues locales en péril. Il est important de souligner que la veine novatrice prônée par ces bédéistes, adossée à une entreprise de revalorisation du patrimoine culturel africain, ne peut ignorer le fait que le neuvième art a longtemps consacré l’invisibilité des figures féminines. L’Afrique entend aujourd’hui corriger cette lacune mondiale. Dans l’ensemble du continent, la tendance est à la prolifération des héroïnes, mais surtout des parcours atypiques incarnés par des personnages féminins, notamment ceux de judokates, reines, guerrières ou archéologues. C’est une tendance à questionner au plan de la représentation des grandes figures féminines de l’histoire. Ces créateurs de personnages féminins hors du commun, tiennent-ils compte des lacunes à combler en matière de représentation des héroïnes, connues ou inconnues, qui ont marqué le continent africain ? On peut aussi, dans une perspective comparatiste entre la BD et le roman, décrypter la perspective « afrofuturiste », telle que la définit Nathanaël Ejob : « C’est ça le pouvoir de l’afro-futurisme, montrer qu’en Afrique aussi on peut créer un monde incroyable, il faut juste croire qu’on en est capable !7». Nathanaël Ejob parle ici de l’importance de convoquer les genres littéraires qu’on range dans la catégorie du surnaturel, c’est-à-dire le fantastique et la science-fiction. A ce propos, les mythes et la spiritualité africaine seraient pourvoyeuses d’histoires « incroyables ». Il s’agirait par conséquent, d’interroger le présent et de le réinventer à l’aune du passé. Dans une telle perspective, la question suivante mériterait également d’être posée : quels sont les enjeux historiographiques et sociologiques de la création des figures féminines dans les récits8 ?
Le symposium objet du présent appel à communication, qui se tiendra à Douala dans le cadre de la deuxième édition des « Journées de la bande dessinée », est ouvert à une diversité de spécialistes : universitaires, chercheurs, bédéistes, éditeurs… etc. Il s’agira d’étudier les grandes figures féminines dans les littératures africaines ; avec un accent porté en particulier sur la représentation des femmes chez les bédéistes africains. Les axes de communication, non exhaustifs, sont les suivants :
1- Diversité des grandes figures féminines africaines. On pourra interroger les typologies (élites, subalternes) et rôles joués dans l’historiographie africaine.
2- Stéréotypes et limites des représentations. Il s’agit de voir si les récits traditionnels et modernes reproduisent les clichés sur la « femme africaine » ; et dans quelle mesure l’absence de ces dernières dans les récits donne une vision biaisée des sociétés africaines, et participe non seulement à leur invisibilité mais aussi et surtout à leur inhabitabilité.
3- Grandes figures féminines dans des contextes contemporains. Ici, on peut par exemple questionner le rôle des femmes dans les contextes de migrations, génocides, guerres civiles et conflits post-Apartheid. Tout comme lors des luttes pour l’autodétermination des pays africains, ces situations de vie sont marquées par l’action de nombreuses héroïnes inconnues qu’il serait opportun de sortir de l’oubli et de mettre en lumière.
4- Re-lecture féministe et intersectionnelle des textes africains. Cet axe peut amener à voir comment les grandes héroïnes du continent sont réinterprétées et réinvestissent les imaginaires africains, voire comment elles ont évolué à l’intersection des oppressions degenre (idéologies patriarcales coloniales et idéologies patriarcales autochtones), de race et/ou de classe.
5- Décolonisation et réhabilitation des grandes figures féminines. En privilégiant les perspectives décoloniales, notamment celles du féminisme décolonial, il est question d’analyser les nouvelles représentations des figures féminines oubliées (résistantes, mères des nations…) durant les luttes coloniales et les indépendances.
—
Modalités de soumission
Les propositions de communication de 300 mots devront être envoyées à l’adresse suivante :
Elles doivent comporter les parties ci-après : le titre, le nom de l’auteur, la structure ou Etablissement d’attache, ainsi qu’une adresse électronique.
—
Calendrier
17 janvier 2025 : lancement de l’appel.
28 février 2025 : date limite de réception des propositions de communication.
5 mars 2025 : réponse aux auteurs.
—
- Joseph, Ndinda, « Femmes africaines en littérature, aperçu panoramique et diachronique » dans Femmes et création littéraire en Afrique et aux Antilles, Palabre Vol. III, n°1&2, avril 2000.
- Calixthe Beyala, Assèze l’Africaine, Paris, Albin Michel, 2014.
- Eugène, Ebodé, Souveraine magnifique, Paris, Gallimard, 2014.
- Michel-Rolph, Trouillot, Silencing the Past : Power and the Production of History, London, Beacon Press, 2015.
5 Gerda Lerner (30 avril 1920 – 2 janvier 2013), est une historienne américaine d’origine autrichienne, qui figure parmi les fondatrices du domaine de l’histoire des femmes aux États-Unis. Elle a été l’une des premières à apporter une perspective historique féministe. Ses publications les plus emblématiques dans le domaine sont les suivantes : 1. Black Women in White America : A Documentary History (1973), publié en français sous le titre De l’esclavage à la ségrégation – les femmes noires dans l’Amérique des Blancs (1975) ; 2. The Majority Finds Its Past : Placing Women in History (1979) ; 3. The Creation of Patriarchy (1986) ; 4. The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-Seventy (1993).
6 Klervi Le Cozic, « la bande dessinée contemporaine en Afrique », https://www.citebd.org/neuvieme-art/la-bande-dessinee- contemporaine-en-afrique, Juin 2021.
7 Klervi Le Cozic, op. cit.
8 Balana Yvette, « Entre grandeurs et misères. Fictions, récits, mythes et réalités sur la femme camerounaise », in Amabiamina Flora (dir.), Peintures de femmes dans la littérature postcoloniale camerounaise, Abà, Revue internationale de lettres et de sciences sociales 4/2016, Paris, Dianoïa.
- Responsable :
Yvette Balana, Jean-Arnauld Libong - Adresse :
Université de Douala
2.26 Migration, Place/making and Belonging (University College Cork)
Migration, Place/making and Belonging
A conference of the ISS21 Migration and Integration Research Cluster
5-6 June 2025 @ University College Cork
CALL FOR ABSTRACTS
Migration is an integral part of contemporary global societies and of how we, in our societies and communities, relate to the places in which we live, how we develop a sense of belonging and how place itself is constructed. Reflecting a politics of place and belonging/not-belonging, different forms of migrations and movements across borders can be prioritised, preferred, stigmatized, demonized or even ignored in public and academic discourse. Place can become a focus of anti-immigration sentiment whereby contested notions of belonging are utilized to other and exclude. But through placemaking processes, place can also be an integral part of building community, conviviality, connection and belonging in contexts of migration and mobility.
We, as a group of researchers in different disciplines within social sciences and humanities in UCC, aim to address this complex picture by inviting scholars to discuss the intersections of migration, place/making and belonging (in Ireland and beyond). As such, we invite papers from researchers, practitioners, activists and policy makers that address the following themes (not exclusively), to advance theoretical and empirical understandings of these intersections:
- Migration, the city and urban space
- Politics of inclusion/exclusion, place/making and belonging
- Intersectionality (gender, class, race, etc.) and place/making in migration
- Place un-making and unbelonging
- Schools as spaces of belonging/not-belonging and placemaking
- Advancing methods for researching migration, place(making) and (un)belonging
- Migration, home and materiality
- Migration, rural im/mobilities and place/making
- Superdiversity, conviviality and place
- Digital spaces, migration and belonging
- Climate change, mobilities and place
Confirmed keynote speakers:
Professor Parvati Nair, Queen Mary University of London
Professor Susanne Wessendorf, Coventry University
We welcome perspectives from social sciences, cultural studies, law and related disciplines as well as from practice and activism. Abstracts from postgraduate students are particularly welcome. This will be an in-person event.
The ISS21 Migration and Integration Cluster brings together researchers with an interest in issues of migration, integration and cultural diversity, from a wide range of disciplines including Applied Psychology, Applied Social Studies, Education, Geography, Languages/Literatures/Cultures, Law, Philosophy, Sociology and Study of Religions. The Cluster and ISS21 represents UCC as a full member of IMISCOE (International Migration Research Network).
Conference Planning Committee: Mark Chu, Mastoureh Fathi, Shirley Martin, Meiyun Meng, Caitriona Ni Laoire
Submission Guidelines:
Abstracts should be 250 words maximum and include the title of the paper, the name(s) of the author(s), affiliation(s), and contact details and a short biography (max. 50 words).
Link for abstract submission: https://forms.office.com/e/qck7hFkyd1
Important Dates:
Abstract Submission Deadline: Friday 14th February 2025
Notification of Acceptance: Friday 28th February 2025
Conference Website: https://www.ucc.ie/en/iss21/researchprojects/events/migrationconference/
2. Job and Scholarship Opportunities
2.1 The Simon Gaunt Postgraduate Travel Grant 2025
The Simon Gaunt Postgraduate Travel Grant 2025
Applications for this year’s Simon Gaunt Postgraduate Travel Grant are now open, and should be addressed to Professor Diana Holmes (d.holmes@leeds.ac.uk) by the closing date of 4th April 2025.
The grant is named after Professor Simon Gaunt, a world-leading scholar who transformed the theoretical landscape of medieval studies, as well as a dear colleague and ex-President of the Society. Simon died far too early in 2021, and this grant commemorates his commitment, supportiveness and capacity to inspire as supervisor and mentor for postgraduate students.
The grant (for a maximum of £1000) is designed to cover travel costs, conference fees if applicable, and to provide a stipend based on the estimate of expenses presented in the application. Projects will typically last for between five and ten days, although this could be extended if a strong case is made. The aim is to enable postgraduate students to travel abroad for a potentially career-transforming international event or activity (e.g. attendance at a major conference, access to a major collection).
The grant is a competitive award, and applications will be judged by a jury composed of the President and Vice-President of the Society and the executive officer in charge of research awards. There will usually be one grant awarded per year, but exceptionally, where funding allows, this may be extended to two.
For more information about eligibility criteria and how to apply, see the SFS website.
2.2 SFS Visiting International Fellowship scheme
SFS Visiting International Fellowship scheme
The Society for French Studies is pleased to accept applications for the annual Visiting International Fellowship scheme. The scheme is intended to support a visiting fellowship, tenable in any UK or Irish university, or institution of higher education in the UK or Ireland, to allow outstanding academics in the French Studies field based in overseas universities to spend time at UK or Irish higher education institutions during the academic year 2025-26.
The key objective of the Fellowship grant is to promote the internationalization of French Studies in the UK and Ireland through collaborative work; the Fellow will be encouraged to use the occasion to further their own academic interests, and to visit more than one UK institution. The Society strongly encourages applications to support visits from scholars in all parts of the world, including Africa, Australasia and the Caribbean.
The Society will offer a grant of up to £5,000 to support travel, accommodation, subsistence and other expenses; up to an additional £500 is also available to cover the costs of visiting other institutions in the UK or Ireland. Personal expenditure on items such as visa costs, car hire and health insurance are not eligible, and it is expected that host institutions will offer support for these.
Full details of the selection criteria, eligible costs, conditions of the award and how to apply are on the Society’s website: https://www.sfs.ac.uk/funding/visiting-fellowships.
Applications should be sent to Professor Steven Wilson (steven.wilson@qub.ac.uk) by 31 March 2025.
2.3 ASMCF Peter Morris Memorial Postgraduate Travel Prize 2025
The Association for the Study of Modern and Contemporary France is inviting applications to the Peter Morris Memorial Postgraduate Travel Prize. In memory of the late Peter Morris, the award of £500 will be made to a postgraduate student to contribute towards travel costs incurred on a short trip to France.
The terms and conditions of the prize are as follows:
Applications should be submitted in advance of the trip, which may take place at any time during the twelve months following the deadline for applications.
A subcommittee convened to adjudicate the prize will look for evidence that the trip has been well planned and that the student has attempted to maximize the benefits to be drawn from the time in France. Each student shall be required to provide a letter of support from his or her supervisor. Bids to other funding bodies either pending or known should be disclosed.
The deadline for applications is 15th February 2025. For more details about awards/prizes, please visit the ASMCF website: https://asmcf.org/funding-prizes/
2.4 French, Assistant (Tenure-Track) Professor, Bellevue College
French, Assistant (Tenure-Track) Professor
Job ID: 14612
Location: Bellevue College
Full/Part Time: Full Time
Regular/Temporary: Regular
Position Summary
The Arts & Humanities division is seeking qualified candidates for a full-time tenure track faculty member for Fall 2025 in the World Languages department. The World Languages faculty will perform duties and functions under the general direction of the Provost and shall be responsible primarily to the Dean of Arts & Humanities.
The successful candidate must reside in Washington State by the start of the position and demonstrate a strong commitment to teaching in person. This includes teaching on the Bellevue College campus and participating in non-teaching duties such as committee service, advising, and professional development activities. While there may be opportunities to teach online or hybrid courses, faculty are expected to maintain a significant presence on campus to support students, collaborate with colleagues, and contribute to the college community.
Furthermore, we seek candidates who embrace culturally responsive pedagogy, value diverse perspectives, and demonstrate an ability to create welcoming learning spaces that foster student success. Candidates with experience advancing equity, inclusion, and social justice in their teaching, scholarship, or service are strongly encouraged to apply.
Pay, Benefits & Work Schedule
Position Salary Range: $81,757.08/year – $114,664.94/year
Annual salary is based on a 176-day contract with a minimum of $81,757.08; beginning salary will be determined by the assessment of the candidate’s education and related experience. New hires start no higher than $87,663.74 unless exceptional circumstances prevail. Certain positions may also be eligible for assignment/project-based additional compensation, including a High Demand Stipend up to $8,350 annually, prorated based on the discipline and duration of the assignment. All additional compensations are subject to change depending on funding and negotiated agreement.
We offer comprehensive compensation package with salary and benefits as the main components. Generous benefits package is offered through Washington State plans that includes multiple medical, dental, life and disability coverage choices for employees and dependents; choices of retirement and deferred compensation plans; paid personal leave plan; transit program, reduced tuition, employee discounts and memberships, etc.
In addition to teaching, full-time faculty maintains office hours and participate in department and college activities. This position is represented by the Bellevue College Association of Higher Education (BCAHE) union.
About The College
Bellevue College is a diverse student-centered, comprehensive and innovative college, committed to teaching excellence that advances the life-long educational development of its students while strengthening the economic, social and cultural life of its diverse community. Bellevue College is located just 10 miles east of Seattle where we serve a student population of over 54% students of color and over 1,300 international students. The college promotes student success by providing high-quality, flexible, accessible educational programs and services; advancing pluralism, inclusion and global awareness; and acting as a catalyst and collaborator for a vibrant region.
We strive to create a vibrant and inclusive campus community that supports a diverse student body, faculty and staff. As an essential part of our mission and goals, diversity, equity and pluralism are promoted and fostered in all aspects of college life. By enriching student life through leadership opportunities, personal learning and cultural experiences, we are committed to building an inclusive and diverse campus community that fosters creativity, innovation and student success.
For more information, visit BC Facts at a Glance @ Bellevue College.
About the Department
The World Languages Department at Bellevue College offers courses in Arabic, ASL, Chinese, French, German, Italian, Japanese, and Spanish. The faculty represents an extensive range of interests and is committed to excellence. The Department recognizes the need for World Languages proficiency in today’s changing world.
We are dedicated professionals who provide instruction and guidance to our students, and we are an integral part of the humanities. Every effort is made to teach students to think clearly and critically, to make logical and ethical judgments and to communicate effectively with others, thus overcoming cultural and language barriers. It is a pleasure to share with you our passion for other languages and cultures.
Essential Functions
Teaching duties include:
- Teach 15 credits (3 courses) of French and one additional language per quarter at the first- and second-year levels on a variety schedules and modalities, primarily on ground.
- Prepare and implement lessons to achieve assigned courses’ learning outcomes.
- Evaluate prospective students’ language proficiency and place them in appropriate course levels.
- Ongoing curriculum development, assessment, revision, and implementation through inter- and intra-departmental cooperation and collaboration.
Non-teaching duties include:
- Participate in department, division, and college governance (such as serving on committees, advising student clubs, and supporting initiatives).
- Maintain knowledge and skills current in discipline and area of assignment.
- Participate in the life and culture of the department, division, and college, including the college-wide effort to dismantle barriers that can impact underrepresented and historically marginalized student populations.
Minimum Qualifications
- Master’s degree from an accredited institution in French or a closely-related field such as applied linguistics or French/Francophone literature.
- Ability to use French at native or near native level.
- Ability to use one additional language taught in the World Languages program at native or near native level.
- Coursework or other training in language teaching methodology.
- Teaching experience in French as a foreign language at the community college and/or university level.
- Willingness and ability to teach in various modalities (face to face, hybrid, online).
- Demonstrated ability to work in a team environment.
- Demonstrated ability to work in an inclusive manner with a diverse faculty, staff, and student population.
- Ability and willingness to teach on campus.
Preferred Qualifications
- College teaching experience in an additional language taught in the World Languages Program.
- Experience teaching in various modalities (face to face, hybrid, online).
- Familiarity with recent pedagogical developments in language teaching.
- Experience using a variety of teaching and assessment techniques that engage students and emphasize interaction/
- Experience in addressing disproportionate impact and equity issues in the higher education environment.
- Experience with Canvas or another learning management system.
- Experience in assessing student proficiency for placement.
- Evidence of effective intercultural communication skills, collegiality, and working collaboratively with colleagues in an intercultural department.
Conditions of Employment
Bellevue College intends to provide a drug-free, healthy, safe, and secure work and educational environment. Each employee is expected to report to work in an appropriate mental and physical condition to perform her/his/their assigned duties.
Bellevue College employs only U.S. citizens and lawfully authorized non-U.S. citizens. All new employees must show employment eligibility verification as required by the U.S. Citizenship and Immigration Services.
Sexual Misconduct and Background Check:
Prior to start of employment, finalists(s) for this position will be subject to a pre-employment background check as a condition of employment. Information from the background check will not necessarily preclude employment, but will be considered in determining the applicant’s suitability and competence to perform in the position.
Applicants considered for this position will be required to disclose if they are the subject of any substantiated findings or current investigations related to sexual misconduct at their current employment and past employment. Disclosure is required under Washington State Law.
Check frequently in your inbox, spam, junk, clutter email folders for any communication regarding the next steps from Bellevue College and our background check partners.
Reference Check:
Reference checks may include, but are not limited to, contacting references and verification of work experience, and/or past job duties.
Other Information
- This position is eligible for relocation allowance.
- Sponsorship for employment-based visa may be an option for full-time tenure-track faculty position only and depending upon applicants qualification.
How To Apply
Applications received by 2/24/2025 will be given full consideration. Applications received after that date may be considered until the position is filled. This position will begin Fall Quarter, 2025.
All individuals interested in this position are encouraged to apply. Your application must include a complete online application and all of the required documents below to be considered complete. Any application that does not provide all requested information will not be considered for the position (only submit required documents with the application, additional documents will not be reviewed.) Please review Application Tips before applying. Current Bellevue College employees should apply the position through Employee Self Service.
Required application materials:
- Attach a Cover Letter (min 1 pg., max 2 pgs.)
- Attach a Resume/Curriculum Vitae
- Attach a statement of your Teaching Philosophy (max 2 pages)
- Attach a Diversity Statement (min 1 pg., max 2 pgs.) that addresses the following: Please provide specific examples of how your educational and/or professional experiences, background or philosophy demonstrate your commitment to diversity and equity, and how these prepare you to contribute to Bellevue College. Please note that your Diversity Statement must be a separate response from your Teaching Philosophy
- Attach a copy of academic transcripts (unofficial transcripts may be submitted – official transcripts required upon employment)
- Complete Job Questionnaires if applicable
Contact:
If you have questions with regards to the application or the hiring process, please contact Office of Human Resources at 425-564-2274 or email to jobs@bellevuecollege.edu.
EEO Statement
Bellevue College does not discriminate on the basis of race, color, national origin, language, ethnicity, religion, veteran status, sex, sexual orientation, including gender identity or expression, disability, or age in its programs and activities. Please see policy 4150 at www.bellevuecollege.edu/policies/. The following people have been designated to handle inquiries regarding non-discrimination policies: Title IX Coordinator, 425-564-2641, Office C227, and EEOC/504 Compliance Officer, 425-564-2178, Office B126.
Applicants with disabilities who require assistance with the recruitment process may contact hraccommodations@bellevuecollege.edu .
2.5 Inst/Ast Prof – Fixed Term, Michigan State University
Inst/Ast Prof – Fixed Term
Working/Functional Title
Romance Languages – Instructor or Ast Professor
Position Summary
The Department of Romance and Classical Studies seeks applications for a pool of qualified fixed-term Instructors/Assistant Professors to teach courses in Classics, French, Italian, Portuguese, and Spanish. Rank is determined by highest degree with an MA degree required for an instructor position and a PhD required for an assistant professor position. All degrees must be confirmed by degree-granting institutions at the time of hire. The position can be part-time or full-time and vary by semester, depending on the needs of the department. It is possible that no positions are needed in some semesters. Position is renewable and contingent upon funding and performance.
Position Summary:
Responsibilities include:
Teaching lower and/or upper division courses, based on qualifications, in one of the languages listed above
Holding office hours
Preparing course materials
Grading assignments
Following course policies and guidelines
Attending all workshops and meetings required for the class
Preparing syllabi
Attending departmental meetings, when applicable
Appointments are initially for one year or one semester, depending on scheduling needs, but may be renewed based on funding and performance.
Salary and rank are commensurate with experience. These are non-tenure track positions.
Equal Employment Opportunity Statement
All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, citizenship, age, disability or protected veteran status.
Required Degree
Doctorate
Minimum Requirements
- M.A. or equivalent in Classics, Italian, Portuguese, French, Spanish, or related field for Instructor rank
- PhD or equivalent in Classics, Italian, Portuguese, French, Spanish, or related field required for an assistant professor rank
- Native or near native proficiency in that language and English
- Desired Qualifications
- Ph.D. or equivalent in Classics, Italian, Portuguese, French, Spanish, or related field.
Required Application Materials
a) a cover letter
b) current curriculum vitae
c) any other materials desired by the search committee
d) a summary of the candidate’s experience with diversity in the classroom and/or in past or planned research endeavors, experience mentoring diverse students or community outreach initiatives, and an explanation of how the candidate will advance our goals of inclusive excellence
e) the names and email addresses of 3 potential referees.
Special Instructions
Review of applications will begin ASAP and will be on-going through 2026 based on needs of the department. Applicants must be submitted electronically to the Michigan State University Human Resources website http://careers.msu.edu Posting Number 1002173. For more information, contact Chair of the Search Committee, Anne Violin-Wignet at violinwi@msu.edu.
Persons with disabilities have the right to request and receive reasonable accommodation.
Review of Applications Begins On
12/01/2024
Department Statement
The College of Arts & Letters recognizes that only an academic and organizational culture, which actively seeks out and strengthens diverse voices and perspectives among its members results in true excellence. We are an equal opportunity / affirmative action employer. The College of Arts & Letters is particularly interested in candidates of all backgrounds who are committed to the principle that intellectual leadership is achieved through open access and pro-active inclusion.
MSU Statement
Michigan State University has been advancing the common good with uncommon will for more than 160 years. One of the top research universities in the world, MSU pushes the boundaries of discovery and forges enduring partnerships to solve the most pressing global challenges while providing life-changing opportunities to a diverse and inclusive academic community through more than 200 programs of study in 17 degree-granting colleges.
To apply, visit https://careers.msu.edu/jobs/inst-ast-prof-fixed-term-east-lansing-michigan-united-states-6856be0f-b335-4f00-b979-f367e6fc2a25
Source:
https://joblist.mla.org/job-details/9705/inst-ast-prof-fixed-term/?porder=French&ix=5#top-pagination’
2.6 Visiting Assistant Professor of French, College of Charleston
The Department of French, Francophone, and Italian Studies at the College of Charleston invites applications for a three-year Visiting Assistant Professor position in French beginning August 16, 2025. We are seeking a dynamic and dedicated teacher-scholar with demonstrated excellence in teaching French as a foreign language and a strong commitment to equitable and inclusive teaching.
Qualifications:
A Ph.D. in French is required at time of appointment. A.B.D. candidates in French, with an expected completion by August 15, 2025, will be considered. Near native proficiency in French and English is required along with teaching experience in lower-level French language classes. The teaching load will be four courses per semester. The position is benefits-eligible, and the salary is competitive.
Application Details:
To aaply, please submit the following via Interfolio: (1) a letter of interest detailing experience and preparation; (2) current CV; (3) three letters of recommendation; (4) teaching philosophy; (5) a teaching portfolio, which may include sample syllabi and teaching evaluations; and (6) unofficial transcripts. The teaching philosophy must address the candidate’s experience, ability to design and assess courses, and research goals. Apply here: http://apply.interfolio.com/160335
The College of Charleston is a public liberal arts college in the State of South Carolina, located in the downtown area of Charleston. Founded in 1770, the College has a rich history, with an enrollment of approximately 10,000 undergraduate students. The College of Charleston celebrates diversity and welcomes applications from members of any group that has been historically underrepresented in the American academy.
Questions concerning this position should be addressed to the Chair of the Department, Dr. Lisa Signori (signoril@cofc.edu). Review of applications will begin January 6, 2025 and will continue until the position is filled. Incomplete applications will not be considered. Initial interviews will be conducted via Zoom.
To learn more about the College of Charleston, visit our web-page at https://charleston.edu; for French, Italian, and Francophone Studies, visit https://charleston.edu/french-italian-studies/index.php.
2.7 Chair – Department of Modern and Classical Languages, George Mason University
About the Department:
The Department offers undergraduate and graduate programs in a variety of languages: Arabic, Chinese, Classical Studies, French, German, Italian, Japanese, Korean, Latin, Russian, and Spanish. From our basic language offerings to our undergraduate and graduate courses in linguistics, literature, and cultural studies, our integrated curriculum fuses students’ acquisition of linguistic proficiency with their development of cultural knowledge and critical thinking. We offer five undergraduate major concentrations (Arabic; Chinese; French; Korean; and Spanish), eleven minors, a graduate-level certificate in Spanish Heritage Language Education, and one Master’s program with five concentrations (Chinese; Spanish; French; Spanish & French; and Spanish/Bilingual-Multicultural Education).
About the Position:
The Chair provides leadership to the department to facilitate the achievement of college and university strategic objectives. The Chair will serve a four-year term beginning August 25, 2025. The position is potentially renewable. The standard duties of a department chair are outlined in the Faculty Handbook, section 2.12: https://provost.gmu.edu/administration/policy. The Chair is responsible for overseeing all departmental operations and plays a key role in collaborating to promote the study of languages and cultures, particularly in promoting intercultural competence across disciplines at the university. The Chair reports to the Dean of the College of Humanities and Social Sciences.
2.8 Stipendiary Lecturership in French, University of Oxford, Christ Church
Stipendiary Lecturership in French
University of Oxford – Christ Church
| Location: | Oxford | |
| Salary: | £16,569 to £18,308 (current rates) per annum, according to qualifications and experience. | |
| Hours: | Part Time | |
| Contract Type: | Permanent | |
| Placed On: | 17th January 2025 | |
| Closes: | 17th February 2025 | |
Christ Church invites applications for a permanent Stipendiary Lecturership in French. This is a permanent position to fulfil a standing college teaching need commencing 1 October 2025.
The Lecturer will deliver six (weighted) hours of teaching per week, averaged over the three eight-week terms of each academic year. The College uses a system of weighted hours depending on how many students are being taught. The teaching delivered by this postholder will consist of small-group language teaching, usually in groups of 6-8, which means that the actual number of contact hours per week will be less than six. The appointed tutor will be expected to set and mark written work for the language classes.
The successful candidate should be able to teach:
- Prelims: seen and unseen translation into English (fortnightly)
- Prelims: comprehension and summary in French (fortnightly)
- Prelims: general language skills (weekly)
- Second year: translation into English (fortnightly)*
- Finalists: translation into English (fortnightly)*
The classes marked * may be varied depending on the native language of the successful applicant.
The salary will be £16,569 – £18,308 (current rates) per annum, according to qualifications and experience.
The successful candidate will have evidence of the skills required for successful general language teaching at a high level, including the ability to explain grammar lucidly, listen to students, and enthuse and inspire them. The ability to understand, and explain to students, passages written in sophisticated French is essential.
Further particulars, including instructions about how to apply, may be downloaded via the ‘Apply‘ button above. The deadline for applications is 12:00 noon on 17 February 2025.
Christ Church is committed to equality of opportunity. It is our policy and practice that entry into employment and progression within employment will be determined only by criteria which are related to the duties of a particular post and the relevant salary scale. No applicant or member of staff will be treated less favourably than another because of their age, disability, ethnicity, marital or civil partnership status, parental status, religion or belief, sex, or sexual orientation.
Source: https://www.jobs.ac.uk/job/DLM398/stipendiary-lecturership-in-french
2.9 Kathleen Bourne Junior Research Fellowship in French Studies, University of Oxford, St Anne’s College
Kathleen Bourne Junior Research Fellowship in French Studies
University of Oxford – St Anne’s College
| Location: | Oxford | |
| Salary: | £36,105 per annum | |
| Hours: | Full Time | |
| Contract Type: | Fixed-Term/Contract | |
| Placed On: | 20th January 2025 | |
| Closes: | 14th February 2025 | |
Fixed term for 2 years from 29 September 2025
The Governing Body of St Anne’s College invites applications for the Kathleen Bourne Junior Research Fellowship in French Studies, tenable from 29 September 2025 for a fixed term of two years. The Fellowship is offered for research in French and Francophone Studies.
The JRF is open to those at an early stage of their academic career. You will hold a PhD/DPhil or be near to completion, with a high level of research ability and strong record of education.
Applications will be judged on the basis of the candidate’s potential to undertake a significant and exciting programme of research in an area of French Studies, as evidenced by their research proposal, publication record and academic references.
The successful candidate will be expected to:
- engage in research and its dissemination;
- propose, plan and manage a high-quality programme of original research;
- publicise the outcomes of that research through presentation of papers and publications;
- undertake up to three hours of teaching per week during term time for the College, where appropriate;
- engage in the life and activities of the College.
One of the largest Colleges in the University of Oxford, with around 860 students, St Anne’s is down to earth, ambitious, outward facing and collaborative. We aspire to understand the world and change it for the better.
French at St Anne’s currently comprises one Tutorial Fellow in French and Comparative Literature and two Stipendiary Lecturers. These academics are responsible for teaching and advising our French students at all levels. The College currently admits around six undergraduates in French per year, creating cohorts of 24 at any one time. The study of French at Oxford is part of the wider Faculty of Modern Languages, which also includes Spanish, German, Italian and Portuguese.
Please click the ‘Apply’ button , for the full further particulars and details on how to apply. The deadline for receipt of applications is noon on Friday 14 February 2025.
St Anne’s is an equal opportunities employer. Please see our website to complete an Equal Opportunities monitoring form.
Source: https://www.jobs.ac.uk/job/DLN108/kathleen-bourne-junior-research-fellowship-in-french-studies
3. Announcements
3.1 Modern French History Seminar at the IHR
We’re delighted to share the programme for this term’s Modern French History Seminar at the IHR, which begins on 20 January:
20 January 2025 / 5:30-6:30pm (BST) – Julie Kalman (Monash University), ‘The Asterix Series as National Myth in Postwar France.’ Room 243, Second Floor Senate House , hybrid.
3 February 2025 / 5:30-7pm (BST) – Tamara Chaplin (University of Illinois Urbana-Champagne), ‘Becoming Lesbian. A Queer History of Modern France.’ Book discussion in collaboration with the History of Sexuality seminar. Wolfson Room, Senate House, hybrid.
17 February 2025 / 5:30-7pm (GMT) – Sarah Arens (University of Liverpool), Mirjam Brusius (German Historical Institute London), Itay Lotem (University of Westminster) ‘Dark Pasts.’ Book launch in collaboration with the Re-thinking Modern Europe seminar. Wolfson Room, Senate House, hybrid.
3 March 2025 / 5:30-7pm (GMT) – Sarah Dunstan (Glasgow), Martin Evans (University of Sussex), Annette Joseph-Gabriel (Duke University), Julian Jackson (QMUL), Roxanne Panchasi, (Simon Fraser University), ‘Roundtable: The Future of French Global History,’ Wolfson Room, Senate House, hybrid.
17 March 2024 / 5:30-6:30pm (GMT) – Tristan Rouquet (Institut des Sciences Sociales du Politiques, Université Paris Nanterre) ‘Intellectual Collaborators in Post-War France. Stigma, survival and posterity.’ Online. Please note that this seminar will be delivered in French.
Full details of speakers and sessions are available at https://www.history.ac.uk/seminars/modern-french-history
Sessions will take place in person at Senate House, Malet St, London WC1E 7HU) and/or on Zoom (booking required to get link). In-person sessions will be hybrid. All sessions begin at 5.30 pm, London time.
3.2 NYC Area French History Group
The NYC Area French History Group is delighted to announce our spring 2025 schedule.
Feb. 25
Presenter: Daniel Steinmetz-Jenkins, Wesleyan University
Title: A Reconsideration of Raymond Aron’s Defense of Algerian Independence
Discussant: Michael Christofferson, Adelphi University
March 20:
Presenter: Carolyn Biltoft, Graduate Institute Geneva
Title: The Sounds of the Father: the musical birthright of Henri Bergson
Discussant: Ed Baring, Princeton University
April 29′
Presenter: Erika Vause, St. John’s University
Title: “Real Estate, Not Mere Paper Titles:” Transatlantic Speculation, Settler Colonialism, and the Double Lives of Real Property in the Swan Lands
Discussant: John Shovlin, NYU
The NYC Area French History group is open to all interested in French history. We meet at the CUNY Graduate Center in Manhattan to discuss pre-circulated papers (and continue our discussions over dinner and drinks afterward). If you’d like more information or want to join our mailing list to receive papers and other announcements, please contact the co-organizers Erika Vause (vausee@stjohns.edu) or Cliff Rosenberg (crosenberg@ccny.cuny.edu).
3.3 Séminaire « Des statues pour mémoire? Colonialisme et espace public »
Nous avons le plaisir de vous transmettre ci-dessous le programme du séminaire “Des statues pour mémoire? Colonialisme et espace public”, qui reprend ce semestre, un lundi par mois de 14h à 16h, à Paris, sur le Campus Condorcet (métro Front populaire), Bâtiment de Recherche Nord (bâtiment du Crous), salle 2.001 et en distanciel. La première séance aura lieu lundi 27 janvier 2025, de 14h à 16h.
Séance 1 – Enquêter sur les statues liées à l’histoire coloniale : présentation des résultats du projet Cast in Stone / Gravées dans le marbre et actualité de la recherche sur les monuments contestés, lundi 27 janvier.
Interventions :
Présentation du projet Cast in Stone
Julie Marquet, historienne, maîtresse de conférences à l’Université du Littoral Côte d’Opale, HLLI, porteuse du projet Cast in Stone
Emmanuelle Sibeud, historienne, professeure à l’Université Paris 8, IDHES, porteuse du projet Cast in Stone
Actualité de la recherche sur les monuments contestés
Valérie-Ann Edmond-Mariette, historienne, doctorante au CIRESC-PHEEAC, membre du projet Cast in Stone et co-autrice d’un article dans le dossier de la revue Mémoires en jeu (MEJ) « Des statues pour mémoire ? Colonialisme et espace public en France », coordonné par J. Marquet et E. Sibeud.
Thaïs Dabadie, historienne de l’art, mastérante à l’EHESS, autrice d’un article dans MEJ.
Bruno Maillard, historien, chargé de cours à l’Université Paris Est Créteil & Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, co-auteur d’un article dans MEJ.
Astrid Nonbo Andersen, Phd, Senior Researcher at the Danish Institute for International Studies, sur l’actualité de la recherche sur les monuments contestés en Scandinavie.
Mathias C. Pfund, artiste et historien de l’art indépendant, auteur d’un article dans MEJ.
Françoise Taliano-des Garets, historienne, professeure à Sciences Po Bordeaux, sur le numéro de la Revue d’histoire culturelle « Le patrimoine colonial urbain, une histoire mémorielle (1945-2024), coordonné avec Didier Nativel.
Marie-Christine Touchelay, historienne, enseignante, IDHES, membre du projet Cast in Stone, autrice d’un article dans MEJ.
Séance 2 – Associations et militant.e.s face aux statues, lundi 3 mars – séance sous réserve de confirmation.
Séance 3 – Collections muséales et héritage colonial : une approche par l’histoire de l’art des statues du musée de Tervuren en Belgique, lundi 17 mars.
Intervention : « Salon des refusés », Anna Seiderer, docteure en esthétique, maîtresse de conférences à l’université Paris 8/Vincennes, EPHA/AIAC et Anne-Marie Bouttiaux, historienne de l’art et anthropologue, LAMC/ULB..
Séance 4 – Monuments, héritages coloniaux, patrimoines, lundi 7 avril – sur zoom uniquement. Attention, en raison du décalage horaire, la séance aura exceptionnellement lieu de 16h30 à 18h30.
Intervention : présentation de l’ouvrage Monuments Decolonized, Algeria’s French Colonial Heritage paru en 2024 à Stanford University Press par son autrice Susan Slyomovics, professor of Anthropology and Near Eastern Languages and Cultures at the University of California, Los Angeles.
Séance 5 – Contester les statues dans l’espace caribéen, lundi 5 mai.
Interventions :
« Une histoire longue des déboulonnages dans la Caraïbe », Christelle Lozère, historienne de l’art, maîtresse de conférences HDR à l’Université des Antilles, LC2S.
« Scénarisation et séquentialisation de la mémoire de l’esclavage dans l’espace public antillo-guyanais : les limites de la pensée décoloniale », Jean Moomou, historien, professeur à l’INSPE de Guyane, laboratoire MINEA.
Séance 6 – Statues, plaques, traces de la colonisation dans les églises : un exemple britannique, lundi 26 mai.
Intervention : « Westminster Abbey, haut lieu de la statuaire coloniale britannique ? L’exemple de l’Asie du Sud », Anne-Julie Etter, historienne, maîtresse de conférences, CY Cergy Paris Université, en délégation en 2024-2025 au CNRS (CESAH, UMR 8077).
Il est possible d’assister à distance au séminaire en contactant au préalable : Julie Marquet (julie.marquet@univ-littoral.fr) ou Emmanuelle Sibeud (esibeud@univ-paris8.fr)
3.4 Haiti and the World: Global Encounters of the Past, Present, and Future
Jacqueline Couti and Linsey Sainte-Claire from Rice University’s Department of Modern and Classical Literatures and Cultures are organizing Haiti and the World: Global Encounters of the Past, Present, and Future, an international symposium scheduled for February 7–8, 2025. This event will showcase Haiti’s rich cultural legacy and global influence while challenging persistent myths and stereotypes.
The symposium will delve into Haiti’s history, current challenges, and future prospects, addressing themes such as historical context, socio-political and economic issues, and ecological concerns. Over two days, participants will engage in dynamic panel discussions, roundtables, and presentations featuring scholars, artists, and community leaders from Houston and beyond.
A primary goal of the symposium is to amplify Haitian voices, particularly those from the diaspora, which are often underrepresented. By fostering a dialogue that prioritizes Haitian perspectives, the event seeks to celebrate Haiti’s contributions, provide nuanced context, and envision a brighter future. This interdisciplinary and inclusive platform aims to deepen understanding and appreciation of Haiti’s complex and enduring legacy.
This event will be a hybrid. A zoom link will be available shortly. On February 7, the event will take place in the Glasscock School of Continuing Studies, room 108. On February 8, the event will take place in the O’Connor Building for Engineering and Science, room 510.
https://haitiandtheworldglobalencountersofthepastpresent.wordpress.com/
3.5 La Revue des Colonies : Réseaux diasporiques et combats abolitionnistes
Colloque — La Revue des Colonies : Réseaux diasporiques et combats abolitionnistes
Vendredi 14 février 2025
14h00 – 18h00 (heure de Paris) | 9h00 – 13h00 (heure de Fort-de-France) | 8h00 – 12h00 (EST)
Organisé en partenariat avec les Archives nationales d’outre-mer et les Archives territoriales de Martinique, ce colloque international accompagne le lancement de l’exposition itinérante La Revue des Colonies : Diaspora + Abolition, qui sera présentée à Aix-en-Provence (février 2025) et à Fort-de-France (mai 2026).
Cet événement réunira les membres du projet d’édition numérique et de traduction de la Revue des Colonies (1834–1842), le premier périodique français dirigé par des personnes de couleur. Il mettra en lumière ce document essentiel mais peu exploré, indispensable pour comprendre les dynamiques transnationales de la lutte contre l’esclavage colonial.
Les interventions porteront sur la Revue des Colonies à travers ses figures marquantes, ses stratégies éditoriales et ses ambitions culturelles et politiques, avec un accent particulier sur les tensions de l’époque, façonnées par les aspirations à l’émancipation et les réalités de la domination impériale.
Intervenants :
- Jessica Balguy (Carnegie Mellon University)
- Maria Beliaeva Solomon (University of Maryland)
- Jacqueline Couti (Rice University)
- Laure Demougin (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
- Abel Louis (Société d’histoire de la Martinique)
- Yasmine Najm (Leipzig University)
- Grégory Pierrot (University of Connecticut)
- Noëlle Romney (Université Sorbonne Nouvelle)
- Michaël Roy (Université Paris Cité)
- Chelsea Stieber (Tulane University)
Avec le soutien de :
Archives territoriales de Martinique, Bibliothèque nationale de France, National Historical Publications and Records Commission, Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, University of Maryland, Maryland Institute for Technology in the Humanities, Tulane University, et le Schomburg Center for Research in Black Culture (NYPL).
Cet événement hybride est gratuit et ouvert à tous. Que vous choisissiez de nous rejoindre en personne ou en ligne, nous espérons vous y retrouver !
Pour suivre le colloque en ligne, inscrivez-vous au lien suivant: https://www.eventbrite.com/e/billets-la-revue-des-colonies-reseaux-diasporiques-et-combats-abolitionnistes-1118269346719
Lien vers le projet: https://revuedescolonies.org/fr/
3.6 Linguistic Challenges and AI Innovations for Haitian Creole: Overcoming Language Barriers for Healthcare
SAVE THE DATE for the 3rd Annual Louisiana State University CFFS Caribbean Digital Humanities Lecture
Linguistic Challenges and AI Innovations for Haitian Creole: Overcoming Language Barriers for Healthcare
Dr. Ludovic Mompelat, University of Miami
Virtual Lecture
Friday, February 21st, 2025 | 11 a.m. – 12 p.m. CST | 12 p.m. – 1 p.m. EST
The LSU Center for French and Francophone Studies is excited to host a virtual lecture with Dr. Ludovic Mompelat (University of Miami) on Friday, February 21st from 11AM-12PM CST / 12PM-1PM EST. This talk will explore the challenges and necessary steps involved in developing an AI-assisted translation and interpretation tool tailored to the Haitian Creole-speaking population in Miami. By addressing linguistic variation, multilingual code-switching, and domain-specific vocabulary for medical settings, the project aims to advance equitable healthcare access for an underserved community in the U.S. Key topics include the complexities of annotating and standardizing data for Haitian Creole, optimizing traditional Machine Learning approaches with the newest technologies in Machine Translation, and engaging local communities to ensure cultural and practical relevance. The presentation will also highlight strategies for scalability and generalization, with a focus on quantifying success through user feedback and community outreach. Join us to learn how cutting-edge natural language processing (NLP) technology can bridge language barriers and reduce healthcare disparities.
Pre-registration is required to attend. Meeting link will be sent on the morning of lecture. Register here: https://forms.gle/fAZS2C2D7dwsbVXQ9
3.7 Conducting Interviews: Oral History
School of Advanced Study • University of London
Conducting Interviews: Oral History
Research Training
Monday 3rd February 2025, 14:00 – 15:30 (London)
Online live via Zoom
Register here: https://www.sas.ac.uk/news-events/events/conducting-interviews-oral-history-0
Session Leader: Professor Sue Onslow (King’s College, London)
This session offers guidance and practical advice on how to conduct and transcribe interviews. The starting point will be group interviewing and witness seminars. The session will consider issues around objectivity and subjectivity, how to determine the usefulness of information gathered and make the most effective use of the information for the research project, how to distinguish between fact and opinion, and the place of secondary sources. The session will examine sensitivity and cultural awareness issues and address ethical interviewing.
3.8 Malcolm Bowie Prize 2024
Malcolm Bowie Prize 2024
In 2008 the Society for French Studies launched an annual Malcolm Bowie Prize, to be awarded for the best article published in the preceding year by an early-career researcher in the discipline of French Studies.
Malcolm Bowie (1943–2007) was not only the most eminent and inspirational Anglophone scholar of French literature and theory of his generation, but a towering figure in the field because of his tireless devotion to the scholarly community in the UK and beyond. His service to the Society for French Studies is just one example: he was President of the Society from 1994 to 1996, as well as General Editor of its journal French Studies from 1980 to 1987. The Society felt that it was particularly appropriate to honour his memory by founding a prize for which only early-career researchers are eligible, since he was a remarkable mentor to countless younger scholars, nationally and internationally.
The Society invites nominations of articles published during 2024 from editors of learned journals, editors or publishers of collected volumes, and heads of university departments. Authors may not self-nominate (but may ask editors, publishers, or university departments to consider nominating them). Articles may be published anywhere in the world, but must be written in French or English.
To be eligible for nomination, authors:
– must be current PhD students or recent students within five years of having obtained their PhD when their article was published. Due allowance will be made for career interruptions that have prevented research and publication, such as parental leave or sick leave.
– must have been registered for their PhD, and/or worked since their PhD, in a Department of French/Modern Languages, or equivalent.
The deadline for receipt of nominations for the 2024 Prize is 27 February 2025.
For full details see: https://www.sfs.ac.uk/prizes/malcolm-bowie-prize
4. New Publications
4.1 A Comparative Literary History of Modern Slavery: The Atlantic world and beyond
Volume I: Slavery, literature and the emotions
The first volume of A Comparative Literary History of Modern Slavery explores literary representations of enslavement with a focus on the emotions. The contributors consider how the diverse emotions generated by slavery have been represented over a historical period stretching from the 16th century to the present and across regions, languages, media and genres. The seventeen chapters explore different framings of emotional life in terms of ‘sentiments’ and ‘affects’ and consider how emotions intersect with literary registers and movements such as melodrama and realism. They also examine how writers, including some formerly enslaved people, sought to activate the feelings of readers, notably in the context of abolitionism. In addition to obvious psychological responses to slavery such as fear, sorrow and anger, they explore minor-key affects such as shame, disgust and nostalgia and address the complexity of depicting love and intimacy in situations of domination. Two forthcoming volumes explore the literary history of slavery in relation to memory and to practices of authorship.
4.2 The Productivity of Negative Emotions in Postcolonial Literature
The Productivity of Negative Emotions in Postcolonial Literature
Edited By Jean-François Vernay, Donald R. Wehrs, Isabelle Wentworth
This volume explores the possibilities and potentialities of “negative” affect in postcolonial literature and literary theory, featuring work on postcolonial studies, First Nations studies, cognitive cultural studies, cognitive historicism, reader response theory, postcolonial feminist studies, and trauma studies. The chapters of this work investigate negative affect in all its types and dimensions: analyses of the structures of feeling created by socio-political forces; assemblages and alliances produced by negative emotion; enactive interrelationships of emotion and environment; and the ethical implications of emotional response, to name a few. It seeks to rebrand “negative” emotions as productive forces which can paradoxically confer pleasure, agential power, and social progress through literary representation.
4.3 DOSSIER : Des statues pour mémoire ? Colonialisme et espace public en France
DOSSIER : Des statues pour mémoire ? Colonialisme et espace public en France
En 2020, une vague mondiale de contestations a visé les statues honorant, dans l’espace public, des personnalités impliquées dans la colonisation et l’esclavage. La contestation des statues, érigées pour servir de modèles civiques au cœur de l’espace commun qu’est l’espace public, n’est assurément pas nouvelle. Ce dossier ouvre une autre perspective à partir de biographies de statues coloniales contestées dans l’espace public français. Ces statues véhiculent une vision du monde et des agencements des relations sociales forgés à la période coloniale. Ce sont ces legs coloniaux, par moments indéchirables et comme désactivés, à d’autres moments servant de point d’ancrage aux contestations, qui seront interrogés pour réfléchir à l’inscription des mémoires plurielles de la colonisation dans l’espace public.
Au sommaire du dossier :
Julie Marquet et Emmanuelle Sibeud Introduction
Jean Moomou De nouvelles expressions mémorielles à la conquête de l’espace public guyanais : cloisonnement, concurrences, tensions
Lise Puyo Dégradations de monuments publics et inversions des symboles de luttes antiracistes (2016-2022)
Mathias C. Pfund La tête dans le socle. Chronique d’une commande artistique dans l’espace public suisse à propos d’une statue en lien avec le passé colonial
Iván Argote Autour de Air de jeux
Thaïs Dabadie La « Porte chinoise » du jardin d’agronomie tropicale : des expositions coloniales à l’investissement mémoriel et patrimonial
Loran Horau et Bruno Maillard Une statue contre la République
Adélaïde Marine-Gougeon et Valérie-Ann Edmond-Mariette «Joséphine […] ou pa pou ni stati ! » : histoire d’une statue coloniale décapitée
Emmanuelle Sibeud Revoir Gallieni
Marie-Christine Touchelay Les bustes de Christophe Colomb et Victor Schoelcher en Guadeloupe, des sentinelles de l’histoire ?
Julie Marquet et Abdou Karim Fall « Quatre briques auprès d’un trou ». Présences et absences des statues de Louis Faidherbe
4.4 Theories and Methodologies: Mariama Bâ’s Souvenirs of Lagos
PMLA, Vol. 139, Issue 5, October 2024
Theories and Methodologies: Mariama Bâ’s Souvenirs of Lagos
Table of Contents
Mariama Bâ’s Souvenirs of Lagos: An Introduction
Tobias Warner
A Feast for the Eyes: Mariama Bâ’s Pan-African Vision
Tsitsi Jaji
“Festac . . . Souvenirs de Lagos” and the Temporality of Black Expression
Annette K. Joseph-Gabriel
Punctuating Place, Time, and Pan-Africanism in Bâ’s “Festac . . . Souvenirs de Lagos . . .”
Stéphane Robolin
Bracketing the Possible: Mariama Bâ’s FESTAC Memories
Grace A. Musila
Mariama Bâ, Younousse Seye, and the Ambivalence of Canonization
Merve Fejzula
Mediated Ancestrality: Mariama Bâ, Instagram, and the Poetics of Fragmentation
Ainehi Edoro-Glines
Festac . . . Memories of an Oil Boom
Akua Banful
“These Pages Remain Open for the Future to Write”: Mariama Bâ’s Forgotten Writings in L’Ouest Africain
Tobias Warner
“This Intimate Burden”: An Interview with Mame Coumba Ndiaye
Mame Coumba Ndiaye and Tobias Warner
(lire en français)
https://www.cambridge.org/core/journals/pmla/issue/54AC59B045579B09365B6849E2D44316
4.5 Repeating Revolutions: The French Revolution and the Algerian War
Repeating Revolutions: The French Revolution and the Algerian War, by Timothy Scott Johnson
Repeating Revolutions examines how activists, intellectuals, social scientists, and historians looked to France’s Revolutionary past to negotiate Algeria’s struggle for decolonization from the 1930s to the 1960s.
The French Empire justified their claims over Algeria in part through messages of universal progress marked by the political visions tied to the French Revolution. Supporters of Algerian independence confronted those historical claims by identifying the Algerian cause with the French Revolution and by highlighting the apparent contradictions between the history of 1789 and imperial rule. Far-right activists, meanwhile, saw the movement to decolonize Algeria as another manifestation of the revolutionary disorder stemming from the French Revolution. Behind these analogies lay broader changes in the study of North African society and contemporary political relevance of the French Revolution. The focus on analogies to the French Revolution puts different sets of actors in conversation with one another and offers a fresh take on how people’s experiences and expectations changed throughout the Algerian War.
This book will appeal to readers interested in the intellectual history of decolonization, the historiography of the French Revolution, the historiography of North African studies, and questions of historical comparison and conceptual change.
The introduction of this book is freely available as a downloadable Open Access PDF at http://www.taylorfrancis.com under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC-BY-NC-ND) 4.0 license.
4.6 Le rayonnement des littératures africaines: 30 ans de création et de pensée-Revue Cinétismes
Ce nouveau double-numéro spécial de Cinétismes vise à mettre en lumière le renouvellement des littératures africaines sous l’angle de la création esthétique et de l’évolution de la pensée, tel qu’elles ont été mises à l’honneur dans le livre fondamental – à l’instar de The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge de Valentin-Yves Mudimbe (la première traduction en français ne datant que de 2021 chez Présence africaine, soit plus de trente-cinq ans plus tard – assemblé par Achille Mbembe et Felwine Sarr, et issu des Ateliers de la pensée qui se sont tenus à Dakar et à Saint-Louis-du-Sénégal en 2016, Écrire l’Afrique-monde (2017), qui fut rapidement traduit en anglais par Drew Burk et publié par Polity Press en 2022, avec le deuxième volet des Ateliers, The Politics of Time : Imagining African Becomings (Polity, 2023, trad. Philip Gerard). Rayonnement qui dépasse la sphère de la littérature et de la philosophie, par le biais de l’émergence de nouvelles figures littéraires et créatrices issues des webtechnologies, comme Cinétismes s’attache à le montrer depuis sa création.
Sommaire:
Présentation. À l’écoute de l’Afrique-monde : le rayonnement des littératures
africaines, 30 ans de création et de pensée, Faty-Myriam Mandou Ayiwouo, Jean-Pierre Fewou-Ngouloure & Hugues Azérad………………….. ……………………………………………………………………………… 12
Chapitre 1| Un Théâtre dans la violence : célébration de 10 ans de réflexions croisées
autour de l’œuvre artistique de Jean David Nkot (2015-2025), Jean David Nkot,
Michaëla Hadji-Minaglou, Faty-Myriam Mandou Ayiwouo ………………………………. 35
Chapitre 2| Réécrire la révolte, restaurer la figure d’Antigone ou réhabiliter les morts ?
Myriam Marina Ondo, Kokou Henekou ………………………………………………………….. 45
Chapitre 3| La représentation de la dialectique du pouvoir politique chez Norbert Zongo
à travers le parachutage, Ameyao Attien Solange Inerste …………………………………… 59
Chapitre 4| Violence conjugale et figures féminines chez Djaïli Amadou Amal, Ariane
Ngabeu……………… ………………………………………………………………………………….. 81
Chapitre 5| Fantasy and the origins of the City in the African Novel, Lola
Akande………………. ……………………………………………………………………………….. 100
Chapitre 6| Les Chiens Écrasés de Pierre Olivier Emouck : entre autofiction et
intergénéricité, Luc Didier Ze Ngono ……………………………………………………………. 123
Chapitre 7| Interculturalité et intertextualité dans Sabena, roman d’Emmanuel
Genvrin, Guy Razamany, Adèle Franky ………………………………………………………… 145
Chapitre 8| The Socio-political Problems in Germinal and God’s Bits of Wood:
Reinterpreting Zola and Sembène to understand the socio-political Problems of the
Sahel Countries between 1990–2024, Sawel Awuni ……………………………………….. 167
Chapitre 9| De la camerounisation du français à la convivialité sociale. Analyse
sémantico-guillaumienne des énoncés conversationnels oraux ou scripturaux dans
l’espace francophone camerounais, François Mbarga ……………………………………… 183
Chapitre 10| Pratiques socio-identitaires urbaines et articulation de la matérialité
langagière au Cameroun : comprendre les variants et les invariants communicatifs,
Madeleine Ngo Ndjeyiha …………………………………………………………………………….. 209
Dossier | Varia ……………………………………………………………………………………… 232
Chapitre 11| Manuels de français du primaire au Cameroun : quelle transposition
didactique pour la notion de développement durable ? Raphaël Adiobo Mouko, Edima
Mbongo Antoinette……… ………………………………………………………………………….. 233
Chapitre 12| Perspectives transdisciplinaires sur le développement inclusif en Afrique :
des approches d’Arendt et di Méo à la Kénose politique, Luc Ngoué Mbaha, Roger
Mondoué…………………… ………………………………………………………………………. 256
Chapitre 13| Politisation de l’action publique en situation de crise sanitaire de covid-
19 : des stratégies de riposte aux luttes politiques dans l’espace public au Cameroun,
Aboubakar Sidi Njutapwoui …………………………………………………………………………. 280
Chapitre 14| Le chaos et les enjeux épistémologiques de l’ouverture de la raison : de
Feyerabend à Serres, Marlène Sokeng-Fomena ………………………………………………. 295
CINETISMES, 2024
Revue pluridisciplinaire sur le langage/Pluri-disciplinary Journal on Languages,
3132, Université de Douala-ESSEC, DOUALA
ISSN L2791-2973 / E-ISSN 2791-2981
DOAJ : https://doaj.org/toc/2791-2981
Site internet : https://www.revue-cinetismes.com/
Email: revuecinetismes@gmail.com
https://www.revue-cinetismes.com/hors-serie-n2/
4.7 Indispensables et indésirables : Les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre
Indispensables et indésirables : Les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre, par
Quelques mois après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le gouvernement français décide de mobiliser des dizaines de milliers de travailleurs dans les colonies afin de pallier la grave pénurie de main-d’œuvre en métropole. Il s’agit d’organiser non seulement leur recrutement aux quatre coins de l’Empire – en Indochine, à Madagascar, en Afrique du Nord, et jusqu’en Chine –, mais aussi leur acheminement, leur affectation professionnelle et leur gestion quotidienne.
Cette vaste entreprise, première expérience d’immigration ” organisée “, conduit quelque 220 000 hommes dans les usines et dans les exploitations agricoles de l’Hexagone. Et elle secoue en profondeur l’ordre racial et les habitudes coloniales héritées du XIXe siècle.
Les nouvelles circulations impériales font en effet émerger des problèmes inédits. Afin d’assurer la continuité de l’autorité coloniale, comment adapter le régime de l’indigénat en métropole ? Comment empêcher que ces travailleurs transplantés ne s’affranchissent du nouvel ordre disciplinaire que l’administration s’efforce de leur imposer ? Comment prévenir les amours interraciales qui subvertissent radicalement la domination coloniale ? Et que faire des enfants métis qui naissent en métropole ?
Alors que la participation des soldats mobilisés dans l’Empire français à partir de 1914 est désormais bien documentée, le sort des travailleurs coloniaux de la Grande Guerre, perçus comme à la fois indispensables et indésirables, demeure largement méconnu. À l’aide d’archives inédites, Laurent Dornel ouvre un nouveau pan historiographique et éclaire un épisode qui a durablement marqué l’histoire des migrations vers l’Hexagone.
https://www.editionsladecouverte.fr/indispensables_et_indesirables-9782348081545